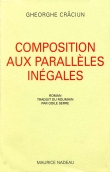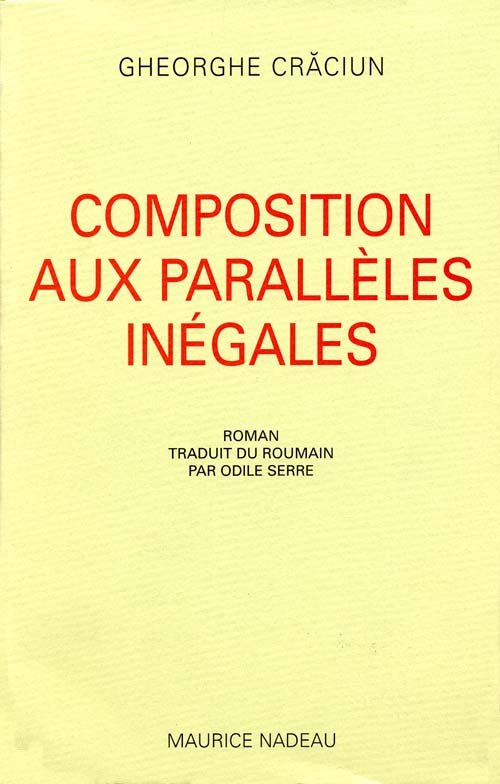Composition aux parallèles inégales
L'idylle de Daphnis et Chloé dans l'île de Lesbos, réécrite en quatre épisodes lumineux, incandescents, d'un lyrisme exacerbé, constitue le point d'ancrage. En contrepoint, le lecteur découvre des tranches de vie appartenant à la Roumanie déliquescente des années 1980 : les crises sentimentales, saisies sur le vif, se répondant d'un chapitre à l'autre, de divers personnages qui se rencontrent, s'aiment, se déchirent, souffrent et doivent assister impuissants, à l'agonie de leurs passion et s'enfoncer toujours plus dans un quotidien grisâtre et vide.
Préface de Serge Fauchereau. Traduit du roumain par Odile Serre, Composition aux parallèles inégales a obtenu le prix Pierre-François Caillé de la Société des traducteurs français et a été nommé pour le Prix de l'Union Latine. 278 p. (2001)
Né en 1950, Gheorghe Craciun est l'auteur de plusieurs romans et essais publiés en Roumanie. Il a enseigné à l’université Transilvania de Brasov et a été le rédacteur en chef de la revue Observator cultural à Bucarest. Il a reçu en Roumanie de nombreux prix littéraires, le Prix de la première œuvre de l'Union des écrivains de Roumanie en 1983, le Prix de la revue Viata Româneasca dans la catégorie prose en 1984, le Prix Octav Sulutiu de la revue Familia en 1988, le Prix du Livre de l'année au salon national du livre de Cluj-Napoca en 1994, le Prix de l'Union des écrivains de la République de Moldavie en 1995 et en 2003, le Prix ASPRO [Asociatia Scriitorilor Profesionisti din România, (l'Association des écrivains professionnels de Roumanie) du meilleur ouvrage de critique en 1997 et en 2002, le Prix de la revue Cuvântul dans la catégorie critique en 2002. Il meurt en 2007.
Extrait
Préface
Voici une histoire d’amour ou, plus exactement, des histoires d’amour. À un moment où ce genre encombre déjà beaucoup les rayons des librairies et des bibliothèques, où le roman à l’eau de rose des kiosques et des collections populaires voit son audience démultipliée par les romans-photos et les feuilletons télévisés, fallait-il ajouter un livre de plus ? On renoncera vite à cette question quand on verra combien ces histoires-ci sont peu conventionnelles, plus à l’eau-forte qu’à l’eau de rose, et, surtout, combien leur ambition est autre.
À son niveau le plus superficiel, Composition aux parallèles inégales se situe dans la Roumanie de la fin des années quatre-vingt, sous un régime dictatorial sournoisement miné par ses propres excès et dont désormais la critique aurait été redondante. Simultanément, l’action du livre se déroule également dans une lointaine antiquité, dans le cadre idyllique de l’île de Lesbos. Les courts-circuits entre l’un et l’autre contexte vont naturellement faire des étincelles tour à tour excitantes ou exaspérantes. La partie grecque est une simple reprise du roman de Longus, Daphnis et Chloé : deux jeunes gens qui s’aiment sans ombre et en toute innocence en dépit des obstacles extérieurs qui perturbent leur calme existence de pastoureaux. Jalousie d’un rival rustaud, incursion de pirates ou enlèvement de la bergère, rien n’a pour finir de grave conséquence grâce à la protection du dieu Pan. Ce ne serait qu’une simple traduction du grec si l’auteur d’aujourd’hui (appelons-le Craciun pour tout simplifier) n’avait décidé d’en parfaire le genre pastoral en y ajoutant, avec un humour à dose infime, des descriptions de son cru : paysages, plantes et fleurs qui, paradoxalement, nous paraissent les passages les plus authentiques de cet archétype du roman d’amour. L’intrigue elle-même n’avait très probablement pas été imaginée par Longus au IIe siècle mais il avait su parfaitement la retranscrire. Pour être cruciale dans Composition aux parallèles inégales, cette histoire ancienne n’occupe pas même un tiers de l’ouvrage. Tout le reste se passe aujourd’hui, dans un Occident urbain guère idyllique. La vie quotidienne est rendue difficile par la rareté de certaines denrées indispensables, les institutions publiques déglinguées, la débrouille de quelques-uns qui savent se concilier les instances au pouvoir. La fascination des signes du luxe et des objets venus de l’étranger — magazine allemand, parfum français, boissons et cigarettes américaines — tient lieu d’idéal à une population qui n’en a pas.
Revenons un peu en arrière. Le malaise lié à la surveillance des idées et à la répression de ce qui n’était pas conforme a marqué toute une génération en Roumanie, il a provoqué des exils comme ceux de Paul Goma, Dumitru Tsepeneag et bien d’autres dont les oeuvres ont étonné nos pays qui ne connaissaient pas ce type d’entraves à la liberté de pensée. En vérité, sans connaître la résistance intérieure de certains intellectuels demeurés au pays et dont les œuvres ne parvenaient pas alors jusqu’à nous, nous avions bien conscience d’une disparité entre les œuvres roumaines qui paraissaient en traduction au début des années soixante-dix. La Cellule des libérables (1971) de Paul Goma nous ouvrait brutalement les yeux sur un réel qu’on nous présentait crûment et lançait un terrible couac dans les louanges qu’on aurait aimé adresser au seul pays du Pacte de Varsovie qui avait refusé de se joindre aux chars russes écrasant le printemps de Prague durant l’été de 1968. Le premier livre de Tsepeneag dont nous prenions connaissance était d’un autre tour et d’une autre teneur et s’intitulait de façon significative Exercices d’attente (1972). En attendant le dégel, en attendant d’être accueillis dans les éditions toutes nécessairement officielles d’un pays qui les jugeait trop peu orthodoxes, en attendant, Tsepeneag et ses amis, exilés ou non, exploraient un monde onirique où les personnages se perdaient en des péripéties absurdes et cauchemardesques. Ce refus d'une transcription réaliste de la vie est une ancienne et profonde tradition roumaine, de Caragiale et Urmuz au début du siècle au surréalisme de M. Blecher et Gellu Naum, en passant par Tzara et Ionesco notamment. C'est sans doute ce qui rendait l’effort onirique plus durable, même si l’impact immédiat sur le public était moindre que celui d'une dénonciation nue.
On en était là lorsque est apparue une nouvelle génération d’écrivains, tous nés dans les années cinquante. Entre-temps le pouvoir roumain s’était aperçu que le monde entier admirait son avant-garde historique qu’il avait exilée ou réduite au silence. Il allait donc tenter de la récupérer. C’est ainsi que, faute d’avoir pu démolir sa fameuse colonne élevée à Tîrgu Jiu, on allait permettre une célébration du centenaire du sculpteur Brancusi. C’était laisser entrer toute une modernité qui allait mal avec un sévère contrôle des esprits et de la vie quotidienne car, enfin, la poésie de Gellu Naum ou la peinture de Brauner, c’est tout de même plus exaltant qu’un plan quinquennal ou une révolution prolétarienne à laquelle personne ne croit. Toujours sous les pressions extérieure et intérieure, il fallait bien, bon gré mal gré, laisser entrer parcimonieusement une culture étrangère (dangereusement formaliste et décadente, pardi) qu’on ne pouvait empêcher de s’infiltrer : l’art abstrait, la poésie américaine, le nouveau roman français, le structuralisme, que sais-je ? Les nouveaux venus des années quatre-vingt étaient nés sous « la dictature du prolétariat ». Ils se faisaient moins remarquer que leurs aînés par un esprit contestataire mais, mettant à profit les ouvertures que le régime faisait à contrecœur, ils n’en pensaient pas moins. Ils faisaient surtout une synthèse particulière de leur propre culture marginale et de cultures étrangères difficilement accessibles. D’une information et de lectures mûrement analysées, d’une distance prise sans agressivité et sans naïveté avec leurs aînés engagés ou oniriques, vont naître les romans de Mircea Cartarescu ou de Ion Groçan, les poèmes d’Alexandru Mtqina ou de Magda Carneci, les pièces de Matei Vqniec. Et le présent roman de Gheorghe Cràciun.
Envisagé avec un peu de recul et d'un point de vue plus large, Composition aux parallèles inégales est cependant bien autre chose qu’un roman roumain. A quelques détails près, indispensables, il n’a finalement rien de spécifiquement roumain et pourrait se situer naguère comme aujourd’hui dans bien d’autres pays où le malaise et les difficultés sont différents mais équivalents — l’Angleterre de Thatcher ou de Blair, la Pologne de Walesa, l’Amérique de Clinton ou de Nixon, le Paraguay de Stroessner, la France de Chirac ou de René Coty... Le roman de Craciun prend donc naturellement place dans le contexte plus général de la littérature occidentale, selon un processus qui se retrouve dans d’autres domaines (les arts plastiques, l’architecture, par exemple) et qu’on peut résumer en peu de mots.
Dès les premières années de la seconde après-guerre il a bien fallu admettre la fin de l’illusion avant-gardiste, l’idée que, de temps en temps, une poignée de créateurs pouvait rejeter ce qui l’avait précédée afin d’aller plus loin, plus radicalement dans l’expression de son époque par tous les moyens possibles. Désormais, chacun s’en tiendrait à son domaine. La littérature, pour sa part, essayait de se démarquer d’une grande génération d’aînés : ici le surréalisme, ses marges et ses dissidences, là Ezra Pound, James Joyce, W. C. Williams, là Kafka et l’expressionnisme, là encore Gômez de la Sema, Garda Lorca... En Roumanie, l’entre-deux-guerres avait été riche et diverse — Tudor Arghezi, Lucian Blaga, puis tout un surréalisme bâillonné et dispersé en 1948... Que faire après une telle opulence ? Populaire entre tous les genres, le roman s’était remis en question, de Céline à Pierre Jean Jouve et de Faulkner à Bruno Schulz ; il avait même fidélisé son public avec des séries-fleuves : La Saga des Forsyte, Les Thibault, Les Hommes de bonne volonté, Le Don paisible, Studs Lonigan... En vain Jean-Paul Sartre avec Les Chemins de la liberté et Aragon avec Les Communistes voudront-ils après la guerre ressusciter le roman-fleuve ; bien vite les démonstrations de l’un et la propagande de l’autre lasseront les lecteurs et les auteurs eux-mêmes. Le nouveau roman français et le réalisme magique latino-américain (Pedro Paramo de Juan Rulfo est de 1955) les relégueront dans l’oubli. Nouveau roman et réalisme magique à leur tour entrés dans l’histoire littéraire, le roman occidental s’est lassé des courants dominants, la « tradition du nouveau » s’est dévalorisée et, dès lors, tout semble possible ou presque : nous sommes dans le post-modernisme, nous dit-on, ce qui est censé tout expliquer.
L’écrivain (ou l’artiste) post-moderne n’ignore rien de ce qui l’a précédé et en retient éventuellement des éléments pour son propre compte. Chez ses prédécesseurs, les us et coutumes fantastiques des morts vivants de Juan Rulfo lui semblent aussi dignes d’intérêt que les ressassements d’une vieille dame autour d’une poignée de porte mal posée dans Le Planétarium de Nathalie Sarraute. Il se répète, non sans complaisance parfois, les paroles de La Bruyère (au XVIIe siècle !) « Tout est dit et l’on vient trop tard... » et, prenant le contre-pied de la position avant-gardiste, il se place sans plus de façon dans une tradition de reprise. Comme des Métamorphoses d’Ovide on est passé à La Métamorphose de Kafka, l’auteur post-moderne proposera de là comme dernier cri du jour la transformation d’une femme en cochon ou en quelque autre bête. Par la bouche d’un de ses personnages, Craciun avoue son dédain de l’originalité à tout prix et du sujet inédit : « Je n’ai jamais compris ce problème du sujet. Ni les chercheurs de sujets, ceux qui déclarent travailler sur un événement, un fait émouvant ou intéressant. C’est comme si on affirmait que le monde n’a de substance que de temps en temps et par endroits. Une bonne partie de notre existence n’aurait donc tout simplement pas de signification digne d’attention, méritant d’être connue. » Soit, mais Craciun n’a pas pour autant l’intention de confortablement recycler du vieux papier.
S’il y a une incontestable originalité dans Composition aux parallèles inégales, elle tient d’abord à sa structure formelle. En alternant ses chapitres comme qui bat des cartes, Craciun mène simultanément, on l'a dit, deux types de récit. D’une part, il reprend presque tel quel le roman antique de Longus en n’y ajoutant que des éléments d’atmosphère et de décor et, d’autre part, il nous rapporte sans fioriture des événements ordinaires du quotidien, des situations banales entre des personnages assez peu pittoresques. C’est le hiatus visible et les rapports cachés entre les deux qui font rebondir l’intérêt à chaque changement et stimulent ou agacent le lecteur : Qui garde les moutons ? Qui attend le train ? Qui est protégé par le dieu Pan ? Qui est amoureux de qui ? Il n’y a pourtant guère d’aléatoire là-dedans ; on est loin des fragments tirés au hasard d’un chapeau de Tristan Tzara ou des éléments manipulables au gré du lecteur d’un texte oulipien de Raymond Queneau. Plutôt qu’aux récits simultanés de John Dos Passos, on pense aux romans-gigognes de Raymond Roussel. Ici, d’un chapitre à l’autre, on ne change pas que de personnages, mais de ton et de style. Au besoin, le romancier intervient, badine avec son héros ou avec le lecteur, comme pour rappeler qu’il est présent derrière chacun et chaque phrase et qu’un livre est un objet fabriqué : « Maintenant, Dania devient le personnage principal. Il est probablement nécessaire de compléter son portrait. En route ! » Et de nous livrer une page en style télégraphique, une « fiche » psychologique, comme il dit lui-même. Il peut aussi s’étendre avec un malin plaisir sur des détails futiles ou triviaux : l’énumération des courses à faire dans la partie moderne ou la description de la sève qui monte à l’intérieur des plantes dans la partie antique.
En son temps, Isidore Ducasse-Lautréamont avait proclamé la nécessité du plagiat parce que « Rien n’est dit. L’on vient trop tôt. » Et encore ceci, toujours exact contre-pied de La Bruyère : « Nous avons l’avantage de travailler après les anciens, les habiles d’entre les modernes. » L’auteur de Composition aux parallèles inégales semble du même avis et envisage allègrement, outre Daphnis et Chloé, divers plagiats : « À avoir en tête, également, les hymnes orphiques, des fragments d’Aristophane, de Sophocle, Mimnerme, Alcman, etc. (en lisant, je les ai soulignés au crayon). Des citations, légèrement adaptées à l’esprit de mon texte, intégrées avec discrétion, où c’est possible, dans le corps du récit... » Ainsi le texte de l’histoire antique et le texte de l’époque moderne renverront-ils mieux l’un à l’autre, suggérant parallélismes et inégalités, comme l’indique le titre, mais que le romancier se garde de préciser : À quoi, à qui correspondent les brigands qui pillent Lesbos ? Quel est l’équivalent du voyeurisme de Vlad rêvant sur les lettres d’un inconnu trouvées dans une gare ? C’est peut-être quand on ne sait pas qu’on est le plus troublé.
Pourquoi insérer entre des tranches de vie contemporaine Daphnis et Chloé plutôt qu’un autre roman antique ? Mais précisément parce que l’auteur voulait le récit d’un amour idyllique et parfait qui contrasterait avec ce qu’il mettrait en parallèle : « Voilà un roman d’amour, dit un personnage, dont nous aussi, aujourd’hui, aurions un besoin urgent. Trop de convulsions, trop d’insatisfactions, trop de souffrances dans l’amour de mes contemporains ! » Il est bien vrai que les scènes de la vie entre les hommes et les femmes d’aujourd’hui qui nous sont présentées n’ont rien de très exaltant. Dans une société en proie à la morosité, au manque de liberté et aux difficultés matérielles (et ce n’est pas mieux dans les sociétés de consommation aux grandes inégalités sociales) l’amour semble tenir lieu d’ambition faute d’un autre objectif. Mais quel amour ? Composition aux parallèles inégales met le lecteur dans une position de zoologiste. L’oiseau qui vient vers moi, dans le parc, n’éprouve aucun amour pour ma personne ; il cherche seulement à satisfaire un besoin vital : manger. Ainsi, quand la faim, la soif et le sommeil sont satisfaits, ce n’est encore qu’un besoin vital qui pousse hommes et femmes l’un vers l’autre. Il ne faut pas s’extasier que, dans ces couples de bœuf sous un même joug, l’un ne peut supporter la mort de l’autre et meurt peu après à son tour ; il n’y a pas là d’amour mais la force de l’habitude. Ainsi les couples humains qui, après des années de vie commune, n’ont souvent plus entre eux que l’habitude et, au mieux, l’affection... Cràciun ne se pose pas en psychologue ou en sociologue ; son livre n’est pas un traité sur la dégradation des sentiments et des sensations. C’est un constat, sans explications, au travers de descriptions et de scènes qui ne sont jamais noires ni réellement tragiques mais grisâtres et mornes, plus ou moins. Libre au lecteur soucieux d’analyses d’accuser le pouvoir de l’argent ou des conventions sociales, les intégrismes religieux ou politiques qui institutionnalisent et normalisent la vie à coups de plans de carrière, de mariages et d’héritages ; libre à lui de remarquer le rôle donné à une sacro-sainte progéniture que glorifient le sentimentalisme gâteux de certains et la police officielle pour tous, l’un et l’autre plus oppressants en dictature communiste (terrible chapitre VII). Si le lecteur souhaite un tableau plus complaisant, on lui conseille ici « Ouvre au hasard n’importe quel roman rose que tu as chez toi et tu trouveras ».
L’amour de l’homme urbanisé d’aujourd’hui ne répond plus aux schémas classiques. La célèbre cristallisation stendhalienne qui a pu être crédible dans un monde sans contraintes matérielles, comme le salon de la princesse de Clèves ou de la Sanseverina, est largement caduque aujourd’hui où les classes sociales sont en apparence moins contrastées et où, par ailleurs, l’égalité règne un peu plus entre les sexes (du moins dans le domaine amoureux). Les rôles de l’homme chasseur insistant et de la femme proie coquette sont plus nuancés, voire inversés parfois. Or, dans les exemples qui vont nous être proposés, c’est surtout la nature de l'amour qui paraît changée. « Avez-vous été fou d’amour ? Avez-vous perdu le sommeil ? » demandait Stendhal. Ni Teo, ni Micaela, ni Liana, ni Laur, ni aucun personnage de Crâciun n’est assez fou d’amour pour perdre le sommeil ; les insomnies chez eux ne sauraient être que physiologiques. Les uns sont des tempéraments tièdes, mous, vieillis avant l’âge, les autres des velléitaires engoncés dans de petits soucis, des prudes ; tous s’ennuient plus ou moins dans leur vie médiocre et, consciemment ou non, ne cherchent dans l’amour qu’un palliatif une distraction. Seuls les plus forts échappent à ce leurre et d’autant qu’ils sont plus riches en rêves et en projets : Vlad Stefan et Luiza ont su garder de l’amour entre eux, certes sans en perdre le sommeil mais avec un discernement attentionné - car, si peu intense qu’il soit, l’amour est moins tué par l’indifférence que par la désinvolture. Quant à l’amour passion violente, l’amour fou qu’ont célébré les surréalistes avec emphase, l’auteur n’en donne pas d’exemple.
Cette cristallisation qui n’est plus de mise dans notre société présente n’existait pas davantage à l’autre extrémité du spectre, dans les tons pastel d’un monde pastoral circonscrit, deux mille ans plus tôt. Daphnis et Chloé se sont toujours connus depuis leur naissance, ils se sont toujours aimés sans doute ni jalousie. L’aiguillon de la chair est la seule chose qui soit venue troubler agréablement leur amour à mesure qu’ils sortaient de l’adolescence. On doit croire que la connaissance charnelle ne changera pas la passion entre eux — mais ce sont des personnages romanesques, bien sûr, les seuls du livre. Quant à tous les autres, on a l’impression de les connaître ou qu’on va les rencontrer dans l’immeuble ou au coin de la rue.
Le couple antique contraste à son avantage avec les couples modernes mais ce n’est pas pour les diminuer. Craciun s’occupe de littérature et non de prêche. Ne portant pas de jugement, il a préféré s’attarder au désir entre hommes et femmes, à la sensualité du monde alentour, et tant pis si le trop rare amour fou n’y a guère de place. Il reste heureusement le désir, partie intégrante du plaisir, sans quoi nous serions en proie à la mort lente de l’habitude. Pour notre aujourd’hui, c’est une morale épicurienne qui se dégage des vies parallèles exposées ici : les plaisirs d’amour sont fort agréables mais « il faut s’estimer heureux s’ils ne nous nuisent pas ». Finalement on ne nous propose pas un hédonisme mais, autant que possible, une recherche du bien-être, contraire du mal-être de l’époque, « en éliminant tout motif de trouble et de crainte » (C’est encore Epicure qui dit cela). Bien que ce ne soit pas facile dans ce monde aux parallèles inégales, qui est le nôtre, cultivons notre jardin d’Epicure. Qui conclut cela ? Un Daphnis devenu vieux souriant à ses souvenirs ? Longus sur Vile de Lesbos au IIe siècle ? Un auteur contemporain ? Un lecteur cherchant, lui aussi, à s’orienter entre des parallèles qui ne se rejoindront jamais ?
Serge Fauchereau
I. Autres copies légalisées
Elle serait joyeuse, rouge comme une pivoine, impatiente et ferait irruption en sautillant dans la cuisine. Un instant tu pourrais la voir ainsi : vaporeuse, légère, immobile en l’air. Oh, Tea, mais tu es en nage ! s’inquiéterait Luiza. Mami, je veux du pain avec du beurre ! dirait-elle en respirant vite, souriante, se penchant brusquement pour t’embrasser la joue, salut, Tati ! Regarde-la, je parle aux murs ! c’est à peine si Luiza pourrait encore contenir son irritation. Une fausse irritation, à l’évidence. Allez, Mami, j’ai faim, moi !... elle l’ignorerait, câline et tendre, se collant contre le corps encore jeune, mollement enfoncé dans le siège. Et tu aurais envie de rire, tu lui ferais discrètement un clin d’œil, tu voudrais sortir, mais Luiza te crierait avec quelque humeur : merci pour le repas, monsieur le comte Stefan ! Tu te retournerais et hausserais les épaules, coupable, agacé, embarrassé. Avec insolence tu tirerais la langue, mimant un retour ridicule. Tea ferait la grimace en cachette, craignant la réaction de sa mère. Luiza découvrirait ton délit et dirait : bravo ! Tu riposterais : banal, tellement banal, et si tu changeais de disque ?... Vous recommencez, les affreux ? se fâcherait-elle pour rire. Je suis avec Sorina en bas, à la balançoire, et elle se sauverait, le morceau de pain à la main.
Le bruit du verrou qui se referme tout seul et la petite fille sautant à cloche-pied dans l’escalier.
Seigneur, quel enfant ! protesterait sa voix traversant la pièce à ta recherche, mais pendant ce temps tu arriverais de l’autre côté, tu comprendrais encore une fois le reproche, tu lui permets trop de choses, tu la laisses toujours n’en faire qu’à sa tête. Puis tu frissonnerais, tu resterais immobile au soleil, dans la lumière liquide de l’après-midi. Tout était devenu insupportablement concret, consistant, lourd. La couleur bleuâtre du papier peint semblait arrachée au ciel d’un jour serein. Je ne suis là pour personne, Liz ! crierais-tu. Puis tu te jetterais sur le divan étroit, sur la couverture semblable à un champ de pissenlits. C’est du joli. Monsieur se couche pendant que le sexe faible travaille ! Un moment elle gâcherait une bonne humeur médiocre, au fond, mais tu ferais la sourde oreille. Plus tard, tu l’entendrais siffler comme un homme, cognant démonstrativement quelques pots et casseroles. Puis dans la chambrette lumineuse, aux jouets jetés par terre, aux cahiers et livres éparpillés sur la table, parviendrait un chapelet de propos sonores, au sujet de l’armoire et de ses gonds grinçants, du lavabo rempli d’eau, de la resserre et de ses paquets sacs bocaux boîtes bouteilles et récipients, des ronflements du frigidaire, de l’esprit fluide de la flamme et des pantoufles flop-flop d’une femme qui ne sait plus où donner de la tête.
Tu te lèverais, ton regard se durcirait en voyant Ramona, Corina, Ionela et leurs cheveux synthétiques, leurs visages de poupées potelées en caoutchouc rose, tu fermerais bien la porte, tu oublierais ce que tu voulais faire. La lumière inonderait encore mieux la pièce, mais les murs seraient sales, crayonnés, couverts de taches, de dessins, le papier arraché. La surface dégradée t’inspirerait un léger dégoût, une inquiétude chaude et passagère. Le papier peint azuré serait resté le même, les déchirures étroites et longues commencées par Tea vers trois-quatre ans dans la toile épaisse, striée, décollée sur les bords, seraient restées identiques. Et, tiens, pour la énième fois tu pourrais relire maintenant les fragments affleurant des journaux de dessous : des lettres, des mots, des fractions de mots, des traces de phrases et même des phrases entières d’un éditorial, d’un communiqué, d’un reportage sur le chantier des jeunesses communistes d’Agnita-Botorca, d’une chronique sportive, d’un appel à l’émulation socialiste, d’une nouvelle quelconque de l’étranger, car tu ne peux plus l’apprécier, puisqu’il te manque les informations nécessaires concernant l’année de construction de cet immeuble de dix étages et quarante appartements de confort normalisé.
Tu te surprendrais à bâiller, une faiblesse agréable t’inonderait sur-le-champ, mais aussi un grand mécontentement devant tout cela, remis depuis si longtemps à plus tard, devant tant d’urgences domestiques restées à ta charge. Tu ne soupirerais pas, tu ne chercherais pas à te sentir plus vieux que tu n’es, tu t’étendrais sur le lit, les mains derrière la tête. Tu serais cette fois encore convaincu que les meilleures idées te viennent à l’esprit lorsque tu es couché. Tu en saisirais une au vol, tu l’enfermerais dans une cage, tu la contemplerais, tu lui donnerais des ailes pour voler. Mais à ce moment-là, les pas de Luiza, entrant dans la prétendue salle à manger et allumant le téléviseur, à ce moment-là la voix menue et pleurnicheuse de Tea appelant d’en bas sa maman, la porte du balcon ouverte : elle est bien bonne ! je n’ai pas le droit de respirer un peu ? et : qu’est-ce qu’il y a, ma chérie ? et : Mami, Lenus m’embête ! et : Lenus, sois sage, jouez gentiment ! et : Tea, arrête de courir, tu transpires ! et la porte refermée, un soupir profond, las, une cigarette allumée, et tout cela sur fond de récital de variétés à la télé, mais toi tu te serais déjà blotti dans l’abri protecteur de l’imaginaire et, malgré tes tympans ouverts sur la vie présente de votre intérieur, malgré Angela Similea qui croit, dans sa chanson, que l’amour est tout, tu tenterais de réfléchir à un texte tout en étant certain de ne jamais l’écrire.
L’idée t’en était venue peu auparavant. Tu étais séduit par sa beauté et songeais alors à un récit fantastique. Tu regardais de nouveau le papier peint, tu voyais les lambeaux étroits des journaux collés sur les murs, dans une zone neutre de ta conscience, tu savais que bientôt il faudrait en venir à la rénovation de tout l’appartement, tu étais convaincu que Luiza ne supporterait plus un ajournement d’un an encore, elle t’avait seulement dit à propos de ses petites économies spécialement affectées au problème, « ça ne peut plus durer », mais tu étais un artiste, un écrivain, un démiurge et tu imaginais la situation suivante : un homme, une pièce de quatre murs au papier arraché çà et là, et des propositions fragmentaires, parfois sans signification et sans aucun lien entre elles. Tu savais que cet homme serait jeune, qu’il devrait te ressembler, être fatigué, vouloir dormir, s’étendre sur le lit et tout doucement se laisser envahir par une curiosité immodérée et agressive. Il est le père d’une enfant aux habitudes d’archéologue du périmètre domestique, il relit tout encore une fois, essayant de comprendre quelque chose, de faire de ces espaces lacérés et disparates un seul monde, mais sans succès aucun, car les lignes écrites verticalement, du genre :
« Je n’ai pas voulu te séduire par je ne sais quels moyens... » ; « L'image s’est éteinte. Sa voix s’est fondue dans le clair-obscur et sa chair de nouveau enveloppée d’un tissu transparent » ; « ... je suis libre maintenant de prendre une autre décision... » ; «... à propos de ce paysage, et de nouveau ses cheveux que je sens lourds épais vaporeux et chauds et ensuite la fumée de ma cigarette... » ; « J’étais acteur... » ; «... Si c’est l’idée lorsque je voudrais sursauter me tourner telle la parabole d’un radar... » ; «... L’homme non plus n’a pas beaucoup changé mais l’enfant d’alors... »,
sont autant de fils rompus et diversement colorés, semblent autant d’impulsions à l’adresse de son envie de déchirer le papier peint pour pouvoir lire encore plus. Alors il s’assombrit, obstiné, résolu, va vite chercher un couteau, et élargit avec fureur les surfaces écrites, déchirant des lambeaux entiers de toile striée, s’arrêtant épuisé pour déchiffrer une partie du mur tout juste dévoilée. Et il commencera à trembler et le mur sera muet et froid et son cœur s’affolera, sa respiration se fera saccadée, convulsion terrifiée, ardente.
Le texte qu’il lira pourrait être celui-ci :
« ... où nous nous sommes rencontrés par hasard au musée d’art, puis nous sommes partis ensemble, par une pluie de début d’hiver, sous le même parapluie, sa main entourant mon bras, plus tard nous avons discuté sans détour clairement et en allant au fond des choses de ce que chacun de nous ressentait par rapport à l’autre, alors elle m’a dit quelle ne se rappelait plus le jour où cela signifie quelle n’a senti aucune chaleur intermittente de mon regard derrière elle pour être ensuite abandonnée comme pour induire en erreur au-dessus de l’imperméable vert au-dessus de sa tête. Et quelle lumière extraordinaire et quelle sensation étrange j’ai eue pendant quelques instants, d’artifice d’irréalité de surface bidimensionnelle dans l’éloignement. Il s’agissait d’un tableau de Horia Bernea que nous avions vu récemment et un fragment surgit alors de ma mémoire visuelle au-dessus de ses cheveux. La toile représentait un champ de maïs ou plus précisément une étendue de tiges de maïs enveloppée de cette atmosphère de désolation émanant des végétaux qui vers la fin de l’automne, une fois les fruits récoltés, paraissent avoir perdu, représentés ainsi seulement par leurs feuilles et leurs tiges desséchées, toute signification pour l’homme, tout droit à la présence, surface décrite par des bruns des gris et des roses beiges jusqu’à la moitié du tableau, pour que soudain, conservant un équilibre presque impossible, l’image se détache d’un fond très esprit Renaissance dans un lointain laiteux de collines composé selon toutes les règles de la perspective d’Alberti, laiteux jusqu’à un bleu de fumée de cigarette flottant dans une chambre l’été quand le matin dans une lumière veloutée et très égale l’air est pur et on peut tout y lire toute la corporalité mouvante du rouleau de fumée et tu es saisi alors par un sentiment d’insécurité de pénétrabilité et de dissolution de ta propre matière qui te semble trop brutalement et trop grossièrement répartie constituée de façon trop élémentaire dans une structure. C’est à peu près cela que je devais dire à propos de la lumière, à propos de ce paysage, et de nouveau ses cheveux que je sens lourds épais vaporeux et chauds et ensuite la fumée de ma cigarette bon marché se mêlant quelquefois à leur soie à leur épaisseur. Je la touchais de cette façon, en fumant, depuis un moment je parlais avec celui qui était à côté de moi... » Et le personnage de ce texte sera justement l’homme devant le mur, un homme épouvanté de découvrir que sa vie transformée en littérature se trouve là — revers de cet épiderme bleuâtre aux veinules verticales. Et son effroi devra être décrit en quelques phrases simples, à la façon de Borges et non de Dostoïevski, à la façon de Nabokov et non de Faulkner — voilà ce que dévidait maintenant, fébrile, ton esprit libéré oubliant les problèmes de la maison, le fond sonore du téléviseur, la pâte liquéfiée du soleil de l’après-midi.
Tu te demandais dans quelle mesure la meilleure fin de ton histoire ne devrait pas coïncider avec la situation de cet homme qui perd la notion exacte des choses et sent soudain que ces murs tels des écorchés sont purement et simplement de l’air, un air condensé et sombre propice au vol, mais ses ailes se briseraient en se blessant contre les surfaces spongieuses de béton. Bien qu’en même temps tu sois convaincu de ne jamais pouvoir écrire quelque chose de ce genre, car ta vie n’a rien de fantastique, rien qui sorte du commun. Car tu es le prisonnier et le propriétaire de ces murs qui doivent être refaits, des portes qui attendent d’être repeintes, de l’ascenseur et de l’autobus te conduisant quotidiennement au boulot, de la fatigue et de la liste des courses, des soucis familiaux et de tous les stress, car tu es le captif fasciné par le téléviseur allumé, car tu es le tympan et l’œil dans lesquels s’écoulent des mélodies, des jouets et des poupées, car tu es le chasseur de sa démarche de femme qui ouvre maintenant la porte de la salle de bains, prend un spray et appuie sur le bouton, après quoi on n’entend plus rien pendant longtemps, très longtemps, ah si, un chuintement de peigne dans les cheveux, un froufrou de vêtements, de l’eau s’écoulant, un silence de mouvements lents et d’yeux plongés dans le miroir, l’odeur forte du déodorant s’insinue par les fentes entre la porte et le chambranle, commence à saturer l’air, à coller à tes narines comme un parfum de chair propre et fraîche, elle est si proche que tu entends sa respiration à travers la membrane de bois et, quand sa présence magnétise la lumière glissant sur l’effilement de tes paupières entrouvertes, tu es déjà certain de ce qui suivra, de ce qui se passera. Luiza est pieds nus et la peau blanche de ses jambes amollit l’air, la jupe devient transparente dans le déluge de soleil et sous le tissu léger sa longue silhouette se dessine, à travers le corsage les seins ronds jaillissent sous le regard avide, pointant à peine, ils n’ont plus la jeune palpitation d’il y a sept ans, mais leur volume est plein et parfait, quand elle est entrée dans la salle de bains, elle s’est changée et elle n’a gardé sur elle que les deux vêtements légers, transparents, voluptueux dans leur illusoire matérialité ; elle se déplace maintenant, indifférente, dans la pièce, provocante et calme, elle feint de chercher quelque chose, elle s’approche en glissant de ton corps tendu et tes yeux sont une lame qui coupe, une main qui la caresse, la déshabille, l’appelle, et tes yeux attendent. Elle sait que tu es éveillé, mais elle ne dit rien et s’assoit sur le canapé en te regardant, jusqu’à ce que tu n’en puisses plus, jusqu’à ce que tu tendes la main, mais tu n’ouvres pas les paupières et ta main monte sur son ventre et ses doigts descendent dans tes cheveux, tes tempes s’électrisent, sa peau est brûlante, sa chair frissonne comme si l’air était froid, déchaînement de caresses et respirations rapides, tempe effleurée par les lèvres, cheveux ébouriffés et bras enchaînés, chemins parcourus, arrêts et impatiences, une course ardente et douce.
Et le soleil tomberait sur vous et du téléviseur toujours allumé jailliraient des hourras, applaudissements et huées et la voix du speaker serpenterait, lisse, égale et exacte et les longs cris des enfants s’élèveraient du terrain de jeux dans une marée de tonalités et, au moment du but, vous seriez témoins d’une explosion hystérique dans le quartier, vous sursauteriez légèrement, sans conviction, simulant un étonnement mais aussi un inconfort, et soudain elle crierait effrayée : ça brûle à la cuisine ! et toi tu prendrais son épaule dans ta main comme un fruit, pour l’empêcher de partir. Elle se débattrait avec une faiblesse feinte : tu n as pas honte ! tu enfoncerais tes dents blanches dans sa nuque dorée, elle s’exclamerait : tu es fou, idiot ! tu mordrais et elle tressaillirait vaincue avec un gémissement naturel de plaisir, tomberait à côté de toi et t’écraserait les lèvres de sa bouche implacable aux canines pointues. Et plus tard tu lui dirais : sais-tu à quoi je pensais, que dirais-tu d’un texte dans lequel un homme est dans une pièce comme celle-ci et regarde les murs... Mais elle s’inquiéterait encore une fois : oh, mes pommes de terre brûlent ! réussissant, finalement, à courir à la cuisine d’où se faufilerait une lente traînée de fumée. Et tout se terminerait ainsi : les pieds nacrés de Luiza courant sur les tapis moelleux, ses épaules à l’éclat de vif-argent, son corps de belle femme, se mouvant, pressé, dans une lumière sanguinolente.