Intime connexion
Anne est une femme convenable. Elle a été mariée, a eu des enfants, puis elle a vécu une longue passion mais elle n'a jamais joui véritablement. Elle est seule. Sa mémoire a gardé le souvenir de quelques moments troublants de l'enfance... La vie est là, la jeunesse s'éloigne et les hommes ne cessent de la hanter. Elle décide de sortir de sa réserve. En activant les touches d'un Minitel, elle va faire surgir selon ses humeurs, l'artisan cordonnier, le bourgeois rassis, l'homme abandonné, l'étrange Macoumbo, et bien d'autres... Chacun à sa façon sera une révélation, une étape de cette quête acharnée qui ne manque pas d'être souvent drôle et inattendue. Parviendra-t-elle à cet orgasme mirifique qu'elle cherche avec tant de détermination ? En tout cas ces chevauchées hasardeuses avec les hommes l'aguerrissent, elle ose faire ces choses insensées, et écrire ces mots interdits. 199 p. (2001)
Catherine Clémençon est née quelques années après la guerre dans une famille désargentée de la "bonne" bourgeoisie. Elle a fait des études de Lettres à la Sorbonne. Elle a ensuite enseigné dans un lycée de l'Ouest parisien. Intime connexion est son premier roman. Elle a publié par la suite chez d'autre éditeurs (Le Seuil, L'Harmattan) trois autres romans.
Extrait
I
Alors j’ai bien été obligée de m’y mettre. J’ai délogé par petits à-coups successifs la cuisinière encastrée entre le lave-linge et le mur, en faisant attention à ne pas m’écorcher les doigts et j’ai vu que le fin tuyau rigide en fer ne pénétrait plus correctement dans la gaine en caoutchouc souple qui mène le gaz aux différents brûleurs. L’embout était nettement déchiré, et à chaque fois que j’essayais de le réemboucher, la déchirure se fissurait de plus belle. A tel point que je me suis demandé si vraiment ce tuyau était du calibre adéquat. L’opération semblait impossible. Pourtant, en regardant de plus près je vis écrit à l’encre violette sur le caoutchouc « Normagaz, But. » « Norma » était rassurant et je fis un dernier effort pour les visser l’un à l’autre en exerçant une très forte poussée. Enfin quelques millimètres de la tige rigide s’engagèrent dans le tuyau et je sus au léger renflement de ce dernier que ça allait enfin tenir... Pas très longtemps, mais c’était toujours ça de gagné.
Je me souviens des hivers en montagne avec Marc, l’arrivée aux Terrasses, le froid glacial, la nuit, blottis l’un contre l’autre. Toute la nuit et les suivantes aussi. Ah ! comme j’avais été heureuse. Le gros gâteau de l’amour se découpait en larges tranches. L’été je le suivais sur les sentiers, le souffle coupé, hypnotisée par le galbe de ses mollets dont je voyais pas après pas, saillir la musculature parfaite. Silence, cliquetis du piolet contre les crampons pour débotter. La neige fondait à deux mille mètres. J’avais son souffle, régulier, pendant des heures dans les oreilles, le mien peu à peu s’y calait. Je ne voyais pas les sommets, je ne levais les yeux que vers lui. Une fois, en altitude nous étions sortis de la nuit ensemble, l’heure était devenue bleu roi, et le soleil soudain nous avait éblouis de sa gloire. Alors il s’était retourné... Il était nimbé de lumière. Quel beau visage d’homme ! Je ne sentais plus mes pieds. Je l’aimais à en perdre le souffle, éperdument.
Avec la chasse d’eau l’autre nuit ça n’a pas marché. Ce chuintement dans les canalisations. Depuis deux ans... Depuis que Marc... Je me suis levée pour voir ce que je pouvais faire. J’ai dévissé doucement le bouton de Bakélite noire et ôté le lourd couvercle d’émail. C’est un drôle de système là-dedans. Jamais vu ça. Un berlingot en plastique blanc transparent est posé à la verticale dans le coin droit de la cuve. Une tige en métal nickelé le pénètre par un orifice en forme de petit losange parfaitement découpé. C’est le niveau de l’eau dans la cuve qui actionne la tige dans la fente de bas en haut quand l’eau arrive et puis de haut en bas, quand elle redescend.
Ce bruit insistant m’a tellement énervée que pour l’étouffer, je plonge mes deux mains dans î’eau, tripote la tige et secoue violemment le berlingot. Le bruit devient assourdissant. Tout se déglingue.
II
C’est curieux, ma mère ne l’aimait pas... Des histoires à propos de mon père, certainement. Je l’avais vue pour la première fois à Aix-en-Provence, dans la propriété de mon grand-père, j’avais six ans. Elle était jeune alors, grande et svelte, et m’avait fait monter sur son cheval dans le champ d’orge coupé. Sur la colline on dominait tout, et en plus, là-haut sur le cheval, on voyait très loin autour, la Sainte-Victoire et un peu de la Sainte-Baume, mais aussi la route de Nice, et de l’autre côté, les Alpes du Sud. Elle parlait tout le temps au cheval pour qu’il avance sagement. Dès qu’elle se taisait il avait l’air menaçant. Je ne sais plus comment s’appelait ce cheval, ça va me revenir. Un drôle de nom. Je me tenais bien droite et je retenais ma respiration. Mes jambes maigres brinquebalaient de chaque côté de ses flancs. Elle montait à cru. Il fallait serrer les cuisses très fort pour ne pas tomber. Pour avoir plus de prise elle me disait de m’accrocher à la crinière d’une main et de le caresser de l’autre pour le remercier et qu’il m’accepte. Il fallait que je me penche loin en avant pour attraper cette fichue crinière, je trouvais ça très dangereux et puis à un moment ma tête a touché le cheval et je suis restée longtemps mes bras autour de son gros cou plein de crins et je le serrais, le serrais de toutes mes forces. Elle m’a dit « Accroche-toi bien » et elle a donné une petite tape au cheval qui est parti au trot puis au galop jusqu’au bout du champ. Je tenais bon. J’avais l’impression à chaque saccade de m’envoler vers le ciel et pourtant j’avais le visage enfoui dans ses poils noirs. Le ciel sentait fort.
J’avais les joues en feu. Elle eut un petit rire amusé quand elle me prit dans ses bras pour me mettre à terre. Elle vit mon visage rouge de trouille et de joie. Elle me félicita. C’était une magicienne, une sourcière... Elle trouvait de l’eau dans les collines avec une baguette de coudrier et elle s’adressait au bon dieu d’un air supérieur. Elle lui donnait des ordres comme au cheval, mais je sus par la suite qu’il ne lui avait pas obéi. L’unique été que j’avais passé en Provence.
Il faut que j’accepte de vivre avec ce gouffre entre les jambes, avec ce trou dans la tête, et toutes ces maisons vides. J’ai mal au cou. Elle est en train de se dévisser, ma tête. Peut-être qu’elle s’arrime au contraire, peut-être qu’elle va faire corps avec le corps. Ce serait bien. J’ai le menton raide et les deltoïdes comme du bois sec. Un fouillis indescriptible ces histoires. Il faut que je m’y retrouve et que tout cela cesse. J’avais toujours pas mal pensé aux hommes mais là, ça devenait lancinant. Je pensais à eux sans arrêt. Ni comme à des maris, des collègues, des frères, ni comme aux conducteurs d’autobus, au président de la République, aux soldats de l’ONU, aux chasseurs, aux flics, aux assassins... non, pas du tout ! Quoique les chasseurs, les vrais connaissent bien les bêtes et les aiment. Non, je pensais aux hommes plutôt comme à mon garagiste, au livreur de fuel, au maçon vitrier avec sa belle salopette blanche repassée le matin par sa femme, aux ébénistes que j’imaginais des hommes très doux. Être une simple chaise entre leurs mains qu’ils tournent et retournent sans hâte, en sachant ce qu’ils font. Il n’y aurait que ça pour me tenir tranquille ! Une amie m’avait dit qu’on pouvait en rencontrer tant qu’on voulait. Il suffisait d’oser.
Pour cela j’ai utilisé un Minitel ordinaire et j’ai rempli un C.V. sur 3614 2 PLV. J’ai gardé mon prénom et je suis devenue Anne 28. On était 442. Il y en avait une qui avait dû se désister quelques secondes avant mon inscription. Tant mieux, je n’aurais pas aimé être dans les quatre cents. « Raffinée, sensuelle, douce ! » Douce, c’était plutôt la peau. J’étais souvent triste mais par moments je me sentais féroce. Trois adjectifs comme ces petits morceaux de métal que les pêcheurs ajoutent à leur ligne, et qui chatoient entre deux eaux. On appelle ça des cuillères, je crois. Est-ce que les hommes allaient se laisser ramasser si facilement ? « Les », il suffisait d’un seul... Un comme Marc. Ils allaient bien faire des gestes, avoir envie de me toucher, comme j’avais envie moi, depuis quelque temps de les approcher, de promener ma main sur leur poitrine velue, ou lisse... plutôt velue d’ailleurs. Et aussi de toucher entre leurs cuisses cette chose étrange et fragile qui se tend et se gonfle quand ils sont contre nous. Enfin, pas toujours, pas tout le temps, non plus. Justement, les trois hommes que j’avais aimés, ça n’avait pas été ça. Aujourd’hui encore je pleurais quand je voyais au cinéma un homme et une femme s’enlacer et se serrer l’un contre l’autre pour s’endormir. La nuit pouvait tomber, me disais-je...
Marc avait cessé de coucher avec moi depuis longtemps, quand on avait fait ce voyage en Afrique. L’ultime voyage. C’est avec Daisy qu’il couchait depuis un certain temps. Daisy était blonde, une sensibilité à fleur de peau, sa peau de lait si fragile, et elle, elle le faisait bander.
En Afrique, les hommes exposaient à mon regard leur magnifique musculature, sur les pectoraux et le haut des épaules, sur les cuisses, on voyait bouger les adducteurs sous la peau satinée. J’éprouvais une attirance inexplicable. Je commençais à regarder sérieusement d’autres corps d’hommes. Par exemple celui du jardinier noir de la belle-sœur de Marc, chez qui nous étions, dans cette belle maison de la banlieue de Lomé. Les hommes noirs, un cliché bien sûr... N’empêche ! Svelte, presque nu, fruit étrange sur le vert de la pelouse, je ne sais pourquoi il venait se planter constamment dans le champ de mon regard, au centre des grands rectangles des baies vitrées, ouvertes sur l’extérieur. Tous les soirs, j’entendais du bruit dans les feuillages, et des pas sur le gravier, comme s’il osait enfin s’approcher de mon lit pour me prendre et me tarauder en silence pendant que Marc dormait.
De retour à Paris, ma voiture était tombée en panne. Comme tout le reste dans ma vie, au point mort. C’est comme ça que j’ai rencontré Mamadou, le beau Mamadou, qui semblait m’attendre de loin adossé à sa Mercedes, à la station de taxi de la Porte de Saint-Cloud. Je sortais d’une clinique du coin où mourait dignement ma meilleure amie. Cancer généralisé. Mamadou était beau, et surtout il était noir. Je regardais ses grandes mains délicates sur le volant pendant qu’il me parlait des femmes. Il leur plaisait beaucoup aux femmes. Il disait ça en éclatant de rire et quel rire ! Pas vantard, non, un rire de connaisseur, un rire de gratitude, tant de bonnes fortunes pour Mamadou, fils du chef de son village, en Casamance. Mamadou, fils de roi, exilé à Paris, Mamadou dragué par ses clientes, invité par des stars du show-biz. Une femme écrivain, très célèbre, avait organisé une fête où tout était du bleu du boubou de Mamadou. Bleu le champagne et ses bulles. Il en rigolait encore, un grand rire bienveillant et torride, qui aurait ressuscité tous les laissés-pour-compte, les rachitiques, les impuissants, les mourants, et les femmes frigides. Un rire qui m’avait réveillée une fois dans un rêve, bien avant cette rencontre. J’étais une petite fille avec des nattes et des socquettes, et un mage me remettait un bout de papier avec trois mots griffonnés, on m’appelait au téléphone, c’était urgent, très urgent, il fallait descendre quatre à quatre, un escalier monumental, la cabine téléphonique se trouvait dans un petit réduit sous l’escalier, je trébuchais, anxieuse, le cœur battant, le thorax comprimé, et au moment où je me saisissais du récepteur, la sonnerie cessait. Je dépliais alors la boule chiffonnée dans ma main, j’allais trouver l’énigme... quelqu’un enfin me faisait signe ? Un mot étrange était inscrit... Indéchiffrable. Et quand je relevai la tête, dépitée, Mamadou était là en personne, et il souriait comme si c’était une bonne blague. Dans le taxi, je l’entendais me dire « Tu es une vraie femme toi, ça se voit dans tes yeux... » Je voyais les siens noirs et pleins de malice, dans le rétro. Je ne comprenais pas ce qu’il voulait dire avec son « vraie femme » ! Il y en avait des fausses ? Jamais on n’avait parlé de ça autour de moi. Je me sentais misérable au fond de mon grand taxi. Une intouchable. Une maudite. « Ah, l’amour... », avais-je susurré d’un sourire entre deux larmes. Depuis que Marc m’avait laissée pour Daisy, je respirais encore plus mal, juste un filet d’air. Je ne pouvais presque plus parler. « Et même sacrément vivante...», se disait-il comme à lui-même. J’avais fini par sécher mes larmes. Lui, un homme, il sentait ça... Quand je suis descendue du taxi il était déjà dehors à faire des gestes enveloppants, pour m’attirer à lui. Une grande couverture chaude. Il y avait si longtemps que je n’avais vu d’aussi près sous la chemise ouverte la peau d’un homme. Si belle, noire sous le coton bleu ! Je ne respirais plus du tout. J’ai évité de plonger dans son regard, ce brun liquide, si doux... Je me suis dégagée comme j’ai pu. En me retournant, j’ai vu sous sa lèvre supérieure relevée, ses dents blanches, il souriait d’une drôle de façon, et j’ai cru entendre un hennissement. Plusieurs jours, j’ai gardé la brûlure de ses mains sur mes bras.
€ 15.00
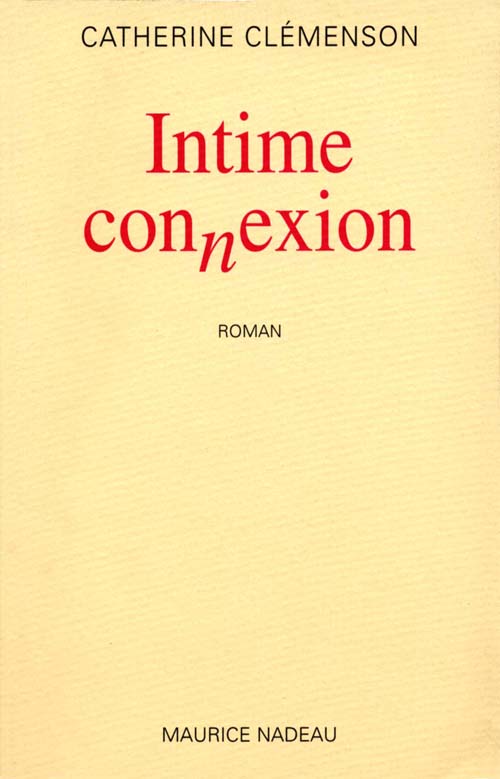
Anne est une femme convenable. Elle a été mariée, a eu des enfants, puis elle a vécu une longue passion mais elle n'a jamais joui véritablement. Elle est seule. Sa mémoire a gardé le souvenir de quelques moments troublants de l'enfance... La vie est là, la jeunesse s'éloigne et les hommes ne cessent de la humer.
Elle décide de sortir de sa réserve. En activant les touches d'un Minitel, elle va faire surgir selon ses humeurs, l'artisan cordonnier, le bourgeois rassis, l'homme abandonné, l'étrange Macoumbo, et bien d'autres... Chacun à sa façon sera une révélation, une étape de cette quête acharnée qui ne manque pas d'être souvent drôle et inattendue.
Parviendra?t?elle à cet orgasme mirifique qu'elle cherche avec tant de détermination ? En tout cas ces chevauchées hasardeuses avec les hommes l'aguerrissent, elle ose faire ces choses insensées, et écrire ces mots interdits.
Catherine Clémenson est née quelques années après la guerre dans une famille désargentée de la « bonne » bourgeoisie. Elle fait des études de Lettres à la Sorbonne, puis s'inscrit à Nanterre en doctorat de 3e cycle. Elle enseigne dans un lycée de l'Ouest parisien.
Intime connexion est son premier roman.


