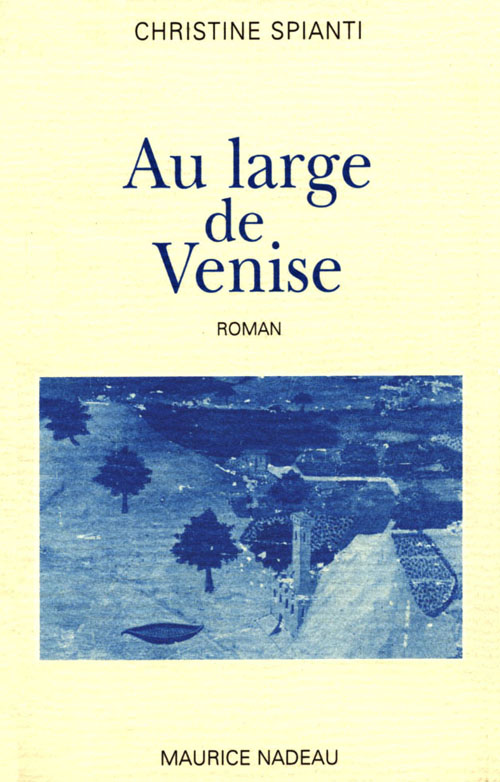Au large de Venise
Trois histoires, trois journées dans la beauté époustouflante de Gira, une île au large de Venise. Deux hommes et une femme spectateurs de l'écume des flots, du soleil de mai et du monde qui tourne fou. Trois existences, au bord du bonheur, suspendues entre insurrection et anéantissement, qui cherchent à s'arracher pour renouer les fils de la vie. 187 p. (2002)
Extrait
AU POINT DU JOUR
Soudain j’ai levé les yeux, et c’était la mer, dans le blanc, commencée à l’aube levée, et c’était le poudroiement de l’eau éblouie et sur l’étendue grise et bleutée, une tache blanche soulevait les vagues au liséré noir, là, juste avant l’écume, avant de se prendre en gémissant pour le sable. Ressac. D’où je suis, les fonds bruns tremblent en transparence jusqu’au sud du port, sous les lignes à montures noires des rochers, tandis que la voûte poudrée du ciel s’éploie, les nuages tout droit nous regardent tant.
Ebloui aussi, Statio, là, tout près, d’être arrivé jusque-là. Chacun par-devers soi, dans sa tentative d’improbable disparition. Impossible de reprendre son souffle dans le visage de Statio, au désordre de ses cheveux dans la lumière. Son visage se plie dans l’ombre des genoux, ses bras les enserrent. Se replie sur le gris du vêtement sa bouche large et droite. Ses yeux fermés. Maintenant il voudrait tout abandonner et tout de suite.
Assis sur le talus de terre rouge, en surplomb du port, le quai vibrant de chaleur déjà, dans le matin, nous sommes venus au bord de l’Italie. Statio, au bord de tomber, s’essaye au vide, voit si cela lui va, le vide, comme un vêtement neuf.
Il relève encore la tête, yeux mi-clos, cette fois, pour se protéger de la lumière, échoué là, avec son impossible amour d’Octobre, qui l’a quitté. Au nord, de l’autre côté, dans le prolongement de la pierre grise du quai, un ponton de bois, ses pilotis tout noirs et striés de sel, les mouettes, vous savez, et le feu blanc du soleil dilaté. Ce matin, sa lumière blanche est un peu lasse.
Il faut retenir sa vie, Statio, on ne peut pas tomber là tout seul dans le matin, se soustraire comme ça à son souffle, là devant la mer, jusqu’à devenir le point inaccessible, l’inachevé. Il faudrait revenir à la vie.
Mais, rien que d’être là, il n’y accède pas, à cause de la fatigue, de la nuit dans sa tête qui l’en empêche, du brouillé de mots, rien n’est solide. De l’absence d’Octobre. Aussi, vous savez, cette difficulté d’arriver quelque part, d’arriver maintenant aux rochers violets dans la lumière blessante, à la cabane en bois près du ponton, au trou de terre rouge que deux pierres arrachées sur le quai, au sable un peu plus loin au-delà du ponton et de la cabane, à la mer, la chaleur, d’arriver à quelque chose plutôt que rien.
Il faudrait respirer, Statio, et, les yeux soumis à l’éclat de la lumière, que sa bouche commence de sourire, devant le matin blanc de la mer. Voilà, Statio, c’est commencé, là, et habite nos yeux. Pas de terre, pas de pays, juste là où nous sommes, y être vraiment. Dans le matin, au bord de l’Italie, nous arrivons, Statio.
Il se penche encore, toujours avec ce voile du visage, cette ombre qui lui tombe du front quand il se plie vers ses genoux. Près de lui, son sac dodeline à peine en équilibre sur l’herbe brûlée du talus.
Soudain il se lève.
Raffut des mouettes au passage dans le ciel désormais effiloché, d’où s’extrait l’outremer du ciel, qui vous arrive de face. Statio est très grand, grandi encore par la puissance de son vêtement presque noir et la douleur d’avoir perdu Octobre. Ses joues se plissent dans l’éclat de la lumière. Il n’y pensait plus à Octobre, jusqu’à ce moment du venir, l’effort pour essayer d’être là, et que la mer vienne aussi, il n’est pas jusqu’à la poussière qui ne nous le demande. À cet instant d’une vie, au milieu du chemin d’une vie, quand il sortait d’une forêt obscure où il s’était trouvé, la voie droite surgissait. La pierre qui roulait du talus jusqu’au quai, le port où s’entrechoquaient des bateaux de laque blanche, la chair rosée des rochers dans la lumière, tout semblait nous attendre. Amo et Sapia aussi, les amis qui habitaient l’île en face, Gira, et que nous venions chercher avec Statio, sans qu’ils ne nous aient rien demandé. En détail, je regardais, un repérage de toute une vie. Une retraite du monde, Statio, il faut peut-être essayer.
Et volte-face du regard, ce que c’est le monde, ce matin-là : la mer en avant, les coques si blanches que la moindre ombre changeante s’y imprime émeraude, le ponton, les mouettes, les amis là-bas dans l’île, tout si difficile, beaucoup plus que de crier contre. Même peut-être je pourrais me tromper de regard, voir le vide où il n’est pas et ignorer la splendeur.
€ 18.00