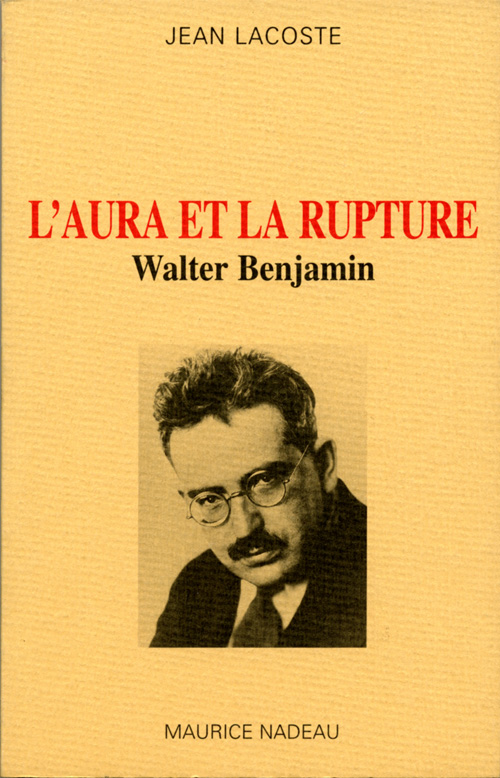L'aura et la rupture - Walter Benjamin
Aujourd'hui, Walter Benjamin - penseur secret, stratège de la critique, écrivain en exil, intellectuel minutieux, collectionneur de citations - apparaît plus que jamais comme une figure majeure du XXe siècle. Jean Lacoste a réuni les textes qu'il a consacrés au cours des vingt dernières années à cet écrivain de la ville et du livre. 253 p. (2003)
Extrait
Avant-propos
« C’est une idée poétique d’avoir indiqué les ruines d’un monde naissant. » Gérard de Nerval, « Diorama. Odéon », L’Artiste, 15 septembre 1844
Panorama des passages
On ne traduit pas impunément Walter Benjamin. Les textes fort divers — articles, recensions, études, conférences, préfaces — qui sont ici réunis autour de la figure de cet écrivain allemand en portent témoignage. Ils tentent d’offrir, en six tableaux, un panorama de son œuvre.
On ne traduit pas impunément Walter Benjamin, en effet, on n’assume pas, dans son cas, la « tâche du traducteur » sans s’exposer à certains effets, à certains périls, à certaines fantasmagories, et il fallait sans doute quelque inconscience pour, dans les années soixante-dix, entreprendre la traduction de deux textes aussi dissemblables que Sens unique et Enfance berlinoise (Lettres nouvelles, 1978), puis aborder la théorie benjaminienne de la modernité avec Charles Baudelaire (1979, Payot), avant, enfin, d’affronter l’énorme Passagen-Werk, l’œuvre inachevée, hybride, fragmentaire, énigmatique, intitulée en français Paris, capitale du XIXe siècle (Editions du Cerf, 1989), l’œuvre « incommensurable », l’« épave en ruines » — pour reprendre les formules que Goethe applique à son Faust. Il fallait tenter de rester fidèle à la tonalité proustienne des images rescapées d’une enfance bourgeoise dans le Berlin de 1900 comme au kaléidoscope surréaliste de la rue ouverte dans Sens unique. Il fallait aussi mettre ses pas dans ceux de prédécesseurs comme l’historien d’art Jean Selz, qui avait travaillé avec Walter Benjamin lui-même, à Ibiza, dans l’été 1932, à une première version française de certains textes d’Enfance berlinoise, et Maurice de Gandillac, qui avait effectué, dans sa traduction pionnière des Lettres Nouvelles (Mythe et violence, Poésie et révolution, 1971), des choix qui s’imposaient à ceux qui, après lui et grâce à lui, découvraient ces notions — par exemple celle d’Erlebnis, traduite par « expérience vécue » ou celle, opposée, d’Eingedenken, de « remémoration ». Il fallait tenir compte aussi des propres textes de Benjamin sur la traduction, ou plutôt oser ne pas tenir compte de sa théorie si singulière, si mallarméenne, de la traduction, telle qu’il l’avait exposée dès 1923 dans sa propre version des « Tableaux parisiens » de Baudelaire — « la traduction doit bien plutôt, amoureusement et jusque dans le détail, adopter dans sa propre langue le mode de visée de l’original, afin de rendre l’un et l’autre reconnaissables comme fragments d’un même vase, comme fragments d’un même langage plus grand » — en essayant, au contraire, de s’effacer devant l’évidence d’une prose sans poncif. Il fallait de surcroît s’exposer à des querelles aux enjeux multiples, esthétiques, politiques, voire théologiques, tout en traduisant des textes dont le statut et l’organisation, l’ordre même étaient contestés et sujets à révision. Je rappelle ici même, dans « Enfance et technique chez Walter Benjamin », le destin singulier d'Enfance berlinoise et, dans la « Préface à Charles Baudelaire », l’arrière-plan idéologique de la controverse au sujet de ce projet de livre. On sait en outre que le classement des papiers de Paris, capitale du XIXe siècle, tel qu’il fut retenu par Rolf Tiedemann pour son édition du Passagen-Werk en 1982, et repris par la traduction de 1989, fut vivement critiqué, sans qu’il soit possible de mettre fin à cette controverse par un manuscrit définitif.
Pourtant, de tout cela, de ce travail de près de quinze ans, de toutes ces difficultés spécifiques, de ces traverses, et de ces interrogations, il ne reste rien dans la mémoire, si ce n’est le souvenir du plaisir pris à ciseler la prose d'Enfance berlinoise — en trois versions successives ! — et à rechercher dans les volumes de la Bibliothèque nationale de la rue de Richelieu l’original des citations reprises dans Paris, capitale du XIXe siècle, en ouvrant la page même qui avait été recopiée par Benjamin, en lisant à loisir les alentours de la citation retrouvée. Mais un plaisir qui, à l’époque, ne se comprenait pas, pour le traducteur, comme je le rappelle dans le premier texte du présent recueil (« Pour entrer dans les Passages »), sans des flâneries et des Wanderungen, des « randonnées », des visites et des explorations dans le réseau « réel » des passages et des rues du Paris de Benjamin - essentiellement les quatre premiers arrondissements —, dans un va-et-vient sentimental ou fétichiste, mais productif, entre les livres et les lieux, entre les « seuils » ornementaux de la ville et les illustrations des éditions rares, entre les rencontres et les citations, entre le Paris des livres et celui, fort changé, et pourtant reconnaissable, du XIXe siècle. Passage des Panoramas, passage Jouffroy, passage Verdeau, galerie Véro-Dodat, passage Colbert, galerie Vivienne — sans parler du discret et plutôt déprimant passage du Désir —, ces noms alors oubliés se sont chargés, au fil des promenades, d’une puissance nouvelle d’évocation. Transfigurés par le souvenir de Benjamin, mais aussi d’Aragon, de Breton, et de Céline, ils se sont imprégnés d’aura. Tant il est vrai que l’exercice, linguistique ou littéraire, de la traduction finissait, en l’occurrence, par modifier le regard que l’on portait sur les choses et les livres, sur la vie quotidienne, les jouets, les collections, les affiches, les vitrines, les commerces, les signes et les signaux de la ville, et toutes les inventions de l’optique moderne. Benjamin lui-même avait évoqué cette expérience de l’entrecroisement dans « Paris, la ville dans le miroir », en parlant de cette ville comme de la « grande salle de lecture d’une bibliothèque que traverse la Seine ».
€ 20.00