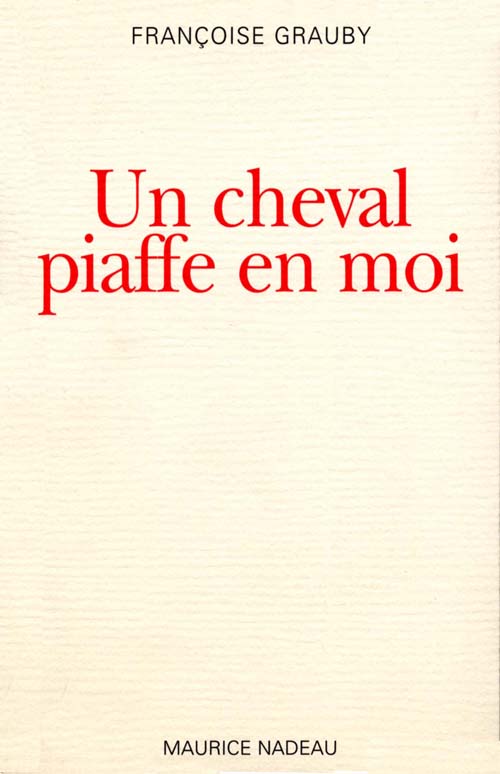Un cheval piaffe en moi
Dans un petit collège de l'Est de la France, une jeune enseignante se morfond. Isolée au fin fond d'une province revêche, où gens et paysages sont pareillement gelés, elle s'interroge : où est la liberté qu'elle s'était promise ? où sont les joies de la profession ? Dans ce roman de combat et d'illusions retrouvées, l'auteur nous fait assister à une rédemption, celle d'une vie sauvée par l'imagination et l'écriture. 223 p. (2004)
Auteur de plusieurs ouvrages critiques, Françoise Grauby enseigne la littérature française en Australie. Elle est l'auteur de deux ouvrages de critique littéraire, La Création mythique à l'époque du Symbolisme (Nizet) et Le Corps de l'artiste(PUL). Elle a publié en 2007 "Les îles" aux Éditions Maurice Nadeau.
Extrait
J’ai voulu écrire tant...
J’ai voulu écrire tant de fois cette histoire que le désir se perd dans la nuit des temps. C’est qu’elle est à la fois simple, trop simple (les aventures d’une jeune prof qui débarque dans une région inhospitalière — les bras m’en tombent) et compliquée (toutes ces choses à raconter, les circonstances, les faits, les personnages). Au fond, il n’y a pas grand-chose, au fond, il n’y a rien.
Sans doute aussi mon ambition, lorsque je m’installais pour l’écrire, était démesurée, effrayante. Paralysée d’avance par la tâche à accomplir : parler du passé, parler de ce temps. Que dire qui n’ait déjà été entendu mille fois ?
Or, chaque fois qu’il fait gris et qu’il pleut, ça ne rate pas, je me revois là-bas, dans ce trou, cet abominable trou, ce bout du monde où je n’ai pas demandé à aller mais où des directives venues d’en haut m’ont forcée à m’installer, ce trou, cette zone, seule, je n’y connais personne, et je dois y vivre, c’est-à-dire y prendre un logement, y faire mes courses, y travailler, y rencontrer des gens, m’adapter à un nouveau rythme, découvrir de nouvelles rues, une nouvelle ville et il pleut tous les jours, le bruit de la pluie, une énurésie constante, une incontinence générale, il fait gris tous les jours, je m’ennuie, l’hiver il neige et je mange, le matin, je me lève, il fait encore nuit, le soir, je rentre, c’est déjà la nuit. Où sont passées les heures ? Où sont passées les années ?
Pourtant, ce départ vers le pays du fer, si je me souviens bien, je l’ai fait dans la joie. La joie de la découverte. Une attente impatiente, soudaine, une envie de partir.
Au début, souviens-toi, il n’y avait que cette impatience et cette phrase dans ta tête : « Tout recommence. » Phrase qui te suit partout et tous les trois ans, pendant des années, tu vas mettre les voiles et « tout recommencer ». Tu es dans ta voiture sur l’autoroute de Nancy, seule, tu vas te trouver un hôtel pour la nuit, tu as vingt et un ans, souviens-t’en bien, tu exultes et le genre d’ivresse qui t’étreint est celle des grands espaces à explorer.
C’était mon premier vrai déplacement toute seule et il fallait monter toujours plus haut. Vers Lyon, puis la Bourgogne, en 2CV et, lassée des steaks-hachés-frites des restoroutes, je me promis une quiche aux lardons épaisse et crémeuse à l’arrivée pour me réconforter de ce long périple, seule dans la voiture au bruit de casseroles.
Je ne savais pas où me diriger, je ne connaissais rien et le premier hôtel que je vis, je le pris. C’était au bord d’une grande route. J’étais si épuisée et excitée qu’aussitôt après la quiche, avalée froide en marchant dans les rues mouillées, je ne dormis pas plus d’une heure dans ma chambre à un lit qui donnait sur l’artère la plus fréquentée de la ville.
Le propriétaire avait cru bon de faire un jeu de mots avec mon nom de famille et j’avais rougi — allons bon, mauvais départ, ça commence (il y avait là la promesse de générations d’élèves qui allaient me l’estropier, mon nom, en faire des boulettes, y ajouter des syllabes, me le recomposer, l’anarchiser, me refaire une identité, j’allais devenir un surnom qui fait rire) — mais enfin j’étais maintenant le genre de personne qui vit seule en terre étrangère et qui allait devoir se débrouiller en toutes circonstances. J’étais à présent une adulte qui part travailler dans un nouveau pays.
Oui. Il pleut quand tu arrives mais tu exultes. Tout est neuf, à faire, à prendre, à apprendre. Et c’est la joie d’être seule et libre enfin qui t’étreint.
Quelques mois auparavant, mon grand-père était mort.
À Londres où j’étais partie avec ma sœur, sitôt après l’enterrement, le temps était gris et les rues grasses de pluie. Malgré le chagrin, je riais au YMCA de Walthamstow de ce cortège que nous traînions partout, des Indonésiens, des Singapouriens, des Pakistanais et des Libanais, tous inscrits dans quelque université de technologie des quartiers industriels, qui nous emmenaient danser sur My Baby takes the moming train ou Emotional Rescue, nous offraient des fish and chips et des kebabs - heureusement d’ailleurs nous n’avions plus un sou vaillant -, le gros Numb, le petit Tim, Budhi et ses bonnes joues, le sémillant Reza avec sa moustache gominée (toi, Marie, c’était Nasser qui te plaisait), ils nous promenaient partout, jusqu’à Brighton. Budhi disait que tu ressemblais à Tess d’Uberville ou plutôt à Nastassja Kinski que Polanski avait filmée dans ce rôle. Tu te souviens de la promenade sur la jetée, le Pier, que les artistes victoriens ont tant aimé peindre et la galerie des miroirs déformants qui font une grosse tête et des pieds riquiqui ? C’est là que Reza m’a prise dans ses bras après m’avoir posé une question du genre : est-ce que dans votre pays aussi il y a des blagues sur les bananes ? Et il m’embrasse. Et effectivement je ne sais pas si je dois rire, pleurer ou être amoureuse, c’est un bel Iranien en tout cas.
Et pourtant, malgré les rires, les blagues et les aventures sentimentales, je suis en pleine déprime, je ne pleure pas, je halète, combien de soirs me suis-je endormie gonflée au Temesta ? et cette visite atroce à Saint-Paul ou Westminster, je ne sais plus, où pendant un moment j’ai cru que les gisants de pierre me dégringolaient dessus et que je tombais dans un trou noir, le goût du marbre dans la bouche...
Mais la ville où je viens d’être mutée n’est pas Londres et si Reza m’écrit sa seule et unique lettre de sa grosse écriture d’étranger, je sais qu’il est loin et que je ne le reverrais plus. Et la pluie ici est vraiment, irrémédiablement, triste, et la grisaille du pays contient toutes mes humeurs mauvaises dans ses nuages pommelés et le métal du ciel. Je passe les premières heures du jour la tête enfouie dans une nuée de mouches. Ici tout est noir et tout conspire à le rester.
€ 18.00