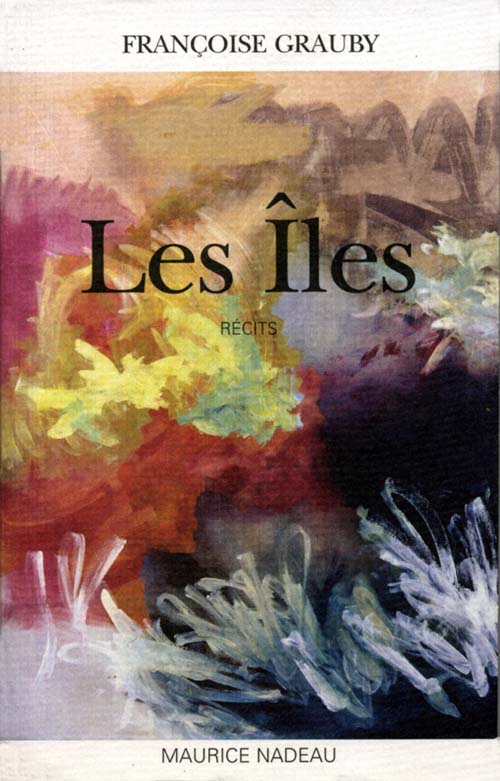Les îles
Une jeune artiste peintre débarque en Nouvelle-Calédonie. Mais à peine le pinceau est-il en main que la toile se met à bouger : l'île gronde, les autochtones se révoltent, des gens se battent, d'autres s'enfuient... En six volets, elle raconte son itinéraire : l'expérience du déracinement, les violences de la guerre civile, le chassé-croisé des vies, la passion, la peinture, et surtout l'histoire d'une vocation. L'existence et les îles au bout du pinceau. 268 p. (2007)
Auteur de plusieurs ouvrages critiques, Françoise Grauby enseigne la littérature française en Australie. Elle est l'auteur de deux ouvrages de critique littéraire, La Création mythique à l'époque du Symbolisme (Nizet) et Le Corps de l'artiste (PUL).Elle a publié en 2004 Un cheval piaffe en moi aux Éditions Maurice Nadeau.
Extrait
Si c’était un livre, ce serait des carnets de voyages et d’esquisses reliés par une couverture souple, ornée d’une perle de corail rouge.
S’il y avait, flottant au-dessus du livre, une présence, un fantôme, ce ne pourrait être qu’elle, ma mère.
J’ai mis le doigt dessus, me voilà prise, il faut continuer.
Si cette histoire était la mienne, je serais cette fille qui, à 23 ans, avait quitté sa mère, sa province, son pays, pour aller vers les îles. Peindre-voyager, voyager-peindre, c’est tout ce qui l’intéressait. Gouaches éclatantes, couleurs passées au peyotl, costumes, plumes et parures, elle en ramènerait d’immenses et riches toiles. Gustave Moreau ! Raoul Dufy ! Marc Chagall ! (Déferlement de couleurs, bouffées d’imaginaire.)
De sa mémoire, la mère, elle, ramènerait cette scène : au volant d’une vieille 4L, conduisant sous la pluie sa fille dans un hypermarché de la Côte atlantique pour acheter des cantines en fer-blanc, elle vient de comprendre que sa fille doit partir le plus loin possible, vers ces îles et ces îlots de bouses sèches et dures comme celles des vaches sacrées. C’est ça ou l’asile psychiatrique.
Et donc l’artiste était partie sans se retourner. Et ma mère — car c’était elle — entama un long calvaire : celui de savoir en quel point du monde j’étais tombée pour y être malheureuse comme les pierres.
Je l’entends encore, sa voix, à l’autre bout du fil ; elle traverse la planète, fait le tour du monde, survole la Russie et la Chine, glisse sur les mers et les banquises, plonge et remonte pour chercher l’air et arriver jusqu’à moi, qui n’écoute pas.
Catherine, où es-tu ? A ton âge, sans but, sans métier, sans patrie, sans argent. Toujours entre deux mondes comme une éternelle errante, loin de ton pays, sans savoir d’où tu es ni ce que tu veux. Ta vie ? Un jeu jamais achevé, celui de l’élastique. Tu t’éloignes, tu reviens, tu repars, tu quittes tout sans dire au revoir, attention, te revoilà. Ce jeu te tient en haleine, mieux que le Mikado, que le Monopoly, c’est plutôt ce jeu abrutissant qui s’appelle le Jokary. Une raquette et une balle retenue par un élastique ; on l’envoie au loin, elle revient toujours, aimantée, se cogner à la raquette en faisant un ploc lugubre puis s’envole pour rebondir ailleurs.
Catherine, que vas-tu devenir ? Et quand reviendras-tu jouer au bilboquet dans le jardin ?
(Ici, une pause. On pourrait croire que je suis devenue une artiste, un peintre célèbre, que je vis dans le luxe, que, cotée en bourse, ma signature donne de la valeur aux toiles, qu’on expose mes œuvres à Beaubourg, au Metropolitan de New York, coup de projecteur, la lumière m’aveugle, qu'Art press s’en est emparé par ces mots : « Les étonnants répertoires d’images de Catherine S., assemblages de coupures de presse, de photos, de dessins et de textes, renvoient aux lignes mêmes et à la texture du papier suturé comme une peau ». On verra qu’il n’en est rien, heureusement rien. Sans argent. Ma mère avait raison.)
Là-bas, j’ai fait ce que j’avais à faire. J’ai voyagé. J’ai peint. Les murs de ma maison, des frises, des fresques. Collé et cranté des bouts de papier, des tissus, des textes, cassé des mines, crevé des tubes, barbouillé des livres, brûlé mes pinceaux par les deux bouts. Quoi d’autre ?
Ces carnets, ce sont des souvenirs de rien, reliés les uns aux autres par un mince raphia, celui de ma vie, comme ces restes d’aqueducs, ces ombres d’amphithéâtres, ces fantômes de palais, de statues, de jardins, de maisons, dont il ne reste que ruines et débris, il faut en convenir.
Alors.
Puisque tout fuit, les enfants comme les rêves de gloire, tournons-nous vers le papier pour le rendre à sa nature fibreuse. Prélevons-le au paysage, à la terre, à l’eau. Incrustons-le d’herbes et de granules. Passons-le au jus de citron ou au brou de noix. Plongeons-le dans l’eau de mer, enterrons-le dans le sable et forçons sa tombe quelques jours après.
Son aventure peut commencer. Écoutons ce qu’il a à nous dire.
Ceci : comment apprenons-nous ce qui n’est pas inscrit dans nos gènes si ce n’est par ces traces mouchetées qui y adhèrent ? Nous descendons, main dans la main, la même pente. Et aussi : des forces sans nom ni visage nous soulèvent, nous gonflent et nous pressent comme du papier. Écarlates ou exsangues, charbonneuses ou laquées, nos natures mortes à la cruche, aux anguilles et aux marrons d’Inde figurent le vélin sur lequel elles ont été exécutées et les pigments qui nous agrègent.
Si c’était un livre, ce serait des liasses de papier tatoué, reliées par une couverture souple, périssable, ornée d’une perle de corail.
Si c’était une artiste, ce serait une artiste de papier.
Si c’était
Bon. Ceci est réglé. On peut commencer maintenant ?
€ 20.00