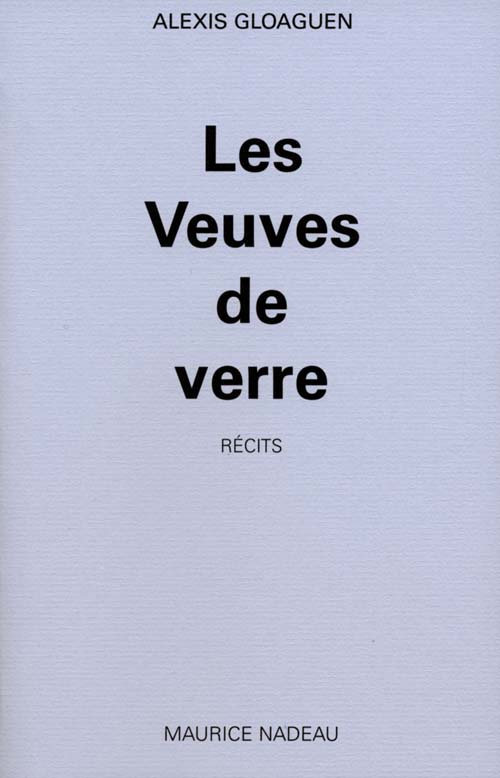Les Veuves de verre
Les Veuves de verre est une série de récits écrits lors de voyages professionnels au Canada et aux Etat-Unis. Découverte de villes de toutes tailles, des mégapoles aux plus modestes, et fascination qu’elles inspirent dans une approche poétique et le souci du reporter. Merveilles architecturales que sont les tours de verre et d’acier, inquiétude engendrée par un monde dévolu au pouvoir économique et dont la poésie est absente. Attirance, mystère, malaise parfois. Découvertes qui s’apparentent à l’expérience de l’écriture poétique. Dans le voyage la réalité se mêle au rêve, tandis que pour le lecteur éclate la révélation d’une écriture.
Alexis Gloaguen, né en 1950 dans le Finistère, enseigne la philosophie et voyage aux Cornouailles, en Écosse, écrit et peint. En 1992, il part avec sa famille à Saint-Pierre-et-Miquelon diriger le nouvel institut de langue française tourné vers le Canada et les États-Unis.
Extrait
Une vedette rapide incise l’eau et croise le sillage invisible de l’avion en sa descente. Les montagnes se dissolvent de plus en plus haut sur l’horizon.
La baie de Vancouver est tendue par la terre qui l’isole comme un ovale de reflets. Chaque néon pique la ville de couleurs imprévues dans le soir pâle.
Bientôt paraît l’île, fourrure d’épinettes de Sitka sur une eau soudain plus noire. Un foisonnement de rocs arborés s’affirme dans le silence des rives sans vagues. Et c’est l’éclaircie d’un fond de sable, écorchée par le train d’atterrissage du Dash 8 — qui sort et semble exercer son intention sur la mer.
Non loin d’ici, Malcolm Lowry donna vie à ses plus beaux textes.
Au fond de l’avion, clandestin derrière les hommes d’affaires, je savoure ce passage si bref vers l’île de Victoria. Long d’une dizaine de minutes, au point qu’il fut nommé « vol d’une cigarette", il s'impose comme le moment opportun de l'écriture.
Aujourd’hui, visitant le musée de Colombie-Britannique, à Victoria, je me retrouve cloué devant l’art des Indiens de l’île de Vancouver. Ces collections de choses mortes en apparence livrent des témoignages poignants : masques à demi brûlés dans un geste de désespoir ou de reniement, à l’arrivée de l’occupation blanche. Après des dizaines de salles, j’avance titubant. La charge de sacré, en ces objets qui nous regardent et nous provoquent, est aussi forte que lorsque — totems — ils étaient dressés au bord des forêts, caressés par l’air libre et la ferveur des cultures Kwakiutl, Tsimshian et Salish de la côte.
Des chants passent entre les aigles ithyphalliques, les crabes articulés, les visages aux dents longues, montés sur piquets dans la « grotte des Pouvoirs ». Tout relie ces lignes faciales rouges, blanches et noires, ces fausses têtes tranchées que l’on faisait saigner durant les danses, ces carcasses d’orques à taille humaine dans lesquelles entraient des Jonas marionnettistes. Un magnétisme les entoure et crépite, nous saisit et nous réunit au plus vaste univers. Beaucoup de ces objets sont formés autour d’un trou rond : la matrice du monde, la bouche ouverte de la baudroie, l’œil qui marque la dorsale de l’épaulard — portée haut et traçant sa voie dans la vague —, le dernier regard à la vie aussi bien que le ventre de la femme, adapté à la tête qui va en sortir...
Masques et totems fulgurent. Pour les Indiens de la côte, les frontières étaient irréelles et les mondes perméables. Les oppositions, en apparence tranchées, du visible et de l’invisible se dissolvaient au sein de « l’univers du corbeau ». L’animal et l’homme, une saison et la suivante, le réel et l’imaginaire, la vie et la mort, lors d’arrêts du temps pouvaient s’indifférencier. Et l’hiver était par excellence le moment où le mystère venait ressurgir de ce côté-ci. Car c’est la saison du milieu, celle où dans l’impondérable s’opèrent les passages, où les contrastes s’estompent, quand les nervosités s’apaisent et les désirs suspendent leur souffle, laissant la nature dans un silence de plans gris et d’arbres noirs sous la neige et l’incolore du ciel.
€ 17.00