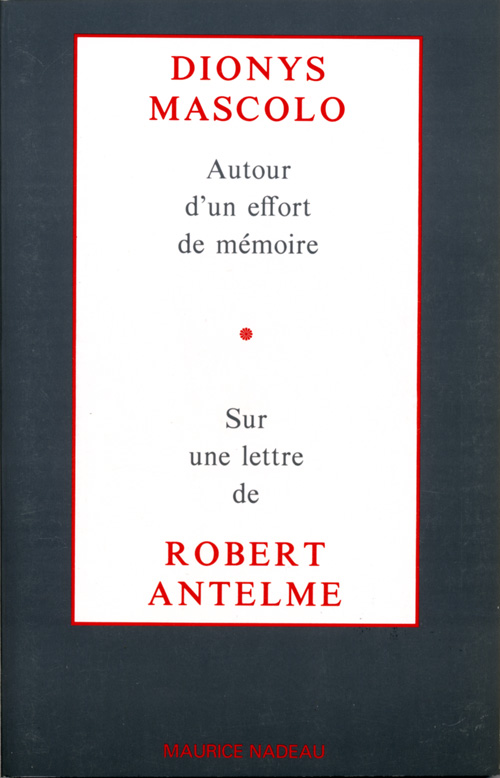Autour d'un effort de mémoire.
De retour des camps, Robert Antelme décrit son état mental à son ami Dionys Mascolo qui l'a accompagné dans son rapatriement. Mascolo relate ce retour et commente la lettre. Robert Antelme devait publier peu après L'espèce humaine. 96 p. (1987)
Extrait
I
C’est après une longue et pénible hésitation que je me décide à rendre publiques les paroles que Robert Antelme m’adressait en juin 1945. Et cela moins par l’effet d’une décision libre qu’au terme de l’un de ces débats que l’on dit de conscience, où sont en jeu plutôt d’instables valeurs, entre courage et lâcheté, pudeur et complaisance, qui ne font que se fortifier les unes des autres tout le temps qu’elles se combattent pour cesser à la fin d’être discernables, et donner lieu à quelque résolution en forme de fuite en avant. Laquelle, bien entendu, ne résout rien, en conscience du moins.
Je n’ai donc fait que céder pour finir à la pression d’une nécessité si forte (ne pas laisser cela se perdre, ne pas le garder pour moi) qu’auprès d’elle mes répugnances les plus vives et jusqu’à la discrétion due à la personne de l’ami en venaient à paraître négligeables, et peut-être mesquines. Les réserves n’en sont pas moins fondées, l’indiscrétion certaine. Avoir « fait taire » ses scrupules pour qu’un pas soit franchi ne libère pas d’avoir à les faire parler, ces scrupules, qui demeurent. D’autant que même tus, ils risquent encore d’éclairer, de biais, ce qu’ils n’ont su empêcher d’être dit.
*
Les obstacles qui s’opposaient à la décision simple de publier cette lettre étaient nombreux et divers. Certains semblaient même l’interdire. Des amis avaient beau m’exhorter à les surmonter, au nom du combat qu’il faut en tout cas mener contre le silence et l’oubli. La lourdeur bien prévisible de l’explication, indispensable s’il était passé outre, s’ajoutait aux autres empêchements pour décourager tout à fait. D’où le long atermoiement dont je dois aussi m’accuser...
*
Sur le pourquoi de tant de précautions, ceci d’abord. Le consentement de Robert à cette publication ne lui a pas été demandé. Il n’était pas juste de l’obtenir de lui. Immobilisé depuis l’été de 1983 par un accident cérébrovasculaire, atteint de cet « oubli à mesure » ou « amnésie antérograde » qui laisse intacte la mémoire ancienne mais frappe le passé proche (de sorte qu’il pourra prendre connaissance de ceci mais que nous ne pourrons pas ensuite en parler) il reste identique à lui-même, reconnaissable en tout. Sa bienveillance est la même, ses pudeurs sont les mêmes. Son rire est le même. Il offre ainsi l’image inépuisablement énigmatique d’une présence qui, libre de tout calcul ou projet, de toute prévision, de toute attente même, ne serait plus sujette à la durée : notre durée. Présence entière et tout entière suspendue — qui jetterait à l’imagination d’une sorte de présent absolu, comme nous n’en avons d’expérience et ne sommes capables d’en recevoir le don que de certaines heures du monde naturel.
Dépouillé de la sorte, devenu dans toute sa personne, sans que rien d’essentiel y fasse défaut, son propre symbole, sans aucune de ces altérations défigurantes qui tiennent à la psychologie, on le dirait seulement saisi d’un détachement supérieur, étendu à tout, l’amitié silencieuse ou légère exceptée. N’attendre plus, n’attendre plus d’apprendre ce qui arrive, de quelle sagesse serait-ce donc être atteint ? Et en effet, nous aurons été quelquefois tentés de croire, de façon très impressionnante, qu’il avait choisi de ne plus s’intéresser à rien de ce à quoi il nous voyait continuer à nous intéresser devant lui, nos « raisons de vivre ». (A plusieurs reprises, aux questions précises par lesquelles je tente de sonder son détachement, j’obtiendrai de lui en réponse : « Ce n’est pas exaltant. ») Trompeuse consolation, d’ailleurs non consolante à s’y tenir, qui noierait le malheur dans un ennui qu’il faut laisser à la duplicité divine (le double jeu qui dit l’ennui double de Dieu) — privés que nous serions alors de lui par sa présence même.
Il me pardonnera d’avoir ainsi disposé de lui, et choisi de paraître cruel, plutôt que d’être évasif.
*
Cette difficulté non pas surmontée, mais ce parti une fois pris, restait à décider s’il fallait publier cette lettre sans commentaire, la laissant parler, ou l’accompagnant de la seule relation du retour depuis le camp, ou si, pour faire paraître le supplément de sens tout à fait inattendu que j’étais amené à lui voir en la redécouvrant, il ne fallait pas plutôt (au risque d’ailleurs de sembler perdre de vue le principal) :
1. la replacer dans le contexte où s’était nourrie cette parole, et qui peut-être la rendait possible ;
2. surtout, mettre en valeur son sens le plus profond et le moins apparent, à savoir ce qu’elle annonçait du futur, et qui s’est vérifié.
Ce qui était déjà interpréter, et non plus seulement témoigner. Mais comment l’éviter, si le souci d’observer une réserve peut-être illégitime conduisait sûrement au danger de réduire la portée de cette parole, et à laisser de surcroît une part d’obscurité la recouvrir (puisqu’il s’y rencontre des propositions de nature allusive, ou « personnelles », comme venant en réplique) ? tient lui-même en des paroles dont celui qui parle maintenant se veut le témoin. Comme de coutume, dira-t-on. Oui, certes. Ne serait toutefois qu’ici, fait unique, l’ineffable désigne non pas ce que lui, témoin maintenant, se fût entendu dire (lui être dit), mais bien ce qu’il s’était, dans son transport, activement entendu dire lui-même : et dire à d’autres - ou nous dire. Il est lui seul l’oracle de la parole dont il se fait l’écho à ce moment.
*
L’oubli
Ici intervient l’oubli. L’obstacle (ou l’aide) de l’oubli.
Je n’avais en effet gardé aucun souvenir de cette lettre, que je n’avais de toute évidence pas pu ne pas lire en son temps. A ma surprise et, tout d’abord à ma honte, je n’en ai donc véritablement pris connaissance que récemment, la redécouvrant, comme je viens de dire, et presque par hasard, sollicité que j’étais de retrouver quelles traces précises, ou matérielles (non de simple mémoire en tout cas) j’avais pu conserver de ce qu’avait été le retour au monde du plus cher des amis, et cela dans le souci somme toute anecdotique de vérifier les témoignages, non contestables, mais parfois hâtifs, qui venaient d’être rendus publics sur ce moment de notre vie (Marguerite Duras : La Douleur, et aussi Entretien avec F. Mitterrand, dans l’Autre Journal, février 1986).
Voici cette lettre.
Mon cher Dionys
Je vais essayer de t’écrire quelques lignes, c’est-à-dire d’accomplir mon premier acte de vivant « solidifié » — car j’ai déjà accompli de nombreux actes de vivant, j’ai notamment pleuré, et les larmes sont aussi loin que possible de la mort — ; c’est à toi que j’écris le premier car je veux que tu puisses entretenir en toi, peut-être quelque temps de plus, le merveilleux sentiment d’avoir sauvé un homme; je dis quelque temps, car autant le « sauvé » garde éternellement devant lui l’image du sauveteur, autant le sauveteur a tendance à voir s’estomper celle de son acte et même à banaliser le sujet qu’il a arraché au mal. Ainsi mon cher D. sommes-nous en quelque sorte maintenant complètement séparés; nos consciences — de l’un à l’autre — ne pèsent plus le même poids, il y aura toujours un peu d’impudeur dans mes yeux, dans mes mots; tu tâcheras de ne pas voir.
Je voudrais te dire d’autres choses sur ce sujet qui me paraissent importantes, mais je m’aperçois que je cours un assez grave danger : D. je crois que je ne sais plus ce que l’on dit et ce que l’on ne dit pas. Dans l’enfer on dit tout, ce doit d’ailleurs être à cela que nous, nous le reconnaissons; pour ma part, c’est surtout comme cela que j’en ai eu la révélation. Dans notre monde au contraire on a l’habitude de choisir et je crois que je ne sais plus choisir. Eh bien, dans ce qui chez d’autres représentait pour moi l’enfer, tout dire, c’est là que j’ai vécu mon paradis; car il faut que tu saches bien D., que pendant les premiers jours où j’étais dans mon lit et où je vous ai parlé, à toi et à Marguerite surtout, je n’étais pas un homme de la terre. J’insiste sur ce fait qui me hante rétrospectivement.
D’avoir pu libérer des mots qui étaient à peine formés et en tout cas n’avaient pas de vieillesse, n’avaient pas d’âge, mais se modelaient seulement sur mon souffle, cela vois-tu, ce bonheur m’a définitivement blessé et à ce moment-là, moi qui me croyais si loin de la mort par le mal — typhus, fièvre, etc., — je n’ai pensé mourir que de ce bonheur. Et maintenant, je recommence à donner une forme aux choses; du moins mon esprit et mon corps essaient-ils, mais je te le répète, je pense que je ne sais plus choisir. Il y a donc sûrement dans ce que je dis, des vulgarités énormes et ce que tu appelles avec ton rire, une invraisemblable « tyrannie ». Alors, va-t-il falloir que je me « reclasse », que je me rogne, que l’on ne voie de nouveau qu’une enveloppe lisse ? Tu vas me dire que je parle un mauvais langage et que la meilleure huile est celle qui révèle mille aspérités sans cesser d’être huile. En réalité, je crois que le problème que je pose est pourtant un problème moral. J’ai le sentiment, que n’ont peut-être pas tous mes camarades, d’être un nouveau vivant, pas au sens Wells du mot, pas au sens fantastique, mais au contraire au sens le plus caché. De sorte que ma véritable maladie qui naissait si tendrement voici quelques semaines — elle était alors supportable — atteint maintenant sa maturité et devient très ingrate. Voici un appendice qui se développe, un esprit sans canaux et sans cases, une liberté en somme peut-être prête à se laisser saisir, peut-être aussi à annihiler les autres libertés, soit pour les tuer, soit pour mieux les embrasser.
Si l’on voulait donc voir se former un homme, on pourrait m’observer de près, en faisant la part du caractère morbide de la formation.
Je m’excuse d’insister là-dessus; cela doit t’être assez insupportable, à toi qui « continues », d’entendre parler un individu de son originale indétermination; je pense même qu’il y a là quelque goujaterie et tu auras raison de me répondre que dans quelques mois j’aurai cessé de renaître, que moi aussi je continuerai, et sans doute même sur la voie désaffectée que j’ai quittée il y a un an. Cela D., tu me le diras ou non, tu le penseras ou non, suivant que tu auras ou non quelque espoir en l’homme.
Tu es certainement l’un des seuls êtres dont je crains le plus la fatigue, je veux dire le désespoir. Il y en a que j’aimais beaucoup et dont le désespoir m’était indifférent, j’entends par là une sorte d’état définitif; je les laissais dans leur état ou je les remontais voluptueusement ou avec mal. Pour toi D. dont le désespoir ne doit cesser de se mêler de joie, de fugues et de haltes insondables, je ne pourrais supporter maintenant surtout que ce désespoir se fige et s’installe. Je t’ai dit que je n’avais pas peur et telle est ma seule peur. Si tu ris, si te moquant un peu de moi, tu me réponds que jamais tu n’as vu autant d’avenir, je te dirai que je me reconnaissais le droit d’avoir cette peur.
Je me suis arrêté là parce que ma main me faisait mal; je reprends ce matin mercredi. Il y a eu un superbe orage cette nuit et le parc est frais. Tu es venu dîner hier soir; j’aurais bien aimé que tu restes un peu plus longtemps avec nous. Mais je crois que je t’accapare un peu trop; maintenant, je n’en ai plus le droit, le mirage a cessé, je recommence à me ressembler; j’ai d’ailleurs une crainte, je dirai presque, une horreur de rentrer dans cette coquille; je ne pensais pas que le voyage infernal ou merveilleux finirait jamais (je parle de ces dernières semaines). Tous mes amis m’accablent avec une satisfaction pleine de bonté, de ma ressemblance avec moi-même, et il me semble que je vis à l’envers le « Portrait de Dorian Gray. » Il m’est arrivé l’aventure extraordinaire de pouvoir me préférer autre.
Mon cher D. jamais ne reviendront les moments où, tout maigre, je pouvais te dire tant de choses enfouies depuis un an, si riches, si solitaires d’avoir été préservées de l’ennemi et gonflées contre lui. Je t’ai déjà dit cela lorsque j’étais malade et je le répète plusieurs fois maintenant, parce que tout cela est bien mort et que si j’essayais de réveiller ces choses, je ne serais qu’une sale putain.
Je ne suis pas bien loin d’ailleurs d’en être une, mais je crois que ce n’est pas de ma faute et toute personne qui a vécu quelque chose d’extraordinaire court ce risque. En réalité, cela m’est égal et je n’y pense pas. La seule vérité est qu’une certaine dureté, je dirai même cruauté gagne en moi; chaque jour je vois mourir des sympathies, presque des affections et cela sans inquiétude. Tout n’aura pas été inutile et j’avance paisiblement dans une bonne solitude. Il me reste encore parfois un sentiment trop vif de l’horreur, mais sans doute bientôt tout cela sera-t-il aplani, neutralisé. Alors peut-être j’accepterai la ressemblance avec moi-même parce que je saurai qu’elle n’est pas; j’accepterai le portrait : il n’y aura plus de portrait.
Alice va à Paris; je lui remets ces feuilles. Je ne les ai pas relues entièrement, excuse-moi. Je continuerai sans doute parce qu’en te les adressant à toi, je n’ai pas trop l’impression de perdre mon temps.
Essaie si tu le peux d’y trouver plus d’objectivité, je souhaitais en mettre; cela m’étonnerait malheureusement.
Bien à toi Robert
Jeudi 21 juin 1945
€ 15.00