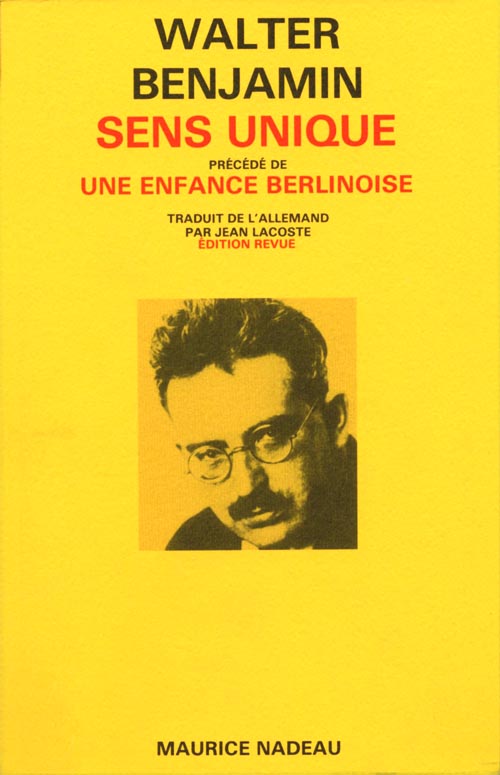Sens unique. Une enfance berlinoise
Sens unique précédé de Une enfance berlinoise.
Depuis la parution en 1971, aux Lettres Nouvelles, de deux recueils rassemblant, sous le titre Mythe et violence et Poésie et révolution, quelques-uns des textes majeurs de Walter Benjamin, l’intérêt des lecteurs pour cet ami d’Adorno n’a cessé de croître, en France comme à l’étranger. On se souvient que juif exilé à Paris en 1933, Benjamin avait traduit Baudelaire et Proust en allemand et leur avait consacré des études qui font aujourd’hui encore autorité. On se rappelle aussi qu’interné par le gouvernement Daladier en 1939 et refusant de partir aux États-Unis, il fut acculé au suicide en tentant, en 1940, de passer la frontière des Pyrénées. Dans ce nouveau recueil ont été rassemblés trois textes : Enfance berlinoise, parue dans les journaux entre 1933 et 1935, Sens unique, où Ernst Bloch voyait un « exemple de pensée universelle » ; enfin Paysages urbains, textes descriptifs et sociologiques sur quelques grandes villes. Traduit de l’allemand par Jean Lacoste. 318 p. 22 euros (1988)
Extrait
Ô colonne de la victoire, dorée comme un biscuit glacé par le sucre des jours enfantins
TIERGATEN
Ne pas trouver son chemin dans une ville, ça ne signifie pas grand-chose. Mais s’égarer dans une ville comme on s’égare dans une forêt demande toute une éducation. Il faut alors que les noms des rues parlent à celui qui s’égare le langage des rameaux secs qui craquent, et des petites rues au cœur de la ville doivent pour lui refléter les heures du jour aussi nettement qu’un vallon de montagne. Cet art, je l’ai tardivement appris ; il a exaucé le rêve dont les premières traces furent des labyrinthes sur les buvards de mes cahiers. Non, pas les premières, car avant elles il y eut celui qui leur a survécu. Le chemin de ce labyrinthe, qui n’a pas manqué d’avoir son Ariane, passait par le pont Bendler dont la douce courbure fut pour moi le premier flanc de colline. Le but ne se trouvait pas loin de son pied : Frédéric-Guillaume et la reine Louise. Dressés sur leurs socles ronds ils dominaient les plates-bandes, comme des apparitions appelées par les courbes magiques qu’un cours d’eau dessinait devant eux dans le sable. Mais plus volontiers que vers les souverains, je me tournais vers leurs socles, car les événements qui s’y déroulaient, même si le contexte en était obscur, étaient plus près de moi dans l’espace. Que ce dédale ait une signification, c’est ce que j’ai depuis toujours reconnu à cette large et banale esplanade qui ne trahissait par rien qu’ici, à quelques pas seulement du Cours des fiacres et des carrosses, dort la partie la plus étrange du parc. Très tôt déjà j’en reçus un signe. C’est ici en effet, ou pas très loin, que doit avoir tenu son camp cette Ariane auprès de laquelle, pour la première fois et pour ne jamais plus l’oublier, je compris ce dont je ne connus que plus tard le nom : l’amour. Pourtant à sa source déjà apparaît la “Demoiselle” qui se posa plus tard, ombre glacée, sur lui. Et ailleurs aussi ce parc, qui semble comme aucun autre ouvert aux enfants, était pour moi rendu méconnaissable par quelque chose de difficile et d’irréaliste. Il était bien rare que je réussisse à distinguer les poissons dans le Bassin des poissons rouges. Quelles promesses dans le nom de l’allée des Chasseurs de la cour, qu’elle tenait si peu ! Que de fois je cherchai en vain le bosquet où se cachait, avec des tourelles rouges, blanches et bleues, un kiosque dans le style de mes constructions de cubes ! Chaque printemps renaissait, toujours aussi désespéré, mon amour pour le prince Louis-Ferdinand, aux pieds duquel poussaient les premiers crocus et les premiers narcisses. Un cours d’eau qui me séparait d’eux me les rendait aussi inaccessibles que s’ils avaient été sous une cloche de verre. Avec quelle froideur fallait-il que ce qui est princier reposât dans le beau ! Et je compris pourquoi Louise de Landau, qui allait à la même petite école que moi, jusqu’à ce qu’elle mourût, avait dû habiter quai de Lützow, juste en face de l’endroit sauvage et solitaire qui confie le soin de ses fleurs aux eaux du canal. Je découvris plus tard des recoins nouveaux ; j’ai complété ma connaissance des autres. Pourtant aucune jeune fille, aucun événement et aucun livre ne purent me dire rien de nouveau à son sujet. C’est pour cette raison que, trente ans plus tard, lorsqu’un géographe, un paysan de Berlin se joignit à moi pour revenir après une longue absence commune loin de la ville, ses pas sillonnèrent ce jardin dans lequel il semait la graine du silence. Il allait le premier sur ces chemins et chacun d’entre eux pour lui était raide. Ils conduisaient vers le bas, sinon déjà vers les mères de tout être, certainement vers celles de ce jardin. Sur le chemin asphalté qu’il empruntait, ses pas éveillaient un écho. Le gaz qui brillait sur notre pavé jetait une lumière ambiguë. Les petits escaliers, les vestibules portés par des colonnes, les péristyles, les frises et les architraves des pavillons du Tiergarten - nous les prîmes pour la première fois au mot. Mais nous prîmes surtout au mot les cages d’escalier qui, avec leurs vitraux, restaient les mêmes qu’autrefois, même si l’intérieur qui était habité avait beaucoup changé. Je sais encore les vers qui, après l’école, remplissaient les intervalles des battements de mon cœur, lorsque je m’arrêtais en montant les escaliers. Ils venaient à moi de l’obscurité du vitrail, où une femme, aérienne comme la Madone de la Chapelle Sixtine, une couronne dans les mains, sortait de la niche. Levant avec les pouces, pour soulager mes épaules, les courroies de mon cartable je déchiffrais : “Le Travail est la Parure du Citoyen, La Bénédiction est le Prix de la Peine.” La porte de la maison, en bas, se refermait avec un soupir comme un fantôme qui retourne dans sa tombe. Dehors peut-être pleuvait-il. Un des vitraux était ouvert et on continuait à monter l’escalier au rythme des gouttes. Mais parmi les cariatides et les atlantes, les angelots et les pomones qui m’avaient jadis regardé, celles qui maintenant m’étaient les plus chères, c’étaient celles, tout empoussiérées, de la race des sages-femmes du seuil, qui gardent l’entrée de la vie comme celle de la maison. Car elles s’y entendaient en patience. Et cela leur était égal, qu’elles attendissent un étranger, le retour des anciens dieux ou l’enfant qui s’est glissé devant elles avec son cartable il y a trente ans. Le vieil Ouest, sous leur signe, est devenu l’Ouest antique, d’où viennent les vents à la rencontre des mariniers qui font remonter lentement le canal de la Réserve à leur barge chargée de pommes des Hespérides, pour accoster près du pont d’Hercule. Et derechef, comme dans mon enfance, l’hydre et le lion de Némée avaient une place dans la Forêt qui entoure la Grande Étoile.
PANORAMA IMPÉRIAL
Les images de voyage qu’on trouvait au Panorama impérial avaient ce grand charme que peu importait celle par laquelle on commençait la ronde. L’écran en effet, avec devant les endroits pour s’asseoir, était circulaire et chaque image parcourait donc toutes les stations d’où l’on pouvait regarder, à travers une double fenêtre, dans son lointain aux couleurs pâles. On trouvait toujours de la place. Et particulièrement vers la fin de mon enfance, lorsque la mode tournait déjà le dos au Panorama Impérial, on s’habituait à voyager en rond dans une salle à demi vide. La musique qui rendit plus tard endormants les voyages au cinéma parce qu’elle décompose l’image dont pourrait se nourrir l’imagination, la musique donc n’existait pas au Panorama Impérial. Mais à mes yeux un petit effet, authentiquement troublant, me semble supérieur à tous les sortilèges mensongers dont les pastorales entourent les oasis et les marches funèbres les murailles en ruine. Il s’agissait d’une sonnerie qui retentissait quelques secondes avant que l’image ne se retirât d’un coup, pour céder la place, d’abord à un vide, puis à l’image suivante. Et, à chaque tintement de la sonnette, les montagnes avec la vallée à leur pied, les villes avec toutes leurs fenêtres brillantes comme des miroirs, les indigènes exotiques et pittoresques, les gares avec leurs gros nuages de fumée jaune, les coteaux à vignobles avec toutes leurs petites feuilles, tout était profondément imprégné d’une mélancolique atmosphère d’adieu. Pour la deuxième fois j’avais la conviction — car la vue de la première image suffisait régulièrement à m’en persuader — qu’il était impossible d’épuiser ces splendeurs en une seule séance. Alors naissait le projet — jamais réalisé — de revenir le jour suivant. Mais avant que je ne fusse entièrement décidé, toute cette structure dont ne me séparait que la balustrade de bois se mettait à trembler ; l’image dans son petit cadre vacillait pour échapper aussitôt vers la gauche à mes regards. Les arts qui survivaient ici sont nés avec le XIXe siècle. Pas exactement au début, mais à temps toutefois pour saluer encore l’époque Biedermeier. En 1822 Daguerre avait ouvert son Panorama à Paris. Depuis lors ces “diapositives” claires et brillantes, aquariums de l’exotisme et du passé, sont familières de tous les cours et toutes les promenades à la mode. Et ici comme dans les passages et les kiosques elles ont volontiers occupé les snobs et les artistes avant de devenir ces chambres à l’intérieur desquelles les enfants se liaient d’amitié avec le globe terrestre dont le plus agréable des méridiens passait par le Panorama : le plus beau des méridiens, le plus riche d’images. Lorsque j’y entrai pour la première fois, l’époque des plus jolies vedute était depuis longtemps passée. Mais cette magie qui avait les enfants pour dernier public n’avait rien perdu de son charme. C’est ainsi qu’elle voulut me persuader un après-midi devant le transparent de la petite ville d’Aix que j’avais jadis déjà joué dans la lumière olivâtre qui traverse les feuilles des platanes pour inonder le large Cours Mirabeau, à une époque qui n’avait certes rien en commun avec les autres époques de ma vie. Ces voyages en effet avaient ceci d’étrange : leur monde lointain n’était pas toujours étranger et l’aspiration qu’il éveillait en moi n’était pas toujours celle qui vous attire vers l’inconnu, mais bien plutôt, parfois, le désir plus paisible du retour à la maison. Mais c’était peut-être là l’oeuvre d’un éclairage au gaz qui tombait si doucement sur toutes choses. Et quand il pleuvait je n’avais pas besoin de m’arrêter devant les affiches sur lesquelles étaient exactement portées sur deux colonnes toutes les cinquante images — j’entrais à l’intérieur et je retrouvais alors dans les fjords et sur les cocotiers la lumière qui le soir éclairait mon pupitre quand je faisais mes devoirs. Il se peut qu’un défaut dans l’éclairage donnât soudain naissance à ce crépuscule rare dans lequel la couleur disparaissait du paysage. Il se trouvait alors là, silencieux sous un ciel de cendre ; comme si j’eusse pu entendre le vent et les cloches, si seulement j’avais fait davantage attention.
€ 22.00