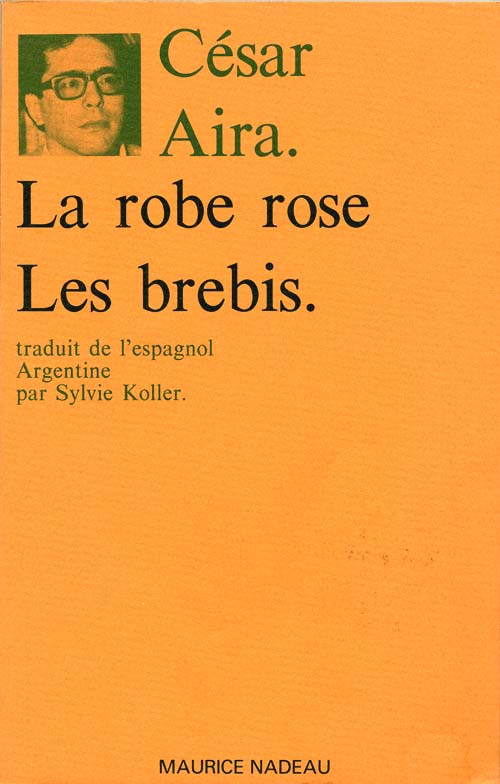La robe rose, les brebis
Une histoire peut en cacher une autre. Celle de la robe rose commence comme un conte de fées. Sa légende ne cesse de croître et d'opérer de merveilleux rapprochements dans le temps et l'espace. Traduit de l'espagnol (Argentine) par Sylvie Koller. 152 p. (1988)
César Aira né en 1949 dans une ville de la Pampa argentine, vit actuellement à Buenos Aires où il est professeur d'anglais. Il considère la Robe comme son premier conte et Les Brebis comme son premier roman.
Extrait
Vers le mlieu du siècle dernier, près de l’un des derniers relais de poste avant la frontière du pays indien, vivait un enfant trouvé d’âge indéterminé (entre vingt et trente ans). Il avait l’air quelque peu demeuré, soit qu’il le fût vraiment, soit qu’il en eût simplement l’apparence. Ou les deux à la fois. Ou le contraire. Il était là, bouche bée, les yeux écarquillés, le verbe lent et les gestes légèrement décalés, massif hurluberlu, toujours très serein mais nimbé d’un halo d’inquiétude : la crainte de ne rien comprendre. Les autres ne pouvaient avoir le coeur net à son sujet, et cette ambiguïté, sans doute, ne demeurait que faute d’occasions où l’on aurait eu le loisir de vérifier s’il raisonnait ou non comme le reste du monde. Mais peut-être n’y avait-il rien à vérifier ? Sa présence fortuite s’ajustait bien à l’instant présent, mais elle n’éclairait pas assez le passé ni l’avenir pour permettre de lever le doute. L’intensité de sa présence brouillait le destin qu’il aurait dû incarner. En général, on l’acceptait pour ce qu’il était : un péon serviable, un cavalier accompli, un piètre interlocuteur. Quelque chose semblait l’isoler, mais c’était justement ce qui le pliait aux circonstances ordinaires. S’il y en avait de moins ordinaires, elles se volatilisaient dans le ciel de la pampa avec tout leur cortège de chimères, sans même effleurer le front du jeune homme d’un céleste peton nacré en prenant leur envol. Du reste, ses distractions et son conformisme surnaturel n’étaient guère mis à l’épreuve par les exigences d’une réalité plutôt pauvre et monotone.
Il avait été recueilli par un homme dans sa petite enfance, et cet homme était mort. Il ne se souvenait ni de ses parents ni d’aucun lieu de son passé. Depuis la disparition de son protecteur, il vivait avec le fils de celui-ci, un éleveur du pays au tempérament grincheux : un de ces hommes à qui il arrive toujours une guigne après un coup de chance, ou qui du moins en ont l’impression. Un individu irritable, nerveux. Il s’était marié avec une métisse d’une grande beauté, qui par la suite avait enlaidi. Il avait eu deux enfants qui avaient hérité de cette beauté perdue. Ensuite, il avait vu sa femme nourrir une vive rancune contre sa mère à lui, qui était toujours de ce monde et gardait un certain ascendant sur son fils. Curieusement, elle portait le même prénom que lui, Rosario, mais on l’appelait Sara. La bru détestait la belle-mère, comme de juste, et la vieille le lui rendait bien, sur un mode doucement sulfureux, mais non moins efficace, comme on le verra. Quant à lui, il se tenait à l’écart, et les aurait volontiers vues disparaître toutes les deux, avec leurs savantes perfidies. Sa femme s’appelait Luisa, les enfants Augusta et Manuel, et l’idiot Acis, ce qui n’était même pas un nom mais une onomatopée, une variante enfantine de l’éternuement.
Ils vivaient dans une grande maison basse, de terre séchée crépie à la chaux rose. Outre la famille, il y avait trois Indiens, dont deux (allez savoir lesquels) étaient mariés, un ménage de vieillards (des protégés de doha Rosario), un péon et son fils, une autre Indienne et plusieurs enfants. Le travail, entre autres choses, était pour le patron une occasion de s’emporter contre l’intelligence de son frère adoptif. Tout son agacement venait de là : il avait compris qu’il n’y avait rien d’autre à faire que de travailler, pour dissiper l’insupportable ennui de vivre… mais par ailleurs le travail suspendait la pensée, la remplaçait par une mécanique dépourvue de sens. Il voyait Acis aller et venir, tout à ses occupations. Était-ce réel, sincère ? Était-ce plutôt une comédie sans précédent ? Il communiquait avec les animaux, il dormait comme une masse dès le coucher du soleil, il avait des gestes hébétés. Mais que fallait-il en conclure ? Avait-on affaire à un idiot, à un monstre ? A un être comme vous et moi ? Il lui arrivait parfois de se délivrer de sa colère en faisant des confidences ulcérées à don Palmiro, le péon ; les femmes ne prenaient même pas la peine de l’écouter, bien qu’elles fussent au fait de ses ruminations. Comme tous les atrabilaires, il n’était pas vraiment pris au sérieux. Palmiro lui-même se taisait et restait les yeux dans le vague. Qu’avait-il à faire de ces doutes ? Certes, le jeune homme avait quelque chose d’étrange, mais après tout il n’était pas le seul, certainement pas… Ces yeux un peu exorbités d’Acis, ces regards gris ne signifiaient rien. Mais alors, se demandait Rosario, pourquoi partageait-il leur monde ? Par le seul fait de la pesanteur atmosphérique, qui empêchait l’araignée de tomber de l’arbre ? Une idée prise au hasard se substituait à toutes les idées possibles. Pourquoi pas, après tout ? La vie était riche d’enseignements, mais ils sombraient tous dans le vide, l’air transparent du soir les retournait, et voilà qu’ils s’évanouissaient. L’irritation de Rosario devant l’incertitude tenait peut-être au fait qu’il aurait voulu toucher du doigt la différence révélatrice de toute humanité, et qu’il n’était pas disposé à attendre trop longtemps.
Quoi qu’il en soit, il appréciait Acis, non pour sa seule qualité d’enfant trouvé, mais pour ce qu’il pressentait en lui de bonté. Bien qu’insaisissable et fuyant, il avait une sorte de courtoisie, sous des dehors grotesques. Il avait aimé les enfants dès leur naissance. Rosario avait été touché par la tendresse toute féminine que l’idiot avait témoignée aux petits. A présent qu’ils avaient douze et dix ans, il les évitait, par une sorte de respect craintif. Un jour, Luisa daigna lui faire remarquer qu’Acis avait toujours été frappé du fait que l’un des enfants fût un garçon, et l’autre une fille. Rosario, qui tenait en piètre estime la perspicacité de Luisa, resta songeur. Mais lui aussi s’en rendit compte, même après coup : ce personnage énigmatique regardait séparément, l’un après l’autre, l’homme et la femme. Voilà ce que signifiaient ces regards vagues, qui erraient d’un objet à l’autre, d’une pensée à l’autre. Fallait-il comprendre que pour Acis l’existence des sexes n’allait pas de soi ? Rosario venait de découvrir un indice (presque effacé d’avance) de la lente alchimie de cet homme. Que la réponse fût remise à plus tard, pour les générations futures, voilà qui l’exaspérait. Il ne servirait à rien d’interroger Acis, car pour lui non plus il n’y avait pas de réponse en ce monde. Selon le syllogisme de Rosario, si Acis pensait, ce n’était pas un idiot, mais un être comme les autres, son semblable. Mais s’il éprouvait le besoin de penser justement à la différence entre les hommes et les femmes, c’est qu’il était bel et bien différent des autres : un simple d’esprit.
Ils vivaient dans une grande solitude, car leur plus proche voisin habitait à plusieurs lieues de là. La vieille était la seule à entretenir quelques relations, peut-être parce qu’elle avait vécu bien plus longtemps qu’eux, tout simplement. D’ailleurs, elle utilisait son entregent comme une arme contre sa bru. Un jour, par exemple, elle apprit que le fils d’une de ses vieilles connaissances venait d’avoir une petite fille, et après en avoir brièvement délibéré avec elle-même, elle annonça qu’elle allait lui coudre une robe. Elle avait une réputation légendaire de couturière, mais jamais elle ne touchait une aiguille, sauf pour quelque reprise bâclée. Luisa prit immédiatement la mouche : elle ne pouvait admettre que Sara, qui n’avait jamais fait le moindre vêtement pour ses propres petits-enfants, s’en donnât la peine pour une parfaite inconnue. Quelle raison pouvait-elle avoir, sinon le désir de la contrarier ? Pendant plusieurs semaines, elle manifesta sa rage jusque dans la façon de donner leur avoine aux cochons, et elle n’adressa pas la parole à son mari de trois jours. Ce dont il ne s’aperçut même pas, car il avait bien d’autres soucis. C’était un été de sécheresse, sinistre, et Rosario redoutait de voir ses génisses squelettiques monter au ciel d’un moment à l’autre. Les hommes déplaçaient jour et nuit le bétail vers les dernières plaques d’herbe, et ils finirent par les mettre au pâturage à plusieurs lieues de là, sur des collines dont l’accès leur devint pénible. Trop fatigués pour rentrer à la maison, ils dormaient sur place. Les enfants devaient leur apporter leur repas et s’en revenir à la nuit tombée, au milieu des renards.
Luisa ignorait superbement l’ouvrière à son long travail. Elle en arriva même à penser qu’elle avait fait une erreur en se mariant. Elle sut que son adversaire coupait une toile rose, et le bruit des ciseaux lui arrachait des grimaces. Elle détournait les yeux, farouche. Elle aurait voulu se retirer de tout, même de sa vie. Acis, en revanche, montra de l’intérêt. Pour la première fois, il se trouvait des raisons valables d’être intéressé. A la lumière pâle du rose de cette robe, il découvrait toutes les alternatives à son ignorance, et les tirait à lui comme si son cerveau avait été soudainement aimanté. Rien que de voir se déplier le corps et les manches, dédoublés sur la table, quand la vieille les repassait avant de les coudre… On aurait dit un vêtement lorsque personne ne le porte, mais sans le gonflement du vent : il était désarticulé. Les objets passaient donc par un stade qui excluait la troisième dimension ! Intéressant, et très riche de suggestions : le regard voyait toujours des plans lointains dans l’univers, dont il faisait découler la réalité toute proche. Mais celle-ci, à son tour, pouvait reculer. Et puis, il y avait la taille. Il est vrai que la vieille, pour sceller devant sa bru le destin tout tracé du vêtement, l’avait taillé vraiment tout petit, pour une fillette de quelques semaines, un vêtement de quelques centimètres, un luxe de fugacité. Acis inclinait sa silhouette gauche sur ces petits riens délicatement ouvragés : les gens pouvaient être tout petits, tenir dans une seule de vos mains. En même temps, ce petit nuage rose qui tournait dans les mains de la vieille évoquait pour lui l’espace dans son entier, une dimension dilatée. Car il suffisait d’y penser pour que les choses prennent l’ampleur fantastique du ciel ; il aurait pu allonger la main et plonger ses doigts parmi les astres invisibles. Il aurait pu s’arracher les yeux du visage, ces deux petites boules de verre sombre, et les envelopper dans la toile rose. Une fillette qui venait de naître était petite, dans une certaine limite, bien sûr : elle ne disparaissait pas. Et si à la naissance elle avait été un garçon… on ne serait pas en train de lui faire cette robe. La différence tenait à cet instant bondissant, la naissance.
€ 14.00