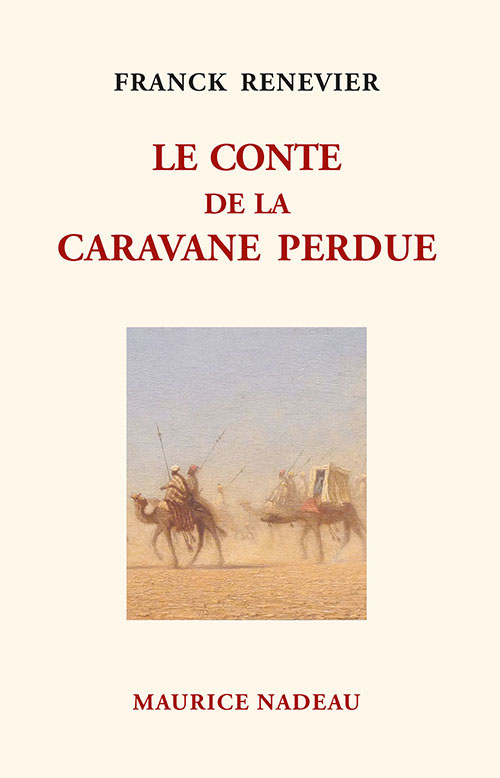Le conte de la caravane perdue
Prix La Renaissance française 2022 de l'Académie des sciences d'Outremer
Un archiviste de la ville imaginaire d’Alika, en Algérie, retrouve les traces de la fondation de sa ville à l’endroit où eut lieu la résidence forcée de deux caravanes de marchands venues de Tunisie, au moment de la conquête de l’Algérie par la France. Le manque de femmes dans cette société confinée va produire un phénomène inédit en pays musulman : une sorte de matriarcat qui va durer le temps d’une génération. Cette découverte – qui heurte les autorités conservatrices actuelles – va bientôt rendre célèbre l’archiviste Mohamed Bourrichi dans l’Algérie contemporaine et déterminer son ascension à la tête d’un état algérien de fiction. En résumé, un récit plein d’humour très documenté, doté de toute la poésie du conte oriental.
Orphelin de père, Franck Renevier a été élevé par son grand-père, le préfet Georges Zerbini, corse et pied-noir. À l’instar de Camus, sa famille a toujours milité pour une indépendance multicommunautaire de l’Algérie. Sociologue et designer, il est l’auteur de plusieurs ouvrages, dont Le trou du souffleur (Seuil) ou Livre de recettes pour les amoureux en difficulté (Grasset).
Extrait
En dehors de sa qualité de porte du désert, il ne reste pas grand-chose aujourd’hui de la grandeur présumée d’Alika. À l’indépendance, la commune fut rattachée à une localité plus modeste mais située sur la route des champs pétroliers. El Oued devint le chef-lieu du district. L’ancien village chamelier qui n’était encore qu’un amoncellement de bâches et de boue séchée, avec pour seul commerce digne de ce nom une pompe à essence, avait eu la préférence sur une ville construite en dur au beau milieu d’une oasis. Et dans ce trou perdu, l’État avait construit une Préfecture, qui plus est avec de la pierre venue d’Alika.
On murmurait à Alger que le choix d’El Oued n’était pas seulement dû à sa position sur la nationale mais aussi à l’importance de son monument aux morts. La vie sous la tente avait inspiré plus de vocations patriotiques que le séjour des villas blanches, à l’ombre des pinèdes. À mesure que s’éloignait le souvenir de la guerre, les démarches des élus d’Alika auprès du gouvernement, pour obtenir ne serait-ce qu’un partage de compétences avec El Oued, se firent plus insistantes. Le dossier ne manquait pas d’arguments. Alika occupait une aire autrement plus symbolique que celle d’un puits de pétrole, au point de rencontre du Sahara touareg avec le pays berbère. Le site avait vu se croiser les caravanes transsahariennes qui reliaient la Méditerranée aux premières luxuriances tropicales et la mer Rouge à la grande Mauritanie. Tous les guides venaient pointer leur route dans la transparence exceptionnelle de sa nuit. Sa palmeraie avait reçu plus de grandes âmes en prière que les mosquées d’Alger. Vu des terrasses d’Alika, la découpe de la montagne et de la dune était pareille à celle d’une falaise et d’un océan. De part et d’autre de ce point culminant, le front rocheux s’étendait d’Est en Ouest dans une suite de sommets, des Monts de Tebessa jusqu’à l’Atlas, ne cédant son emprise qu’en vue des eaux déliées de l’Atlantique et de la lagune du golfe d’Hammamet.
Sur ces étendues, le Sirocco effaçait aussi bien les traces de pneu que les lignes de partage. Alors que les bornes d’État finissaient enterrées dans le sable, comme des œufs de tortue, quelques bergers chauvins s’évertuaient, avec de la corde à linge et des boîtes de sardine peintes aux couleurs nationales, à marquer les limites de l’Algérie et de la Tunisie. Nomades et contrebandiers les déposaient sur leur passage puis renouaient poliment la frontière, comme on ferme une porte derrière soi, une fois passée la croupe du dernier chameau. Mais Alika avait aussi une «?Histoire?», avec un grand H. La fondation de la ville résultait, comme tout le monde semblait l’avoir oublié, de l’immobilisation prolongée d’une caravane pendant la campagne d’Algérie.
En Mars 1840, au plus fort de la conquête, le général Bugeaud prit la décision de fermer la frontière avec la Régence. Il ne faisait guère de doute à ses yeux, que la contrebande des armes et de la poudre, qui approvisionnait la rébellion, bénéficiait de la complicité occulte du Bey Sadok. Par ce moyen, le Bey, en dehors de faire la fortune du commerce de Tunis, tirait parti de sa situation de potiche en menant double jeu.
Pour le généralissime, en pétard à Alger, il n’était plus possible de laisser aller et venir d’un pays à l’autre des gens sans papiers, capables de grandes courses à chameaux, enroulés dans des caftans où même des pièces d’artillerie auraient pu être dissimulées. La caravane en question était formée pour l’essentiel de marchands tunisiens et de notables mozabites qui se rendaient à Ghardaïa pour un mariage. Les archives françaises n’avaient pas jugé utile de relever le nom de ces voyageurs. Elles se bornaient à indiquer leur métier suivi de la mention « musulman » ce qui voulait sans doute tout dire à leurs yeux.
Pour se représenter aujourd’hui la personnalité des fondateurs d’Alika, on ne pouvait s’en remettre qu’à quelques traditions que la commune avait conservées. À commencer par sa cuisine, à l’évidence côtière et méditerranéenne. Les Aliksis ne ménageaient pas leurs efforts pour s’en procurer les épices malgré les difficultés de l’approvisionnement. Si la cimenterie, dans le département voisin, produit par moments un tel nuage de poussière que même les méharistes le confondent avec le vent de sable, à certaines heures la cuisine d’Alika remplit de ses arômes les confins du désert. Les voyageurs qui arrivent sur le coup de midi ne s’attendent pas, à plus de mille kilomètres de la côte, à respirer des senteurs qui évoquent le bord de mer, la villa balnéaire où grille à l’heure du déjeuner sur les herbes du jardin, le poisson pêché aux aurores.
Dès le milieu de la matinée, la ville commence à bourdonner sous la friture. L’odeur du poivron noirci à la flamme, de l’ail qui blondit dans l’huile d’olive, du laurier qui fume sur la braise envahissent même la rue principale où règne pourtant un fort trafic de camions. Ce n’est qu’au beau milieu du jardin botanique, que le jasmin et l’oranger arrivent à prendre le dessus sur les effluves de cuisson. Le jardin en question n’a de botanique que le nom. En réalité, il est plutôt sauvage. Il fait partie de cet héritage d’origine inconnue sur lequel Mohamed avait vainement cherché à attirer l’attention du Conseil municipal. Pour les habitants d’Alika, cet endroit était plutôt un lieu de détente que de mémoire. Ils venaient s’y promener pour faire le vide et rêver sous les ombrages. La nuit, les chats errants prenaient possession des fourrés d’où ils se défiaient en poussant des cris d’épouvante. De leur vagabondage dans le désert, ils rapportaient une fourrure qui donnait à penser qu’ils s’accouplaient avec des hyènes. Tigrés majestueusement par le bled, puis déchus de ce magnifique pelage par les combats de rue, ils portaient presque tous les traces d’une blessure ou d’une maladie. Parmi les borgnes, les amputés, les teigneux, Amar, le chat de Mohamed, conservait une insolente beauté.
Il n’était pourtant pas à la traîne dans les mauvais coups. Partageant sa vie entre le salon mauresque et la dune, à un rythme que lui seul décidait, cet animal étrange, malgré son amour des sofas, avait une autorité incontestée sur la rue. Son cou longiligne, ses pattes de lion, ses reins creusés, le panache alangui de sa queue donnaient à sa silhouette une élégance de statue. Mohamed avait toujours pensé qu’il était d’origine égyptienne et que son aïeul avait dû faire partie de la suite d’un sultan. À moins qu’il ne descende en droite ligne de ce lynx fameux qui guida Dada Saïd, le premier marabout de l’Atlas, des rivages d’Agadir jusqu’aux montagnes qui desservent le ciel, lequel, chemin faisant, aurait répandu sa semence dans les douars. Plusieurs fois, Mohamed avait demandé au Caïd de faire venir un spécialiste pour l’examiner. Le pauvre Mohamed n’avait pas été mieux entendu lorsqu’il avait proposé que des fouilles soient entreprises dans le jardin public.
Aujourd’hui, tout ce qu’Alika possédait comme archives remontait aux premières années de la colonisation. À l’intérieur d’une rotonde encore intacte de l’ancien fort français, Mohamed avait aménagé une sorte de musée où il présentait des documents datant de cette période. Il y avait là des vues de femmes dans des toilettes de Paris retroussant leurs jupons pour traverser le seuil d’une maison en torchis, juchées, l’air godiche, sur un dromadaire ou bien encore occupées à manger la semoule du couscous au creux de la main, en se retenant de pouffer de rire tandis que partout à l’entour des ombres en burnous s’agitaient pour que ces nouveaux arrivants ne manquent de rien. Une photo d’un format beaucoup plus grand montrait un garçonnet en marinière en train de gaver un âne de picotin. L’animal, comme toute mascotte, était ridiculement affublé. Un harnachement couvert de grelots supportait une selle d’enfant et il avait une houppette tricolore entre les deux oreilles. Son poil brillant, ses sabots vernis, la rondeur de ses flancs ne laissaient aucun doute sur le fait qu’il ne remplaçait jamais son compagnon d’écurie qu’on voyait en arrière-plan tirer l’eau d’un trou sur une aire désespérément circulaire de terre sèche. Plus on avançait dans cette reconstitution photographique de la conquête, plus les Français étaient détendus, plus les indigènes détournaient le regard de l’objectif.
Dans la pièce voisine, sur une table surmontée d’une vitrine, Mohamed avait exposé des lettres du Ministre des Colonies à l’Administrateur civil, de l’administrateur civil au chef de poste, du chef de poste au chef de village et de ce dernier au responsable des troubles et meneur des rebelles, de ce meneur à ses lieutenants et hommes de confiance. Toutes dans un style et une calligraphie irréprochables, comme si les hostilités, à l’époque, n’avaient mis aux prises que des gens de lettres.
Juste avant la sortie de ce prétendu «?musée?», le visiteur était convié à traverser une redoute en pierre sèche remplie de morceaux d’assiettes et de pots auxquels le demi-jour de la fortification, ajouté à la poussière ambiante, donnait une sorte de lustre archéologique. C’était là que Mohamed s’efforçait de faire revivre des temps plus anciens. Le Caïd avait fini par se lasser d’en demander la fermeture.
Pour toutes ses belles histoires, Mohamed bénéficiait de la sympathie de la population, mais c’était toujours au conteur, au charmeur de mots, que s’adressaient les compliments. Personne n’ajoutait foi pour autant à des racontars de vieux pots. Personne n’aurait accepté que l’on votât le moindre crédit pour retourner le jardin public, bien que Mohamed eût produit dernièrement, en séance du conseil, quelques fragments de terre cuite gravés aux armes de Tunis qui sentaient fort le ranci d’huile de sésame. Eut-il trouvé trace d’ivoire, de plume d’autruche ou de poudre d’or que le Caïd lui aurait peut-être donné les moyens de remuer plus amplement son terrain vague, mais des débris de vaisselle ayant renfermé de la graisse de cuisine. Le conteur y allait décidément un peu fort ! N’empêche ! On aurait pu au moins lui être reconnaissant de ne pas avoir ménagé ses efforts pour susciter, dans ces solitudes brûlées où l’agglomération n’avait pas meilleure figure qu’une bouteille à la mer, un peu de cet orgueil de l’histoire humaine et des traces de civilisation aussi impérissables que les squelettes de chameaux.
En savoir plus...
Le Conte de la caravane perdue, Franck Renevier (par Patryck Froissart)
voir l'article en entier de Patryck Froissart dans la Cause littéraire :
Extrait : "L’écriture varie de façon circonstancielle, le récit passant alternativement du conte de style voltairien à la chronique d’historien, de la description balzacienne réaliste à l’évocation poétique…
Le silence n’était rompu que par le gazouillis des oiseaux jouant sur l’élasticité des branches, les bassins remplis d’eau que la baignade furtive des étourneaux faisait doucement clapoter.
… de la critique sociale d’une Algérie contemporaine à l’établissement d’une société utopique, de la reconstitution minutieusement précise d’événements du passé à l’anticipation, issue d’une imagination débridée fondée sur une pensée humaniste, d’un avenir idéal de l’Algérie, du Maghreb, des pays méditerranéens, de l’Europe, voire du monde. Sidérant !
Ainsi, par exemple, en conséquence d’un referendum positif, à partir de juillet 2022 et en vertu d’un décret de droit au retour, les pieds-noirs et leurs descendants ayant été invités à revenir, l’auteur offre-t-il un tableau pittoresque du flux des bateaux ramenant les anciens colons et/ou leur progéniture en inversant les scènes et l’ambiance de l’exode de 1962. Renversant !
Les discours publics officiels du personnage sont autant de pièces remarquables dans le puzzle narratif de ce roman polymorphe, en particulier celui qu’il développe devant ses concitoyens d’Alika, qu’on pourrait intituler « le discours du melon et du couscous ». Savoureux !
On notera aussi sa première allocution au Parlement, véritable logorrhée souvent antiphrastique sur la nature, le non-dit, l’implicite et les implications énonciatives du conte populaire, sur les vertus poétiques et les nuances infinies de la langue arabe, sur la relation historique entre cette langue et le français, et, par enchaînement, sur l’impact de la colonisation, puis sur l’influence exercée par les idéologies occidentales, par un mimétisme qu’il dénonce, sur la politique des anciennes colonies… Confondant !
Euphémisme, exagération amusante, arrangements cocasses des imams initiaux avec les règles de l’Islam, imagination débordante, sautes narratives d’un lieu à l’autre, d’une époque à l’autre, de Barberousse à Fidel Castro en passant par un Soliman Frangié que Mohamed rencontre à Bogota, généalogies fantaisistes, diversions, propos sérieux et précis d’historien concernant les lieux où séjourne Mohamed (villes, quartiers, monuments, bâtiments publics, édifices religieux, ruines, marabouts), reconstitutions érudites de scènes vivantes et imagées de diverses époques (exemple : la prise d’Alger), extraits de grimoires, d’archives, d’annuaires anciens, de statistiques démographiques… Foisonnant !"
Le Conte de la caravane perdue, Franck Renevier (par Marc Verlynde)
voir l'article en entier de Marc Verlynde dans La Viduité
Conte philosophique rieur, utopiste, où s’invente une Algérie ouverte, à l’écoute d’un passé plurielle et surtout d’une identité qui tiendrait aux fantaisies de la narration, au pouvoir de la parole. Dans une joyeuse irréalité, comme une perpétuelle relecture du passé, Le conte de la caravane perdue est un récit enchanteur, une belle réflexion politique. Franck Renevier signe un roman allégorique, un livre d’espérance. (...)
Pour être un rien définitif, je trouve particulièrement pertinente la question de savoir si ce n’est pas au peuple algérien de s’emparer de sa propre Histoire, de le faire surtout dans sa propre langue. Pour Le conte de la caravane perdue, la critique est passablement infondée. Certes, j’aurais aimé que la langue arabe soit plus présence, irrigue et irradie la substance même du récit, devienne même, qui sait, la matière même de cet indispensable métissage inventé par Franck Renevier. Le seul mot en arabe sera le dernier, le plus définitif : mektoub. Une sorte de paradoxe qui nous fait entrer de plain-pied dans le sujet essentiel du Conte de la Caravane perdue : la langue et ses possibilités d’altération de la mémoire, donc d’opposition à toutes ses récupérations politiques.
€ 18.00 € 14.99