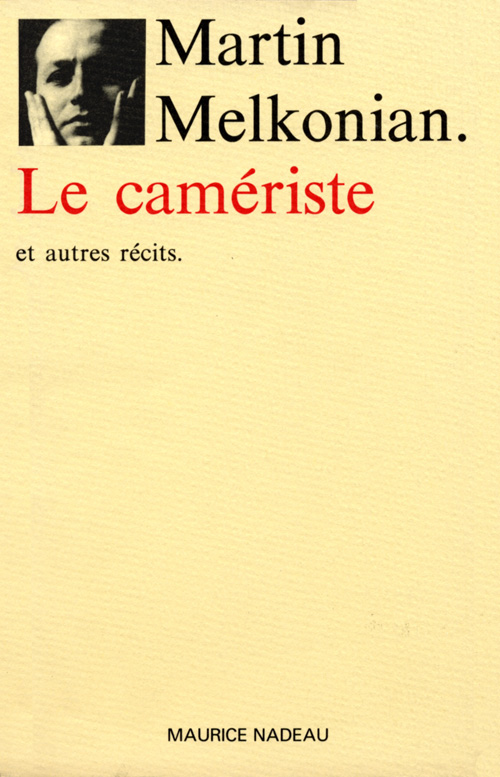Le camériste et autres récits
Trois récits. Trois postures existentielles, mais une même quête éperdue de l’autre. L’autre affaibli, raréfié, écrasé par l’époque. Alors comment ranimer la flamme des commencements ? Comment vivre en homme dans un monde qui anéantit l’humain ? Comment boire à la source antique de l’être ? Comment retrouver la voie simple ? Les questions vraies ? Orchestrées par une écriture amoureuse du détail qui frappe, les récits s’entraînent mutuellement, les personnages entrent en dialogue... 146 p. 13 euros (1991)
De 1982 à nos jours, Martin Melkonian a construit une œuvre d’écrivain poète. Le récit, l’essai, le journal intime, les fragments poétiques et les aphorismes sont ses genres littéraires de prédilection. Le « je » de l’histoire individuelle s’y déploie tout en se faisant l’écho du génocide des Arméniens de l’Empire ottoman. Parmi de nombreuses publications où se signale la singularité d’un regard, on retiendra : Le Miniaturiste, initialement paru au Seuil, réédité en 2006 chez Parenthèses ; Arménienne, paru en 2012 chez Maurice Nadeau. Offrant toujours des perspectives originales tant sur les œuvres que sur les artistes, il s’est intéressé en particulier à Roland Barthes, Clara Haskil, Edward Hopper, Gustave Flaubert et Stéphane Mallarmé.
Extrait
Le décor est ainsi planté : une pièce fusiforme percée de six fenêtres, deux fois trois, en vis-à-vis. Pas de volets. Cela ménage une lumière toujours présente. À l’une des extrémités de ce lieu apparemment sans issue, un homme encore jeune se tient penché sur un établi. Dans son dos, rien de distinct. À l’autre extrémité — plus en pointe celle-là, effilée même —, une estrade haute d’une caisse-palette est dressée. Dessus, des papiers froissés formant par endroits de petits tas pyramidaux. Il y a aussi une dizaine de chaises cannées genre bistrot mil neuf cent. Un mouchoir de filoselle blanc est pendu au dossier de l’une d’elles. Derrière l’estrade, rien de distinct.
Au centre, un matelas posé sur le sol, ainsi qu’une couverture tricotée de fausse laine marron. À côté, sur une table de chevet en carton (deux boîtes à chaussures superposées), un épais volume est ouvert en son milieu. Un signet magenta raie la page paire. Sur la page impaire, en regard d’une minuscule croix grise tracée à la mine de plomb, on peut lire : « Il faut tout perdre, même l’abandon aperçu par lequel on se voyait livré à sa perte. »
Je n’imagine pas un autre décor pour la lecture des œuvres de Monsieur de Bourbonne. Raoul, avec qui j’occupe l’appartement, partage mon point de vue. Lui crée des poupées de trente centimètres. Un peu d’eau, de la poudre de plâtre, des allumettes étêtées, voilà l’essentiel de son attirail.
Les personnages tous féminins sont étiques et gracieux. Raoul les habille de chutes de tissus prélevées dans les poubelles d’une couturière, les coiffe de gaze, les alourdit de verroteries. Il faut voir et admirer ces faces lunaires prêtes pour le conciliabule, mais fermées inexorablement. Je les compare volontiers aux œuvres de Monsieur de Bourbonne : elles ne s’animent que si, après que nous en avons arraché le moi qui est le centre de notre amour (de la sorte parlait-il sur les ruines de sa gloire), nous-mêmes nous les animons.
Mais je m’avance par trop... Je ne voudrais convaincre qui que ce soit. Mon ami et moi avons dérapé dans un autre monde, proche en un sens de celui du commun des mortels et à la fois inaccessible aux esprits oublieux de la stratégie de la poussière.
Cherchant le feu, nous avons trouvé l’eau. C’est cette déception — j’ajouterai : cette encourageante déception — que je me propose de raconter. Le récent passé de notre relation servira de contrefort à ce que, mi-ravis mi-éberlués, nous sommes en train de vivre.
Alors, nous projetions, Raoul et moi, d’espacer nos rencontres. Les récits de nos rêves et de nos hantises ne faisaient plus l’amitié. Décrivant les autres, les analysant, vampirisant un quotidien qui nous échappait, nous inventant des dons et nous immisçant dans des fables dont nous n’étions pas les héros authentiques, nous avions entrepris de ratisser le même arpent de terre.
Raoul collectionnait mes lettres. Je le photographiais à tout bout de champ. Ce rapport monobloc sécrétait un érotisme d’âmes. Afin d’effacer les marques de mon regard sur son visage, je rassemblai clichés et négatifs (je ne voulais pas me donner le loisir de récupérer, à un moment de faiblesse, de nostalgie incontrôlables, ces reproductions barbouillées d’affects) que je lui remis avec solennité.
La vue de mon visage dans la glace de la brasserie où nous étions me fit prendre conscience que je n’avais pas photographié l’essentiel de notre rencontre. Je priai Raoul de se placer à côté de moi et de regarder là où mes yeux se portaient. De regarder mes yeux dans la glace. N’étions-nous pas libres maintenant de considérer la chose qui nous envahissait?
€ 14.00