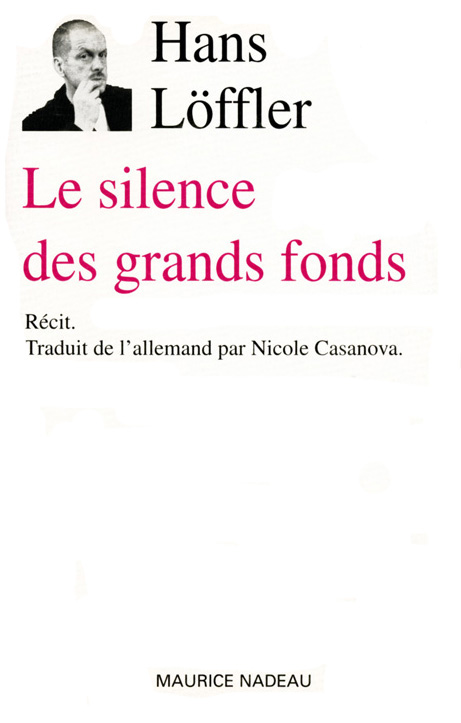Le silence des grands fonds
Berlin. Un immeuble sur cour. Dernier étage. Une nuit, Heiner, chômeur, entend une cavalcade dans son escalier. On sonne, il ouvre ; un fugitif le supplie de l'abriter. Et malgré lui, Heiner héberge Stefan, ex-espion de la RDA, "un de ces cochons de la Stasi". Une espèce d'horreur s'empare peu à peu de Heiner tandis que son hôte s'installe chez lui, ne quittant plus son revolver...
"On ne pouvait qu'être auteur officiel ou dissident en RDA. Entre les deux, il n'y avait pas de place pour un voyageur solitaire", confie Hans Löffler. C'est une déchirure qui transparaît ici, où l'obsession du silence apporte une dimension philosophique au récit. Traduit de l'allemand par Nicole Casanova. 124 p. (1995)
Hans Löffler est né en 1946 à Berlin-Spandau. Il écrit depuis 1976. Il est l'un des premiers écrivains de l'ex-RDA à avoir écrit après la réunification de l'Allemagne, témoignant des profonds changements survenus après la chute du Mur de Berlin. Le Silence des grands fonds est également son premier roman.
Extrait
Mercredi
De nouveau réveillé tard.
Le sommeil est pour moi comme une vie sans fardeau. Dans ce libre envol, on ne se fracasse jamais. Pas même en cauchemar.
Aujourd'hui, la vive lumière du soleil frappe la fenêtre.
Mangé une orange.
L'appétit est languissant.
Je m'habitue à ne pas manger comme à être éternellement seul.
Avons-nous ri, autrefois, tous les deux ; en buvant du vin. Sur la grand-route, sous les vieux pruniers en fleur.
En ce temps-là, je pensais : quand on est deux, on est sauvé.
Agnès riait, même sans motif.
Le froid dehors est une aide. Et tient lieu de but.
Il fait chaud dans la chambre.
J'ai déjà allumé le chauffage.
Au printemps, quand soudain les oiseaux chantent, me voilà parmi eux battant des ailes.
Mais maintenant, rester couché.
Cela, personne ne peut me le prendre. Sauf si je perdais jusqu'à la force de sentir qu'il est beau, aussi, de ne rien attendre.
Je vais acheter un journal.
Si quelque chose peut avoir un sens, ce sont les mots croisés dans les journaux.
Endenter l'empereur romain au mot « élémi », avoir tout trouvé jusqu'au bout : c'est cela, le bonheur.
Et seul le rend possible, déjà, l'assemblage de quelques mots.
Les mois et les semaines, chaque jour de chômage, vous laissent libre de creuser votre propre tombe. On est libre à ce point-là.
On ne peut guère désapprendre ce qu'il suffit de ressentir : combien le monde vous est proche entre les concepts « élémi », « Manille », et « ana ».
Qu'est-ce qui aurait une chance à côté de l'énigme : « Poète autrichien » ? L'information, peut-être, que tant d’Américains sont favorables aux guerres justes ?
Aux branches de forsythia qui trempent dans un verre d'eau derrière moi, les pétales forcent les boutons.
Non loin du bouquet, au mur, est accrochée la photographie d'Agnès. Ses yeux ont le même air qu'autrefois, ils scintillaient quand nous allions à l'Opéra. Alors, je n'osais jamais la regarder en plein visage.
De nouveau, le temps passe à peine.
D'autres hommes ont peur sans répit. A 15 heures 05, la radio donne de la musique de Beethoven, Moussorgsky et Mendelssohn Bartholdy.
Encore trente-quatre minutes à attendre.
Dehors, il commence à neiger faiblement.
Il vente derrière ma fenêtre.
Seul un clair contraste, sans nuances, nous permet d'éprouver une sensation, semble-t-il ; et donc, peut-être, de vivre.
Ici, chaud ; là, froid.
€ 13.00