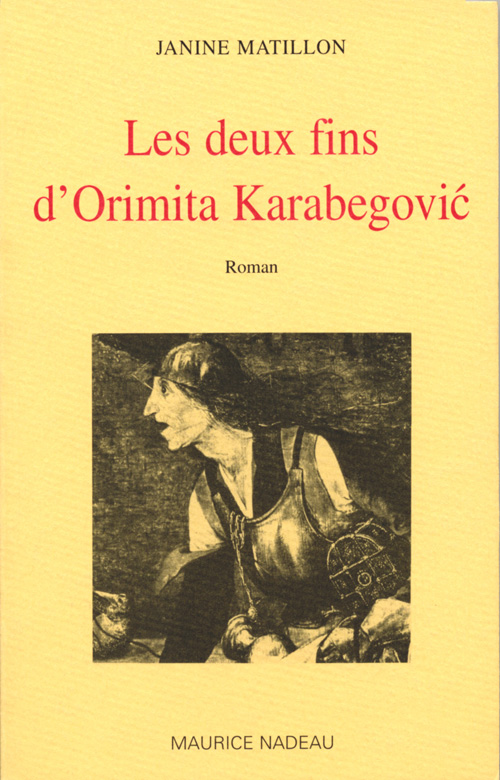Les deux fins d'Orimita Karabegovic
Sous le titre Les Deux Fins d'Orimita Karabegovic, Janine Matillon publie le premier grand roman sur la guerre de Bosnie. Son héroïne, Orimita, musulmane, fait partie du vivier de femmes bosniaques prisonnières, destinées à être "ensemencées" par les conquérants serbes. 222 p. (1996)
Janine Matillon, professeur à l'Ecole des Langues orientales, épouse de l'écrivain ex-yougoslave Stanko Lasic, a enseigné et vécu quinze ans à Zagreb. Elle a précédemment publié trois romans dans Les Lettres Nouvelles.
Extrait
Des cauchemars, ils en avaient tous. Ils voyaient des bras, des jambes, des sexes et des têtes, qui étaient peut-être les leurs, qui étaient sûrement les leurs, détachés par éclats d'obus ou lames de tronçonneuses habilement maniées, voler sur un fond d'azur immuable où étincelait une constellation de douze étoiles inconnues de Copernic. Ils entendaient le sang goutter à leurs oreilles, un sang noir, un sang épais et salé qui était peut-être le leur, qui était sûrement le leur. Mais elle, elle n'avait pas de cauchemars sanglants. Comme les autres, elle se réveillait en hurlant, mais ce n'était pas pour avoir rêvé de corps dépecés et de drapeau européen. Elle, elle se voyait en rêve traverser les massacres intacte, toujours jeune et belle, ou plus exactement conservant toutes les apparences de la jeunesse et de la beauté. Dans les étranges et mouvantes géométries du songe, elle avançait d'un pas égal et ferme, et les êtres qui surgissaient des cercles, des angles, des cubes et des cônes tourbillonnants s'adressaient à elle avec un sourire poli et une parfaite correction : « Mademoiselle, mais voyons, nous ne vous avons fait aucun mal ! » Car rien ne perçait à l'extérieur de ce qu'elle avait. Car ce qu'elle avait intéressait cette partie de son corps que les êtres souriants ne voyaient pas et qu'elle-même ne verrait jamais. Elle, c'était son cerveau qui était torturé. Il était pris dans les glaces d'un lac hyperborréen, et dans ses efforts pour se libérer, il se déchiquetait lui-même. Ou bien, de longs ongles crochus de verre étincelant le transperçaient de part en part et en emportaient les débris en se retirant. Ou il gelait de l'intérieur : un noyau extrêmement dur et froid se formait au centre de la matière cervicale et se développait par cercles concentriques, jusqu'à emplir toute la boîte crânienne. Elle souffrait horriblement. Mais plus que cette souffrance horrible la torturait le sourire des êtres qui ne voyaient pas qu'elle souffrait. Et plus encore que ce sourire la torturait la certitude que, privée de cerveau, elle ne pourrait plus penser. Elle se réveillait en hurlant : « Je ne peux plus penser, je n'ai plus de cerveau ! » Ou du moins le croyait-elle, car l'oncle, les cousins, les inconnus aussi bien que tante Emma lui affirmaient tous qu'elle criait, mais sans prononcer de paroles. Alors elle se recouchait sur son matelas, à plat ventre, appuyée sur les coudes et la tête dans les mains, et elle vérifiait les uns après les autres tous les mécanismes de la raison qu'elle jugeait essentiels : la logique, la déduction et l'induction, les capacités d'abstraction et de synthèse. Quelquefois, quand la méchanceté du cauchemar la dressait trop brusquement sur son séant, elle se cognait le crâne contre le plateau de la table. Ils étaient sept réfugiés dans la petite maison de son père, et, la nuit venue, elle prenait toujours le matelas glissé sous la table de la cuisine, car on y dormait très mal.
Toutes les fonctions étaient intactes, même à première vue la mémoire. Elle la sondait sans relâche et avec un soin maniaque. Elle lui réclamait des scènes de sa petite enfance, dans les montagnes, au-dessus de Sarajevo, et aussitôt après elle allait y chercher dans les moindres détails les menus événements de son séjour à Zagreb, où elle était encore il n'y avait pas trois semaines. Elle exigeait d'y retrouver la voix de sa grand-mère morte il y avait au moins quinze ans et en même temps la voix de tous ceux, connus et inconnus, qui avaient croisé son chemin pendant la guerre de Croatie, puis pendant celle de Bosnie-Herzégovine, qu'elle vivait maintenant, jour après jour, heure par heure. Mais elle avait beau se prendre la tête à deux mains ou se la taper contre un mur ou une table (sans oublier toutefois de se faire observer qu'elle n'ignorait pas que ces gestes avaient peu de chance d'être efficaces), sa mémoire répondait à tout mais elle ne lui livrait pas le secret du cauchemar, sa mémoire ne lui disait pas à dater de quel jour, à la suite de quel événement ce cauchemar, maintenant récurrent, était apparu pour la première fois. Elle en était sûre : il s'était passé dans la guerre quelque chose de pire que la guerre. Mais elle ne pouvait trouver quoi.
Elle avait fait une grave erreur. La première fois, elle avait traité le rêve comme toutes les personnes raisonnables traitent les rêves, sans y prêter plus d'attention qu'à un cauchemar ordinaire. La deuxième fois aussi. Il avait fallu un certain temps pour que les phénomènes de répétition et d'accumulation produisent leur effet à la fois révélateur et destructeur. Combien de temps ? Elle n'en savait rien. Quand s'était-il produit quelque chose de pire que la guerre ? Quelque chose qui gelait un cerveau tout vivant ? Quelque chose qu'une moitié d'elle-même voulait garder enfoui dans les gouffres de sa conscience, mais qui venait révéler son existence à l'autre dans les gouffres de la nuit et du sommeil ? La tête encore douloureuse des coups qu'elle se donnait, elle s'efforçait de raisonner. Elle disait : « Procédons par ordre. » Mais elle ne pouvait pas procéder par ordre. Elle disait : « Voyons. » Mais que voyait-elle ?
€ 19.00