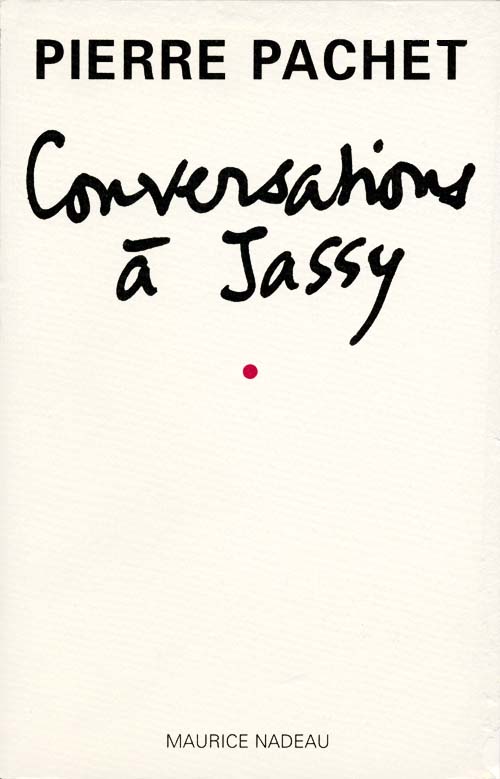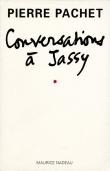Conversations à Jassy
En 1996, Pierre Pachet se rend dans le nord de la Roumanie, dans la ville de Jasi. Ce n'est pas la première la fois qu'il va dans un pays que l'expérience du communisme a écrasé, pour y goûter l'atmosphère qu'on y respire, écouter les gens se situer par rapport à cette histoire. Les conversations, les lectures, les réflexions s'organisent en une enquête sur ce qui a euu lieu en 1941, en 1943, en 1947, en 1989. La tentation y est forte, pour chacun, de rester accroché à son malheur, à son point de vue. 150 p. (1997)
Extrait
Retour de Jassy
26 avril (1996). Les souvenirs sont encore là, les impressions plutôt (les chiens la nuit, les trottoirs et la chaussée crevée après l’hiver, les sons de la langue roumaine...) qui ne sont pas encore des souvenirs, mais semblent disponibles, mobilisées, présentes. Ce n’est pas que je me souviens : je sais comment faire pour descendre au rez-de-chaussée après le réveil, traverser le terrain qui sépare la Casa de Oaspeti [la Maison d’hôtes de l’Université] de la rue, entre les voitures abandonnées (un car allemand immobilisé là sans doute depuis longtemps) ou en cours de réparation sur un pont rudimentaire, passer devant l’Academia de Arte devant laquelle de bon matin sont déjà rassemblés des étudiants en musique, à côté du robinet vissé à un simple tuyau planté dans le sol, et qui coule toujours (les chiens viennent périodiquement y boire).
Tout cela m’est présent. Mais je sens aussi comment ces diverses sensations s’écartent les unes des autres, se désolidarisent déjà : certaines prennent de l’importance aux dépens des autres, forment de petits groupes, s’organisent en « souvenirs » aptes à entrer dans la mémoire profonde. Ce sera la rencontre avec Aurelia, l’après-midi au monastère de Cetatuie, le départ trop tôt un matin pour aller à la synagogue, la discussion avec les collègues du département, ou celle avec Magda autour d’une orangeade, sous les arbres encore sans feuilles, avec un haut-parleur diffusant de médiocres chansons américaines, et l’accompagnement du bruit des boules de billard. Je porte en moi des conversations, compressées dans ma mémoire comme des papiers serrés dans un portefeuille. Il faudra les déplier, ou les laisser se déchirer, s’appauvrir. D’autres sensations déjà s’éteignent, se sentent inutiles, reculent.
Car la mémoire n’est pas un domaine à part, un jardin, un cimetière situé à l’écart de la ville, sur une colline à côté des vignes (comme l’est le cimetière juif de Jassy, justement), un lieu paisible où les souvenirs attendraient, pierres tombales gravées, soumises à l’air et à la pluie : attendraient de devenir difficilement lisibles, puis illisibles, jusqu’à ce qu’un jour il n’y ait peut-être plus personne pour venir essayer de les déchiffrer. Non, la mémoire est liée à la vie quotidienne : si mes souvenirs de Jassy cherchent à s’écarter les uns des autres, à partir à la dérive, c’est que ma vie d’ici impose ses droits et ses besoins. Cette pièce de Paris où je suis, avec l’air qu’on y respire, les bruits de la rue (si différents, dans cette rue étroite, du tintamarre des tramways qu’on entendait tôt le matin à Jassy), tout le sentiment d’être à Paris s’impose, il lui faut de la mémoire, à lui aussi, il s’insinue, prend sa place, repousse Jassy vers le fond, dans l’obscurité.
Ce ne sont pas seulement les souvenirs qui se décolorent et s’effondrent. Les mots aussi, qui sont venus quasi spontanément à la rencontre des choses, sont venus approximativement nommer les choses rencontrées, les tuyaux, les plaques de ciment, les panneaux de publicité pour Coca-Cola, les arbres dénudés, l’ondulation des collines,— ces mots, si je les utilise trop pour penser à ce que nous venons de quitter, pour en parler dans des conversations, deviendront eux-mêmes usés et inutilisables, ils me tomberont des mains. Je les aurai discrédités et avilis, et je n’aurai plus le recours d’en susciter de nouveaux pour les remplacer, de trouver des expressions acceptables, exactes, vivantes, qui auront passé le test de la confrontation avec la perception.
€ 15.00