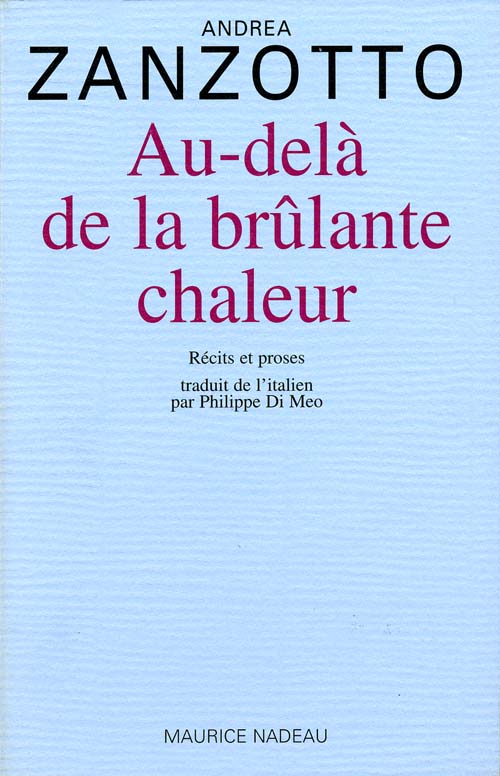Au-delà de la brûlante chaleur
"Il s'agit de portraits gravés d'une main ferme. Il s'agit de "coeurs simples" mais riche d'humanité, ou de femmes de quelque façon détestables, ou enfin, grotesques, chez lesquelles l'indignation éventuelle se travestit d'ironie. Extraordinaire est la faculté de saisir des gestes (...) qui peuvent résumer le sens de la vie..." Cesare Segre.
Récits et proses. Traduit de l'italien par Philippe Di Meo. 217 p. (1997)
Extrait
AUGUSTA
L’histoire d’Augusta s’achève elle aussi et le fossoyeur jette les dernières pelletées de terre sur son cercueil, tandis que les quelques petites femmes qui l’ont accompagnée savourent d’avance le verre de vin du bistrot proche. Augusta était vieille, mais encore utile, et tous la voyaient volontiers travailler chez eux à des montagnes de linge, coudre et repriser, tandis que les heures passaient et qu’elle demeurait silencieuse ou récitait des litanies à voix basse. Et lorsqu’à l’heure du repas, toute contrite, elle consommait ce qu’on lui servait, du fait de son attitude, les plus pauvres eux-mêmes éprouvaient le sentiment d’une certaine grandeur et d’une puissance personnelle. Elle ne possédait rien, Augusta, elle ne voulait rien : si elle recevait des dons, elle les offrait par la suite aux enfants des autres. Elle avait des parents éloignés toujours aux prises avec des difficultés économiques, qui habitaient la ville et constituaient sa plus grande préoccupation : en sus de sa nourriture, pour eux, elle osait demander, également un peu d’argent comme rétribution de sa journée de travail qui durait dix heures. Battant des paupières, elle levait la tête et regardait fixement droit devant elle de son regard de myope, elle lâchait un chiffre, ridiculement bas, presque avec honte, et on lui donnait presque toujours davantage, trop heureux d’apparaître généreux à si bon compte à cette occasion. Elle protestait, mais elle se résignait ensuite à accepter par amour pour ses parents. Depuis qu’elle était devenue si vieille, elle ne travaillait plus aussi bien que par le passé, car ses mains, autrefois habiles, étaient devenues mal assurées tandis que sa vue allait toujours diminuant. C’était une scène pénible que de devoir lui faire remarquer ses erreurs, car elle en souffrait trop ; elle bégayait, elle rougissait et puis demeurait longtemps immobile, la tête baissée, les yeux clos.
Au cours de la guerre, alors que tous avaient fui, elle seule était restée à garder la maison de ses hôtes, un Allemand était venu et il l’avait menacée avec la crosse de son fusil, lui laissant trois minutes pour plier bagage. Claquant des dents, telle une poule apeurée, elle avait couru deçà delà par la cuisine et elle avait fini par n’emporter qu’un parapluie. Entre-temps, dans le sinistre soleil du mois d’août, avec application, l’Allemand mettait le feu à la maison. Plus tard, par charité, on avait donné à Augusta quelques vêtements et quelques meubles, mais après ce malheur, il ne lui avait plus été possible de trouver un logement avantageux. Elle avait dormi tout un hiver dans un grenier et on l’y avait trouvée évanouie ; là, l’eau gelait dans la cuvette et le broc, et les poutres étaient si basses que, bien que très petite, elle s’y cognait. Elle avait peur du noir, et sa véritable terreur était peut-être l’ombre obsédante de ses dernières années. En cas de black-out, elle devait circuler avec une petite lanterne aveugle et une fois, alors que celle-ci s’était éteinte, troublée, elle n’avait plus osé bouger, jusqu’à ce qu’elle n’ait entrevu un passant auquel elle avait demandé de l’aide. C’était par une soirée enflée de pluie que cet individu s’était approché, il avait dévisagé Augusta et voyant qu’il avait affaire à une vieille femme, il l’avait plantée là, avec un cri malséant. Et, sans aucun secours, elle s’était donné du courage, elle s’était agrippée dans la ténèbre jusqu’à ce qu’elle fut rentrée à la maison après l’heure du couvre-feu, ruisselante et toute dégoulinante de sueur ; il s’en était fallu de peu qu’elle ne tombât dans la rivière. Elle rappelait souvent cet événement comme l’un des plus sinistres de sa vie. Dans cette obscurité, qu’elle avait pu ignorer jusqu’alors, un monde de ténèbres absolues, de mots abjects, plus inhumains que le feu des Allemands, s’était révélé à elle.
Mais ces derniers temps, elle était contente parce qu’elle était parvenue à se dénicher une chambrette propre, et de ce réconfort elle remerciait à toute occasion le sort et les hommes. Au bout de ses journées, au-delà de la pénombre des rues, elle voyait cette blancheur de chaux, la lampe à pétrole, sa petite table ainsi que son livre de prières ; mais cette lampe aussi avait été méchante, et une fois, alors qu'elle s’était penchée juste au-dessus, la lampe avait commencé à lui brûler ses cheveux. C’est pourquoi elle désirait, sans se l’avouer, de la lumière électrique dans sa chambre. Peut-être que l’endroit aussi était malsain pour elle, à cause du fleuve putride tout proche, à cause de certaines gens qui hurlaient trop, à cause de ces énormes flaques d’eau sur la route après chaque orage. Mais Augusta aurait eu honte de découvrir en elle des doutes quant à la bonté de la nature, du monde, même après ces dernières amères expériences ; elle savait traverser la vie presque en vertu d’un devoir auquel elle ne pouvait se soustraire, et, dans le même temps, comme distraitement. Elle n’avait jamais véritablement éprouvé le poison de la solitude, même si la perte de certains objets dans l’incendie (les menus souvenirs de sa mère, le livre qu’elle avait reçu en prix à l’école, sa chaise qui ressemblait à un fauteuil) avait ouvert dans son cœur un vide qui parfois l’étouffait.
C’est peut-être parce que son monde était tout peuplé par son imagination confiante qu’elle n’avait pas éprouvé le besoin de se marier. On savait peu de chose à propos de cet aspect de son existence. Durant les dernières années de sa vie, un vendeur ambulant de son âge qui habitait la montagne s’était intéressé à elle. L’ayant aperçue dans l’une des maisons qu’elle fréquentait et su combien elle était dure à la tâche, il avait pensé à la bonne rente qu’elle lui aurait procurée et à une possibilité de repos pour lui-même. Mais il n’avait jamais mis ses projets à exécution, qui, au reste, étaient apparus presque coupables à Augusta. Il avait repris ses tournées par les routes de la région, il avait été la victime d’un curieux accident et il fut par la suite interviewé quelque temps après par un journal du soir.
Quant à l’époque de la jeunesse d’Augusta, on en savait encore moins. Certains se souvenaient d’un homme, vendeur ambulant lui aussi, plutôt bavard et sûr de lui, qui avait fait à Augusta tout un tas de promesses, puis il n’avait plus donné signe de vie. De ce dernier, on était seulement sûr qu’il habitait sur les rives de la lointaine rivière Cormor, et on précisait encore qu’il portait uniquement des chaussures jaunes. Personne ne savait quels échos ces épisodes avaient laissés dans l’esprit d’Augusta : peut-être que ces deux prétendants, ensevelis sous les myriades des points de couture qui l’avaient peu à peu étourdie et rendue aveugle, affleuraient de loin en loin derrière elle, fantômes légèrement ridicules avec les journaux du soir grands ouverts et annotés de rouge, ou avec un maintien sûr et un jaune éclat de chaussures.
Ah, mais ils avaient mal fait ces gentilshommes de perdre de vue et de se laisser perdre par Augusta. S’ils l’avaient vue à certaine heure des après-midi du dimanche monter par la rue de l’église, vers l’office ! Toute menue, elle avançait à petits pas, un peu courbée, ses cheveux blancs bien coiffés, vêtue de son long pardessus noir luisant, serrant les paupières dans la grande et chaude lumière. Elle montait par cette rue et son incertitude et son humilité l’éloignaient tant et tant des choses terrestres ; saintement gauche dans sa démarche comme dans son attitude (elle aussi un peu albatros sur le pont d’un bateau), elle laissait derrière elle, ici, dans le monde de l’idiotie et de la mâle assurance, les passants qu’elle saluait avec le plus grand des respects, le cavalière gras du gras jaunâtre de ses coûteuses mangeailles, la patronne enclose dans ses voilettes et ses parfums comme dans un traquenard, le type aux frisettes nauséabondes collées sur sa nuque et à la bouche, l’estomac et la bedaine fourrés de journaux sportifs, la bigote ruminant dans le creux de sa très petite tête son attention médisante.
Vous avez mal fait ô vendeurs ambulants, pire, vous ô cavalieri ou bigotes et caetera, à ne pas faire davantage cas de la grande heure d’Augusta. Mais elle, elle porte son long et luisant pardessus noir boutonné jusqu’aux pieds et, presque aveugle, elle marche, clignant des paupières, fermant les yeux à demi ; oui, elle aura bien le temps de vous saluer, de vous présenter ses respects et peut-être même de vous coudre des chemises.
Au reste, n’y pensez pas, personne n’y pense plus là-haut, dans la montagne, dans l’intervalle des soucis du commerce ambulant, personne n’y pense plus, sur les rives cimmériennes du Cormor.
€ 20.00