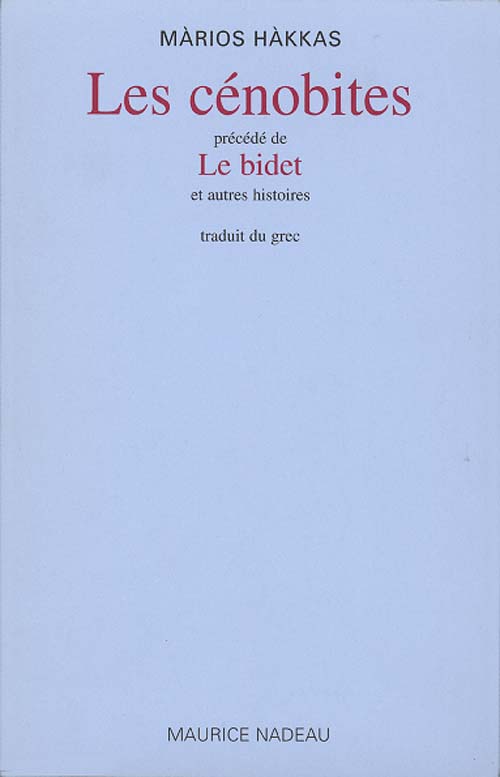Les Cénobites précédé de Le bidet et autres histoires
Mirios Hakkas croyait à un monde plus juste : il fut broyé, comme tant d'autres, entre le pouvoir de droite et les caciques de son parti. Puis ce fut la lutte finale : un vain combat contre le cancer. Mort à 40 ans, Hakkas n'a laissé que trois livres, dont voici les deux derniers. Les nouvelles du Bidet (1970) et des Cénobites (1972). Traduit du grec par Noëlle Bertin, Yseult Dimakopoulos, Dominique Dourojeanni et Michel Volkovitch. 161 p.(1997)
Né en 1931, Marios Hakkas passe sa vie dans la banlieue populaire d'Athènes, hormis les années de prison (1954-1958 puis un mois en 1967), en raison de son engagement politique. Atteint d'un cancer en 1969, il consacre tout son temps à l'écriture et meurt en juillet 1972.
Extrait
PRÉFACE
Màrios Hàkkas en aura bavé toute sa vie. Né en 1931 dans une famille pauvre, il grandit sous l’Occupation, puis la Guerre Civile. Devenu communiste, il est persécuté en même temps par la droite au pouvoir, qui l’envoie en prison pour quatre ans, et par le Parti, que sa franchise indispose. Il vit de petits boulots, représentant, artisan, consacrant tout son temps libre à l’association culturelle qu’il a fondée avec des amis. A trente-huit ans il attrape le cancer, et meurt trois ans plus tard.
Ses écrits ? Quelques poèmes, trois pièces en un acte, trois recueils de nouvelles. C’est tout. Une œuvre en miettes, comme sa vie. Des pages volées à cette vie trop dure, puis à la mort ; les unes griffonnées en hâte sur des paquets de cigarettes, les autres dictées sur des lits d’hôpital. Au fond, vu les circonstances, Hàkkas n’a pas peu écrit, mais beaucoup...
Comme tout ce qu’il a laissé. Le bidet (1970) et Les cénobites (1972), ses deux grands recueils, sont d’abord une chronique : l’histoire d’une vie, la sienne, à peine teintée de fiction ; et en même temps, celle de sa génération. Une autobiographie collective.
Ils étaient jeunes, idéalistes, et la plupart ont héroïquement résisté à la répression. Vingt ans plus tard, on les retrouve embourgeoisés, avachis, vaincus par le confort moderne. (Enfin, tout est relatif : ce que l’auteur reproche à ses compatriotes, c’est de se faire installer... un bidet.) Triste Grèce des années 60, encore secouée par son passé, déjà bousculée par le futur. Le bidet, ricanant requiem pour une génération foutue, festival de sarcasmes et de provocations diverses, en trace un portrait plein de rage, d’humour, de féroce lucidité.
Mais Hàkkas n’est pas seulement un virtuose de la satire. Il a beau râler, sa tendresse affleure à toutes les pages ; il n’y a qu’à l’entendre évoquer Kessariani, le faubourg populaire d’Athènes où il passa toute sa vie, où se déroulent ses histoires, et les petites gens qui l’habitent. Et puis Hàkkas n’a pas l’esprit sectaire, le monde pour lui n’a pas cette allure bien carrée, les bons ici les méchants là-bas, si rassurante pour les naïfs. Il sait voir les pailles et les poutres dans tous les yeux — y compris dans les siens. Où a-t-il donc appris ça, en ce temps-là ?
En plus il est maladivement honnête. Il dit tout, c’est plus fort que lui. Voilà ce qui l’a perdu — et sauvé. Hàkkas est grand pour avoir vécu, pensé, écrit, non comme on le lui disait, mais comme il le sentait ; pour avoir été libre, de plus en plus. Et Dieu sait combien c’est difficile — surtout quand à vingt ans on était à genoux devant la statue de Staline. Les livres de Hàkkas (c’est là un de leurs points communs avec l’impressionnant Toi au moins, tu es mort avant de Chronis Missios), sont l’histoire d’un homme qui peu à peu, à travers mille épreuves, se libère des autres et de lui-même.
Mais justement, si Hàkkas est devenu un écrivain majeur, c’est que cette liberté conquise, il sait aussi, comme Missios, la faire passer dans les mots. Dès les premières nouvelles du Bidet, il a trouvé sa voix, ce ton à la fois désinvolte et brûlant, tout en ruptures, dérapages, télescopages, bouffées de fantastique et d’absurde... Mais c’est le cancer qui va le mener plus loin encore.
Sans doute, la maladie n’a pas bouleversé sa trajectoire d’écrivain : en découvrant le mal dans son corps, Hàkkas a dû y voir une confirmation, une cristallisation en lui du mal qui l’entourait ; dans ce qui lui reste à écrire, déchéance physique et décomposition sociale serviront de métaphore l’une à l’autre. Le cancer a surtout joué un rôle d’accélérateur : des derniers textes du Bidet, œuvre d’un condamné à mort, aux Cénobites écrits par un mourant, on voit l’homme et l’écrivain mûrir à toute allure, jusqu’aux trente pages hallucinées qui viennent clore ce volume et sa vie. Une débâcle et une envolée, la narration qui part en tous sens, rêves, souvenirs, visions, monologues à plusieurs voix, phrases explosées, mots qui éclatent en assonances, en calembours — le bouquet final.
L’étonnant, c’est que malgré douleur et désespoir Hàkkas n’ait jamais cessé d’écrire, de lutter, avec l’allègre furie de celui qui donne tout ce qu’il a. Contrairement au Mars de Fritz Zorn, autre grand livre inspiré par le cancer — et dont la seule lecture a de quoi le donner —, Le bidet et Les cénobites ne sombrent pas dans la déprime. Ces pages dilatent le cœur en même temps qu’elles le serrent ; entre angoisse de mourir et jubilation d’écrire, elles émettent jusqu’au bout une lueur qui réchauffe, intermittente et obstinée comme un clignotement d’étoile. Des médecins grecs les ont fait lire à leurs patients condamnés, pour les aider à mieux mourir ; quant à nous autres, les sursitaires, comment ne pas être fiers de lui, de cet homme seul et minuscule dans la nuit éternelle, ce nargueur de néant, lançant jusqu’à la fin ses fusées — si vivant jusque dans la mort ?
Traduire Le bidet, et surtout Les cénobites, est une gageure ; nous ne l’avons pas entièrement tenue. Manquent ici trois nouvelles du premier (15 pages en tout) et deux longs textes du second (65 pages), pleins de jeux de mots longuement filés, dont il ne serait pas resté grand-chose en français.
Le texte grec est parfois obscur, délibérément ; il n’était pas question de le rendre ici plus clair. Les allusions à la réalité grecque de l’époque, en revanche, sont expliquées dans les notes en fin de volume.
Sans le soutien patient de Marika Hàkkas, épouse de l’auteur, qui nous a commenté le texte grec mot par mot, et de Spyros Hàkkas, frère de Màrios, ce travail eût été quasiment impossible. Nous leur dédions cette version française, avec toute notre affection.
Michel Volkovitch
QUAND LA MORT SE POINTE
Ce n’est pas que j’aie peur de la mort. J’ai l’angoisse d’être pris de court alors que j’ai un tas de choses à faire, et d’autres mal faites à corriger.
Ce que j’aimerais être à la place du marchand de cigarettes ! Peu avant de rendre l’âme, il a dit à son fils : « Je dois 126 drachmes à la régie. » « D’accord, a dit le fils, mais guéris d’abord ». « Non... Maintenant... Va les payer et rapporte-moi le reçu. Je ne veux rien devoir à qui que ce soit... Je vais peut-être bientôt mourir. » C’était pour lui la seule chose urgente. II a attendu le reçu pour claquer.
Moi, il me manque des millions de reçus, une foule de choses urgentes m’attendent et si je dois soudain partir, tout restera en plan : les livres que j’écris, les femmes autour desquelles je tourne en comptant bien les sauter un jour, les voyages que je projette, l’opération que je remets chaque fois et qu’il faudra faire à la fin.
Si j’étais Maria, je n’aurais pas d’objection. Qu’aurais-je encore à faire parmi les hommes ? Peut-on aller plus loin quand on est prêt à réagir ainsi ? Maria, en effet, a même eu le courage de gronder sa sœur qui lui avait rendu visite à l’hôpital : « Pourquoi venir me voir au lieu de faire à manger pour ton mari ? C’est les vivants qu’il faut aider. » Puis elle est tombée dans le coma. Les courts moments où elle revenait à elle, on l’entendait gémir : « Les vivants... Les vivants... »
C’étaient tous les deux des êtres parfaits, jusqu’à la fin ils ont su ce qu’ils faisaient, alors que moi, je patauge depuis le début, j’ai perdu tous mes amis, mes partisans, mes idées souvent, et il me faut du temps et du courage pour les regagner car je ne peux pas partir comme ça en douce, sans un reçu, comme ce brave marchand de cigarettes, sans quelque chose enfin, qui dise que je suis en règle.
Celui que je ne peux pas oublier, c’est le marchand de cigarettes. J’achetais tous les jours un paquet d’Assos et lui donnais une drachme. Il se tenait toujours dans le même coin et amenait la pièce sous ses lunettes de myope, la bouche entrouverte, comme s’il voulait la mordre. Un matin, il n’était pas à son poste. « A l’hosto », me fait le patron du café. « Le cœur. Il est cuit. » Je me suis retrouvé la bouche entrouverte, la pièce à la main, et comme j’étais énervé de ne pas avoir de cigarettes, je me suis mis à la mordre. Furieux, j’ai couru au kiosque le plus proche. « Assos », ai-je demandé. « J’en ai pas », a dit le gamin du kiosque. Voilà maintenant des années que la mort me fait signe alors que je mordille ma pièce, juste avant d’acheter des cigarettes. Je m’attends à un : « Y en a plus pour toi, fini, tout est fini », et ce qu’il y a de moche, c’est que je ne serai toujours pas prêt, avec cette drachme pour payer mon passage, une petite pièce de rien du tout, un symbole usé pour passer de l’autre côté.
Et pourtant, il y a des gens qui sont fin prêts au moment de partir : madame Koùla qui est allée sur les lieux saints rien que pour s’acheter un linceul, monsieur Ioachim aussi, qui avait tout réglé, mais ne voulait pas partir avant qu’un homme ait marché sur la lune.
Souvent je pense à Emilia, un peu plus jeune que moi, cinq opérations, trente-cinq kilos, la peau sur les os ; ses yeux seuls étaient restés pareils, grands et lumineux comme avant. A l’hôpital, la veille de sa mort, elle regardait par la fenêtre. « Sàkis, quand on rentrera, on emportera une bouture de ce rosier. On n’a pas cette variété à la maison. » « Oui », répondait son mari, triturant de ses doigts moites les papiers au complet dans sa poche : facture du cercueil, autorisation de sortie de la morte, formalités pour l’avion. « Sàkis, est-ce qu’il y a des formalités spéciales pour le rosier dans l’avion ? » Et peu avant qu’on la ramène sur la table d’opération : « Pas sur ma tombe. C’est à la maison que je la veux. » Elle savait que c’était la fin, qu’elle ne reverrait pas la lumière du jour, ni les roses du jardin, ni les étoiles au ciel et pourtant, jusqu’au dernier moment, avant d’être opérée pour la sixième fois, elle chantait et sa chanson résonnait dans les couloirs : « Quand brilleront les étoiles... » Pour les autres, bien sûr.
Moi, tellement gangrené par la pourriture de cette époque, je n’aurai même pas le courage, à ce moment-là, de faire un geste pour chasser une mouche, encore moins de chanter pour donner de l’espoir aux autres. Je ne pourrai pas dire le moindre mot pour les autres. Quand je pense à l’époque où avec Emilia on défendait la cause du peuple... J’étais comme une feuille — pas une feuille jaunie qu’on garde entre les pages d’un livre, mais une belle feuille toute verte, sur un arbre, tout sourire et fraîcheur. Maintenant, j’ai l’impression d’avoir parcouru tous les sillons de ma main, d’arriver au bout de mon rouleau et je me laisse recouvrir par la poussière. Je ne peux pas revenir en arrière et ramasser les vers que j’ai semés à droite et à gauche ; ni accepter ce que j’ai vécu, alors que j’entame la dernière ligne droite, sans pouvoir me payer le plus pauvre linceul, ou donner la pièce aux brancardiers, sans même un bon poème à montrer au passeur.
Traduction : Noëlle Bertin
€ 15.00