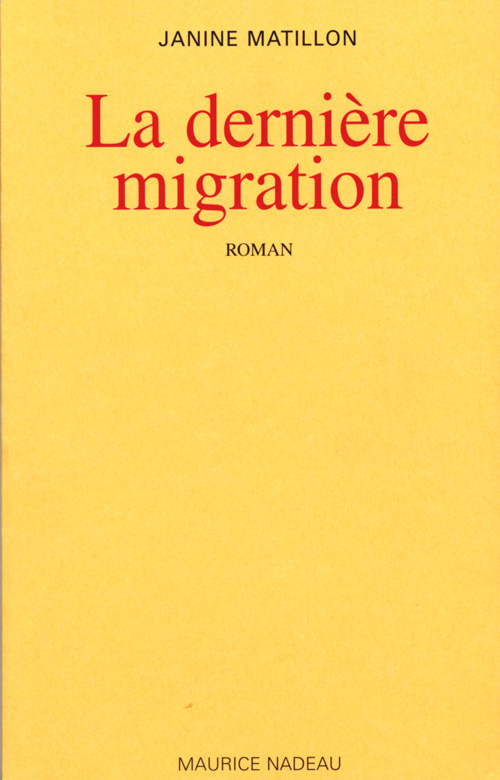Dernière migration
Cela paraissait impossible, inconcevable, et pourtant c’est arrivé : les affamés du monde entier, ceux d’Afrique les premiers, parce que les plus proches de notre continent ont traversé les mers, ont envahi nos villes, se sont répandus dans nos campagnes. Noires armées de moribonds venus nous demander des comptes. La puissance visionnaire de Janine Matillon, dont on n’a pas oublié l’Orimita bosniaque d’il y a deux ans, s’exerce à nouveau à plein dans cette fiction en forme d’ultime appel au secours. 232 p.18 euros. (1998)
Extrait
Ils l’ont fait. Ils sont tous venus. Parfois l’inconcevable arrive. Ils ont traversé les mers. Je les ai vus, de mes yeux vus. Affaiblis par les maladies, minés par l’avitaminose, engourdis par l’hypoglycémie. Les affamés du monde entier, répandus en rangs serrés dans nos champs et dans nos villes, et qui ressemblaient vus de loin à de noires nuées d’orthoptères acridiens.
Et ma mère et moi nous restions impassibles, accoudés au parapet de la terrasse. Nous les regardions sans broncher sortir du bois, envahir la prairie en pente, monter péniblement vers nous, nous ne parlions pas, car nous ne trouvions rien à dire. Cependant, comme le flot allait nous atteindre, ma mère prit sur elle de rompre le silence, et ce furent ses dernières paroles :
— Tu vois ici l’illustration finale d’un vieux thème, celui de la faim, dont nous connaissions assez bien les lois, économiques, politiques et même météorologiques, et dont nous étions à même de comprendre le fonctionnement structurel. Mais, Christian, qui aurait pensé qu’un fonctionnement structurel pouvait se déchaîner, semblable à la colère de Dieu ?
Au même instant, je poussai un cri qui résonne encore aujourd’hui à mes oreilles. Les mâchoires d’un piège à renard s’étaient refermées sur ma jambe, au-dessus du genou. Mais ce n’était pas un piège à renard. C’était une main monstrueuse, une main déformée par les rhumatismes, plus brune que noire, semblable à une racine fraîchement arrachée. Ensuite, je ne fus plus que deux jambes courant à une vitesse jamais atteinte par l’homme, d’un trait, jusqu’à la vieille chapelle, jusqu’à la lourde porte derrière l’autel défoncé, jusqu’au souterrain où je suis enfermé.
C’est que j’avais vu le visage, semblable à une motte de terre effritée. Et dans le visage, j’avais vu les yeux, des yeux qui me regardaient fixement, érodés par l’infection conjonctivale, l’envahissement vasculaire des cornées, les cicatrices rétractiles qui retournaient les paupières supérieures, enfin la multiplication des cils, dont la moitié avaient poussé vers l’intérieur. J’ai été regardé par ces yeux. Plutôt mourir de faim ici que de remonter là-haut, à la surface.
Pendant tout un temps que je ne peux mesurer ni en heures ni en jours, je n’ai rien redouté, je n’ai rien désiré, je n’ai pensé à rien. J’ai hurlé ma faim en me roulant par terre, avec des douleurs étrangères installées dans mes viscères, les tempes serrées dans un étau, le crâne ceint d’un cordon de feu passant au-dessus des oreilles, la face coupée en deux morceaux par la migraine. C’était le premier stade de la faim. Il est passé. J’ai encore des crampes, des palpitations. Une boule parfois m’obstrue la gorge. J’éprouve dans les membres et le cou même lorsque je suis allongé sur le sol une faiblesse extrême, expression non pas du repos, mais d’une diffuse, d’une douloureuse précarité. Cependant, la faim ne me torture plus, je n’en éprouve plus la sensation. Ce qui m’importe maintenant, c’est d’employer mes faibles forces à réfléchir. C’est de revivre mes derniers jours d’homme de la surface, d’aller fouiller dans ma mémoire avant qu’ils tombent au fond des trous que l’avitaminose est en train de creuser dans ma moelle cervicale et dans mes lobes sphénoïdaux. Ce qui m’importe, c’est de savoir s’il y a eu ou non des signes avant-coureurs. Si j’aurais, si nous aurions pu deviner que l’impossible était en marche. Si l’on nous a eus par surprise, ou alors, dûment avertis. J’ai ma dignité. Je veux savoir si je dois mourir en victime, ou en imbécile.
€ 18.00