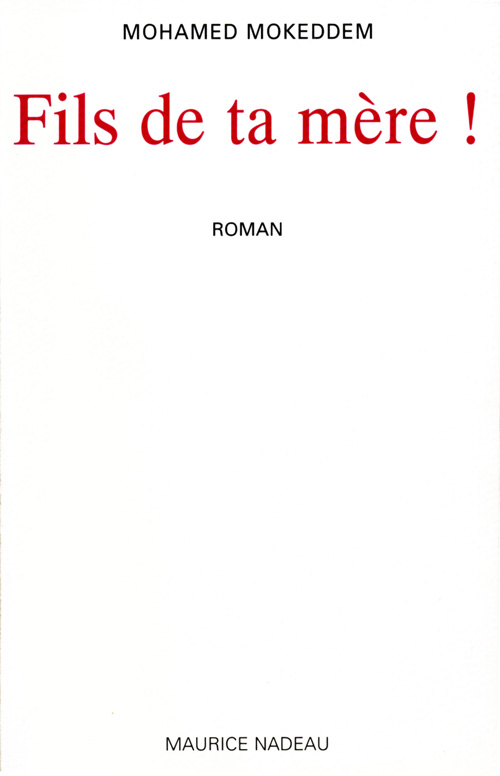Fils de ta mère !
Une enfance, une adolescence en Algérie, à Mascara, dans les années soixante. Le narrateur nous fait participer à ses joies comme à ses humiliations, à sa révolte d’adolescent. Revenu dans son pays, en 1994, il échappe au tir d’un pistolet. Il choisit définitivement l’exil. Une écriture qui fait également la qualité de cet ouvrage : précise, colorée et d’une grande force. Roman. 250 p. 18,50 euros (1999) / ISBN 978-2-86231-151-7 Mohammed Mokeddem est réalisateur de cinéma et metteur en scène.
Extrait
Parler de ma ville natale est une douleur, ne pas en parler en est une autre.
L’été est lourd à Mascara. Les moineaux meurent d’insolation ou piégés par des miettes de pain prisonnières du bitume que le soleil d’été ramollit, les pneus pétrissent, écaillent à chaque passage. Il souffle un vent d’ouest chaud, asphyxiant, chargé de poussières et de sable qui brûlent les yeux et la peau, accablent de leur poids les cyprès centenaires et les palmiers nains dispersés dans le centre-ville. L’hiver y est rigoureux, glacial. Les eaux des pluies torrentielles dévalent des hauts quartiers charriant sur leur passage, cailloux, immondices et menus objets en plastique, rejoignent péniblement le chemin qui mène vers le petit oued, se changent dans les espaces plats et boueux en flaques immenses qui survivent jusqu’aux premières ardeurs du soleil d’été.
Mascara est une ville dont on peut mesurer la circonférence en deux heures de marche sans que son charme effleure la convoitise des yeux. Une artère la casse en longueur, de Bab-Ali à la route de Saïda en passant par le centre-ville. Une autre s’allonge vers l’est rejoignant la route d’Alger, et à l’ouest celle d’Oran, segmentant la ville en nord et sud : le Bab-Ali populaire avec ses maisons basses et ses grosses poubelles, et le Faid’Herbe bourgeois avec ses villas enlaidies par un nouvel étage et une enceinte en briques.
Nul ne sait vraiment d’où lui vient ce nom, de son passé guerrier ou d’une charade, le masque à rat. Les Egyptiens disent « maskhara », la mascarade, insistant souvent sur le « kha » et le prolongeant par un vulgaire geste de la main pour signifier le caca. Mascara sent mauvais à cause de ses péchés et de l’oued Aïn Sultan, une blessure toute en longueur, béante, difficile à cacher, qui prend son élan et son poids de saletés et de puanteur de Filaj Errih, serpente et traverse Bab-Ali, la Rekkaba, arrosant en chemin le jardin Pasteur dont l’allée principale débouche sur les quartiers de la Gare et Sidi M’hamed au sud-est, rejetés hors des limites de la ville par les quelques fragments de muraille qui persistent sur le flanc sud ; c’était le Village Nègre, du temps de la colonisation. Au-delà, les fertiles terres d’el Kouaïr.
Mascara, Mouaskar, Oum el Assaker, c’est la caserne, la mère des combattants, la ville de l’émir Abdelkader, des moudjahidines qui ont fait sortir la France ! et des walis ou marabouts, saints hommes détenteurs de la baraka, intercesseurs entre Dieu et les hommes. Les koubas, ces mausolées où reposent la dépouille, la mémoire, le mythe et le don du marabout, sont objets d’orgueil et de vénération pour chaque quartier de la ville. Sidi Boudjellal, dans l’Argoub, guérissait tous les maux, sentimentaux entre autres, attirait sous l’ombre des murs de sa kouba régulièrement chaulés par les âmes charitables, les femmes désespérées par l’infidélité de leurs époux, et les hommes soucieux de se remarier. Aucun conducteur d’engins n’avait voulu marcher sur le saint homme lorsqu’il fut décidé d’élargir la route dite d’Oran dans les années 70. La France ne fut-elle pas mise dehors lorsqu’elle s’attaqua aux koubas des Ouled Sidi Cheikh ? La malédiction pouvait s’abattre sur le conducteur et sa descendance. Le Génie contourna l’édifice, et la route avala le cinéma Olympia. Autour des plus célèbres des marabouts, particulièrement ceux dont la kouba est située hors de la ville, on organise des ouadas, fêtes annuelles mi-religieuses mi-païennes. Celles de Sidi Daho, de Sidi Ali Ben Otmane et Sidi Kadda sont prestigieuses ; les cavaliers viennent des quatre coins du pays pour participer à la fantasia et les pauvres pour déguster le couscous généreusement servi par les familles riches. Cependant, certains marabouts sont factices, notamment ceux dont la tombe n’est entourée que d’une vulgaire enceinte en pierres et qu’on appelle une haouita : l’administration coloniale les avait fabriqués pour tenir en laisse la population. On annonçait la mort d’une personne, on enterrait une charogne à la place, et le lendemain on faisait réapparaître le défunt dans le village. Fascinés par le prodige, et convaincus de la sainteté du ressuscité, les révoltés se calmaient pendant quelque temps.
Certains quartiers de la ville portent encore aujourd’hui le nom de leur marabout, tel Sidi Boussekrine, Sidi Bouras, Sidi Boudjellal ; rues et îlots s’associaient à une personne, un animal, une plante, un objet, ou une couleur. Il y avait Filaj Errih (village du vent), Filaj Djendrou, Quarti Bendaoud, Quarti Lalijou, la route du R’ha à cause du meunier, la rue Zaghbou à cause de son épicier, la rue de Kheïra cow-boy à cause d’une infirmière qui portait le pantalon et se déhanchait comme Gary Cooper, Trig el Kebira (la grande rue), Trig Sebitar (rue de l’hôpital), Trig Coriat (rue du pharmacien Coriat, un colon). Même quand ils provenaient d’institutions officielles, les courriers portaient ces dénominations populaires, autrement ils se perdaient ou parvenaient avec un mois ou deux de retard ; ceux qui savaient lire et écrire ignoraient eux aussi l’adresse exacte.
Des familles entières, des fragments de douar, de tribu habitaient un îlot ou se partageaient une rue. Quatre à cinq familles se retrouvaient dans la même maison, le haouch, occupant chacune une pièce ou deux. On tenait cuisine dans la cour avec une marmite, deux plats creux, quelques cuillères, un couteau à cran d’arrêt pour éplucher les légumes, couper la viande et le tissu, et que les garçons subtilisaient le soir.
€ 18.00