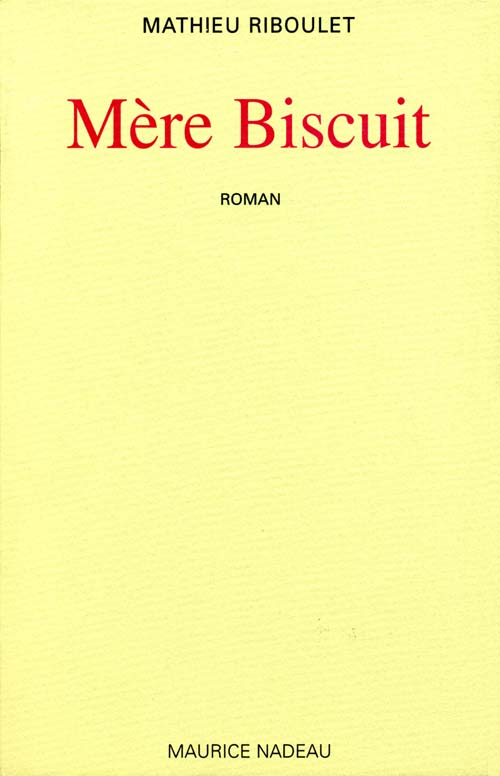Mère Biscuit
Alors qu'il veille la dépouille mortelle de Marie-Louise, sa grand-mère adoptive, dite la Mère Biscuit, le narrateur, lui-même gravement malade, se remémore son enfance, son premier amour : Antoine, le petit neveu de cette paysanne qui l'a pratiquement élevé, puis se perd en rêveries sur ce qui a pu être la vie de cette femme avant sa propre naissance. Entre hallucination et réalité, entre maladies mortelles et maladies d'amour, entre première et deuxième guerre mondiale revisitées du fond d'un lit d'hôpital, la révélation progressive de quelques principes de vie... 106 p. (1999) ISBN 978-2-86231-150-0
Extrait
C’était mon premier cadavre. Marie-Louise Dontreix, quatre-vingts ans, dite la Mère Biscuit. Les morts que j’avais vus jusqu’ici étaient vivants. J’aspirais à une grande quantité de silence, une épaisseur suffisante pour m’y envelopper, peut-être dormir. Au lieu de ça, je devais me colleter avec l’air desséchant de l’été et ma nouvelle responsabilité de croque-mort d’un jour, quand je mourais d’envie de givre, de cris des choucas tournoyant, hargneux, au-dessus de nos têtes rétrécies par le froid.
J’étais victime de l’usage, encore en vigueur dans nos contrées isolées, qui veut que les morts soient portés en terre non par la famille mais par les habitants du village, usage en perte de vitesse eu égard à la fuite des forces démographiques qui est désormais notre lot. La défunte était ma voisine. En outre, elle avait été ma grand-mère adoptive, la voix d’aînesse qui m’avait guidé tout au long de l’enfance. Question famille, j’avançais sur une étroite bande de sable fin. Mes grands-parents étaient morts, mes parents muets ; les premiers disséminés bien avant ma venue au monde, qui en camp de prisonniers, qui en hôpital communal, les seconds écrasés de fatalisme et de banalité, tant qu’aujourd’hui je peine à me remémorer le son de leur voix, l’accent de leur rire, si tant est qu’ils aient ri. Démissionnaire, dilapidé dans l’espace comme dans le temps, mon père s’éloigna de la maison en cercles concentriques dès ma deuxième année pour finir par disparaître tout à fait, du côté d’Angoulême je crois. Ma mère, dents serrées, vitupéra par acquit de conscience sur le mauvais sort qui lui venait toujours de l’ouest, du versant atlantique du monde, et bientôt se tut tout à fait, se diluant dans une mélancolie qui confinait à la stupeur. Je n’eus pas à accomplir le moindre deuil de ces deux-là qui travaillaient au loin, en tous sens des termes, mais m’y attarder est au-dessus de mes forces. Je dus en revanche apprivoiser l’insensibilité qui me tenait lieu d’amour filial et dont, où que mon regard se posât, je ne trouvais nul exemple autour de moi, ni au village ni à l’école. Je ne m’ouvris jamais de cela ni du reste à l’énergique veuve qui menait à la baguette la principale ferme des environs et me servit de voisine immédiate, de garde d’enfant puis bien vite de mère et de grand-mère, au lâche soulagement de ma mère « légitime ». Je bénéficiai donc d’une éducation partiellement agricole, privilège qui allait déjà se raréfiant, aujourd’hui disparu. Elle avait dépassé cette quarantaine que j’approche avec un soupçon d’incrédulité, mais dans laquelle je me suis, à l’occasion d’une désorganisation passagère, prématurément et solidement installé.
J’aspirais au silence, donc, au repos, au clapotis des vagues dans les buissons dégarnis des bords de Seine, bien après Paris, en février, quand les contours des choses semblent sortir d’un rêve. Pourvu qu’il ne faille pas hisser le cercueil sur les épaules. Je suis rattrapé par mon manque de pratique des enterrements, par l’histoire familiale qui ne m’a rien légué sur le chapitre si délicat des rituels funéraires. J’ai bien quelques images en tête, de ces mouvements anciens que font les hommes quand ensemble ils se penchent vers l’un des leurs pour franchir avec lui ces quelques mètres de compagnonnage final, mais leur fluidité même en trahit l’origine : les écrans, les ombres, rien à voir avec la vraie vie. Sans être fluet je n’ai rien d’un costaud et guère que mon énergie nerveuse comme principe de déplacement. Rien qui permette de porter Marie-Louise et son coffrage vernissé ; l’addition de leurs poids respectifs doit former un chiffre extravagant. Y aura-t-il seulement des poignées ? En quelques instants me voici submergé d’interrogations, accablé de suppositions, en un mot en proie au doute : comment sortir de la pièce où elle repose, de la maison, comment enfourner puis extraire la chose du fourgon, de quel côté me placer, sans compter l’église, le curé, les pots de fleurs, le temps qu’il fera, que sais-je encore ?
La possibilité d’enquêter discrètement auprès des trois autres porteurs de cercueil se dissipe à peine évoquée : il y aura là Etienne Faure, que je ne connais que de nom, un dénommé Latour, qu’il a fallu aller chercher à Saint-Maurice, et Antoine Malterre, le bel Antoine avec lequel je fus élevé, un petit-neveu de Marie-Louise, que je n’ai pas revu depuis que nous avons, une fois, il y a quinze ans, couché ensemble. Aucun secours de ce côté-là. Et pas question non plus de compter sur le reste de la famille de la défunte, car elle est affligée, silencieuse et molle. Et puis ça ne se fait pas.
Une belle épaisseur de silence. Un murmure. Je rêve de ma dissolution à la pointe d’une feuille de hêtre, j’envie le paradoxe de la libellule, vibrionnante d’immobilité au-dessus des eaux, je soupèse le silence du granit. Envoyer promener la convocation funéraire et son cortège d’obligations sociales, les casquettes qui tout à l’heure s’inclineront, les rares hosties qui seront avalées, une paupière sincèrement rougissante, rare elle aussi, et remonter m’asseoir sous l’orme du Brulady pour arroser la mort de la Mère Biscuit. Sans doute pas de mes larmes, hélas pas de la sueur d’Antoine, mais plutôt d’un soupçon de tendresse volatilisé dans l’air du soir.
€ 15.00