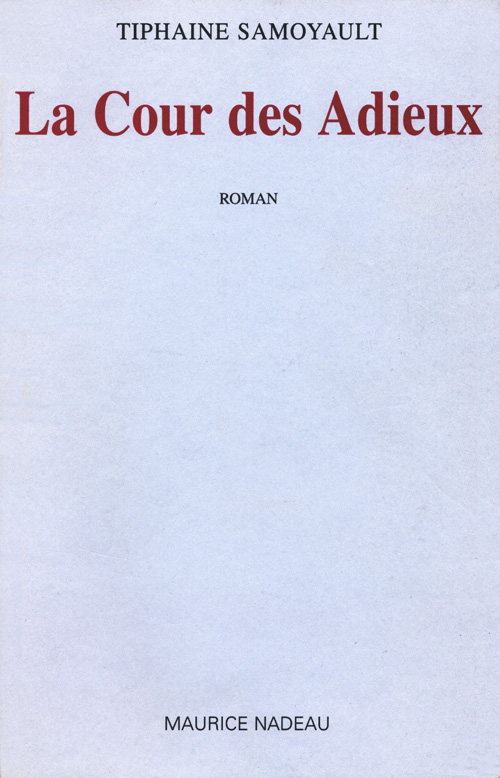La cour des adieux
Une enfance dans un château, le tournage d'un film, une rupture amoureuse : trois fils composent ce roman qui avance en tournant, comme les fenêtres autour de la Cour des adieux. C'est ainsi qu'une histoire individuelle s'enroule dans la grande, celle de la narratrice dispersée en plusieurs personnages, en plusieurs temps de vie, en plusieurs lieux de mémoire.
Tiphaine Samoyault (née en à Boulogne-Billancourt) est une enseignante universitaire, critique littéraire et romancière française, spécialiste de Roland Barthes. Elle a grandit à Fontainebleau, dans le château de Fontainebleau, dont son père était conservateur. Cette enfance sera évoquée dans son premier roman La Cour des Adieux, d'après le nom de la cour d'Honneur du palais, où Napoléon a fait ses adieux. Normalienne, auteur d'une thèse de doctorat sur les Romans-Mondes, les formes de la totalisation romanesque au vingtième siècle (1996) et d'une thèse d'habilitation sur l'Actualité de la fiction : théorie, comparaison, traduction (2003), Tiphaine Samoyault devient professeur en littérature comparée. Elle a dirigé le département de littérature comparée de l'université Paris-VIII jusqu'en . Ancienne pensionnaire de la Villa Médicis (2000-2001), Tiphaine Samoyault est aussi romancière et traductrice, entre autres, de portions de la nouvelle édition d'Ulysse de James Joyce et de l'essai de David Shulman et Charles Malamoud Ta'ayushn : journal d'un combat pour la paix : Israël Palestine, 2002-2005 (Le Seuil, 2006). Membre du comité de lecture aux éditions du Seuil, et a collaboré à La Quinzaine littéraire jusqu'en , date à laquelle la direction éditoriale (Jean Lacoste, Pierre Pachet et Tiphaine Samoyault) est évincée par Patricia De Pas. Après avoir démissionné avec la grande majorité des collaborateurs, elle est devenue membre de la direction éditoriale du journal en ligne En attendant Nadeau. Depuis 2022, Tiphaine Samoyault écrit un feuilleton pour Le Monde Livre. La Cour des adieux est le premier roman de Tiphaine Samoyault. 165 p. (1999)
Extrait
J’ai finalement décidé de donner à Élie le prénom d’Amédée et c’est Alain qui prendra celui d’Elie. Je veux écrire trois vies de mensonges et de pluies, elles réveillent ma nuit en sept hémisphères incomplets, elles éveillent des fantômes consistants. Cela a commencé là où certaines histoires finissent, par un rat derrière la tenture. Nous tournions un film rue Ramponeau, au cinquième étage d’un bâtiment industriel qui ouvrait des baies sur trois côtés de Paris. J’intervenais ce jour-là, je parlais de souris malignes coincées dans des chaufferies, déclenchant ainsi les alarmes des châteaux. Je connaissais bien mon texte, le problème n’était pas là mais les caméras, je ne sais pas, toute cette lumière, m’ont fait vaciller. Je voyais quelqu’un d’autre dans les tuyaux, derrière le rideau, je voyais une histoire qui n’était pas la mienne, celle d’un certain lecteur, peu habitué aux livres pour enfants (il s’est mis à lire sur le tard), je ne pourrais même pas dire qui. Il me semble que je racontais n’importe quoi, pourrais-je dire quoi ? Maintenant je festonne ma mémoire en rond, j’y conduis plein de vies destinées à devenir vagues. Les lieux ? Une grande chaumière ou un château. Les personnages ? Une équipe de tournage, Véronique, Florence, Élie, Amédée, il, elle, moi et quelques autres. Le temps ? Il tourne avec les personnages, en ces deux lieux. Faites le noir, maintenant, regardez, regardez les images tourner ! J’avais pris le sens de la rupture, j’habitais en elle. L’amour des autres me repose.
Chapitre 1
Trois mille vies
Cela commencerait comme un conte, et de façon très lente, je suis née dans un château, j’y ai dormi cent ans pour me réveiller devant une page blanche. Mes habits démodés sans couleur s’y refléteraient magiques, encore clairs malgré le temps qui a passé. Depuis, je me vêts de noir le plus souvent, encore que. Je suis grande maintenant, mais je n’ai pas tellement vieilli, pas de cernes sous les yeux, aucun trait ne me fait vraiment défaut. Et puis je ne conserve que ce qui cogne. Les fenêtres de l’appartement donnaient sur la cour des Adieux. C’était la plus belle cour du château, elle avait plusieurs noms : cour du Cheval blanc en souvenir d’une statue élevée en son centre déboulonnée depuis longtemps ou cour d’Honneur, sa situation dans l’endroit. Sur trois de ses côtés se déployaient un corps et deux ailes, drôle d’animal qu’un château de temps en temps construit en divers monuments, un étage puis un autre, puis un toit, un étang, une autre cour, un jardin, un escalier, deux escaliers, trois escaliers élevèrent la royauté au sommet. La distribution des logis fut aussi concertée que le jeu de la brique dans la pierre. Les fenêtres de l’appartement donnaient sur la cour des Adieux, mon enfance en pelote se déroulait dans tous les corps du bâtiment. Elle s’exerçait à l’architecture et à l’histoire. Longtemps j’oubliai le nom de la cour. Les bâtiments tournaient autour de la cour des Adieux et son nom tourna en moi luciole pendant longtemps. Je le retrouvai par nuit noire, entre somme et sommeil et il fut feu mélancolique, explosion de temps mort, gouttes de soleil sombre. Ciel sans ambages. Il me rapprochait d’Élie, d’Amédée et de Véronique par trois linéaires de gros mur.
Véronique me demande de raconter ma vie devant deux caméras. Elle m’autorise à mentir. Sa proposition d’histoire repose sur ma vie. Dans le roman qu’elle avait écrit, elle donnait des noms à ses amis, à ses rêves déroutants, elle mentait jusque dans la salle de montage. Véronique me demande d’exposer mes histoires devant deux caméras. Elle me le demande et cela survient dans les derniers parements d’une histoire triste. Les deuils les plus terribles, de soi-même, l’épreuve d’exister un jour un peu plus qu’il est d’usage. Ce qui nous reste alors la fiction met bas les armes. Sans défense désormais je décide de raconter ce qui, dans ma vie, apparaît comme la négation de la vie, comme les mensonges que les enfants inventent en se jouant, rôles informes, la forme du roman. Véronique me demande de raconter un pan de vie devant deux caméras, je décide de ne pas mentir, ou pas comme elle l’entend. Elle veut que je donne à mon récit la forme fluide du temps qui revient, enrouler ses images tout autour. Mais je confonds à dessein le réel et le présent et de cette manière je consume l’un et l’autre. Le mensonge, bon, c’est le règlement du compte des temps racontés, la violence avec laquelle le lierre s’agrippe à un arbre et pas à l’autre, une image de la fiction qui monte comme la sève ainsi entravée. Je veux tenir dans ma main le sang des arbres.
€ 14.00