Nous ne cessons de dire adieu
Ceci n'est pas un récit, un essai, une biographie. Au croisement de ces voies il s'agit pour l'auteur, à travers un corps qu'il perçoit comme un vase brisé, de donner forme au temps, à l'improbable réalité de son écoulement. Il le fera avec ce qui lui tombe sous la main : des ombres, des visages, des bouts de rêves. 106 p. (2000)
Christian Dufourquet est né à Oloron Sainte-Marie. Après de nombreuses années passées en Afrique noire il vit actuellement à Montpellier. Il a publié plusieurs recueils de poèmes aux Editions Saint-Germain-des-Près et dans les Collections du Pont de l'Epée et du Pont sous l'Eau (Guy Chambelland)
Extrait
Couloir du scanner. Quelques malades en pyjama attendent, debout la plupart, adossés au mur, silencieux, désœuvrés. Au milieu du couloir, l’un d’eux gît sur son lit à roulettes, abandonné. Il n’en a plus pour bien longtemps, cela se voit (peau grise et pincée), s’entend (suffoque et se plaint, va chercher très haut un air qu’il ne retient plus au-dedans). Au fond du couloir, une télé allumée, que personne ne regarde (s’y déroule, irréelle et comique, la retransmission en direct des Championnats d’Europe d’Athlétisme). Pas un bruit, sinon la voix spectrale du commentateur, et le gémissement qui sourd à intervalles réguliers d’entre les os du vieil homme exposé.
Cliquetis lointain de chariots dans l’allée. Abrutissement.
Assis dans le couloir, il songe à ses retrouvailles, quelques heures plus tôt, avec le Professeur. Au sentiment qu’il éprouvait, tandis qu’il parlait, s’essayait à décrire les symptômes de sa maladie, d’être à peu près aussi utile à sa cause qu’un voyageur égaré sur le bord d’une voie de chemin de fer désaffectée, et contemplant la courbe d’un rail qui disparaît sous un tas d’indistinctes saletés.
On voit des débris de parties molles, d’un brun foncé, noirâtre, desséchées et feuilletées à gauche, tandis qu’à droite elles sont d’une couleur moins foncée et offrent dans certains points des plaques blanchâtres, comme plâtreuses.
Ce qu’écrivait le Professeur, il y a quinze ans :
« Il est effectivement habituel de prêter une certaine pauvreté fantasmatique aux individus porteurs du symptôme psychosomatique. »
(du coin de l’œil, quinze ans plus tard, il revoit l’individu porteur de ces mots plaquer les radios de son thorax contre un écran opalescent, les scruter longuement, comme s’il essayait de circonscrire sur une carte imaginaire le lieu non moins imaginaire, quoique parfaitement visible, de sa maladie — effectuant un relevé point par point du terrain, comme s’il devait tracer un jour une route qui le traverse.)
Le Professeur lui fait signe d’approcher. Il se lève et le rejoint face à l’écran rempli à moitié d’une cargaison d’ombres à la fois inertes et floues, agglutinées — semblables aux remous crevant à la surface d’un combat qui déplace dans son corps des forces et des masses inconnues.
Conscient aussi, à l’instant qu’il se penche sur les preuves de la partie que son esprit joue dans son dos avec une main gantée d’oubli, de négocier à travers sa présence, ses silences, ses réponses maladroites aux questions du Professeur, une prolongation éventuelle du temps qui lui est imparti (sans que cela concerne sa maladie, voilà le hic — comme un pyromane qui n’aurait rien de plus pressé, alors que sa maison brûle, brûlera, a déjà brûlé, que l’envie de discuter du temps qu’il fait avec le capitaine des pompiers) .
« Mais peut-être serait-il excessif d ’affirmer que ceux-ci sont dépourvus de fantasmes. Ils auraient plutôt une difficulté à exprimer ces fantasmes, un peu comme s ’il leur était impossible de s ’impliquer dans leur imaginaire, ou si un interdit frappait leurs désirs. »
Apaisé seulement au moment qu’on le manipule et l’ausculte, quand il sait n’être plus, dans l’oreille du Professeur et de son assistante penchés symétriquement sur son dos et sa poitrine, qu’une suite de crépitements diffus (rien qui lui advienne en réalité, le cercle pur de son absence est pour ainsi dire refermé, là-bas le capitaine des pompiers s’est détourné ou plus certainement n’a pas même vu ou à peine, toute son attention mobilisée par l’ampleur rugissante du foyer, l’individu assis sur la pelouse et tournant le dos à sa maison qui brûle, la tête comme noyée dans son ombre et marmonnant des paroles incompréhensibles).
« Aussi, le discours du patient porteur du symptôme psychosomatique apparaît-il souvent comme pauvre, stéréotypé et répétitif, dépourvu de dimension affective. L’imaginaire en est quasiment absent, alors que la symbolique y est majeure. »
(à son contraire, le Professeur n’a pas tellement changé depuis tout ce temps : grand, légèrement voûté, le cheveu grisonnant ; l’air d’un cavalier — il y a en lui du fleuret, quelque chose qui allie la fleur à l’acier, la brume d’une dentelle à la torsion rapide d’un poignet — d’ivoire qui traque une tour noire à l’extrême bord d’un échiquier déserté.)
« Chez beaucoup d’asthmatiques, par conséquent, la verbalisation fait défaut au fantasme, comme s’ils n’avaient pas de mots pour l’exprimer. Et ce fantasme participe dès lors à l’élaboration du symptôme. »
(dit autrement, aujourd’hui qu’il n’a plus la moindre illusion sur sa capacité à exprimer quoi que ce soit : il se fiche bien de connaître les règles du langage qu’il emploie s’il peut se perdre à tout coup dans les sortilèges de la fiction qu’il sécrète.)
Les malades : précautionneusement ils respirent à reculons.
« L’imaginaire du patient dit “psychosomatique” s’exprime, par contre, plus facilement dans l’écriture que dans la parole. Parce que le sujet peut toujours, dans une certaine mesure, y rester extérieur à son écrit, ou bien se reprendre, revenir en arrière. »
La voix du Professeur. Salle obscure, dédoublée par un miroir. Visages qui libellulent à la surface d’une idée noire.
Il faut apprendre à mourir : voilà toute la vie.
Comme un ver coupé d’un coup de bêche en deux tronçons indistincts, et qui se tord, continue à suçoter la terre par les deux bouts, pense-t-il en se regardant sortir de la pièce et s’enfuir dans un couloir dont il manque un mur, couloir qui se rétrécit, serpente, bientôt il ne peut plus avancer qu’à grand-peine, le corps plaqué contre un mur dont il ne voit pas le haut, cela tourne de plus en plus, virages dans le vide, s’achève en cul- de-sac - bizarrement le côté vide a disparu, le fond est flou, pas vraiment vertical, c’est un panneau vitré qui obture en partie la vue.
— Et qu’est-ce qui détermine la durée de notre séjour ici ?
— Notre bon vouloir.
À main gauche se dresse le tronc lisse et droit d’un grand avocatier — déformé à sa base où une termitière a pris souche, comme une tumeur faite de nappes de terre qui ont coulé l’une sur l’autre, se sont solidifiées, la dernière encore tendre et noire, comme un plombage fourré à un mètre du sol, dans un creux du bois.
De loin l’allure générale est lisse, sans aspérités, cela ressemble aussi au capuchon d’un poulpe monstrueux, qui a fiché l’une de ses tentacules dans le sol tandis que les autres remontent le long du tronc en l’enlaçant. Image qui l’horrifie, comme si elle lui était consubstantielle. Comme s’il y avait là une porte de l’Enfer qui n’était ouverte que pour lui - que pour qu’il la referme derrière lui, songe-t-il en s’approchant avec un long frisson de dégoût. Car il en est le gardien, la croûte de terre qu’il gratte avec un bout de bois est pleine de petits points blancs, le bas de sa nuque le démange comme si le col de sa chemise grouillait de poux.
Qu’est-ce qui vous fait peur ?... Qui voyez-vous ?... Vers qui criez- vous ?
Il a 12 ans, l’âge des communions officielles et clandestines. Debout dans un coin de la cour il lit les Lettres d’Amour de la marquise de Sévigné, un faux grossier qui circule dans l’enceinte du lycée. Ses paumes sont moites tandis que son regard bute sur le bord de ces mots étranges : foutre, lèvres grandes et petites, clitoris, dont il ne sait l’usage (les femmes étaient lointaines, alors) ni le lien avec cela qu’il sent grossir entre son cœur et sa main (main à plume déjà, qui remonte loin de lui et comme à rebrousse-membre — que fait-elle ? qu’est-ce que ça veut dire ? — jusqu’à ce vague, ce nuage qui pèse dans son ventre, noir, originel).
Mystérieusement, le cœur bat.
Il a 20 ans et tourne tôt le matin le dos à la place Blanche, prend sur le boulevard le métro aérien qui le dépose à quelques stations de là, au bas d’une rue pavée, montante, déserte. À mi-rue il pénètre dans une sorte de cour-entrepôt où des camions manœuvrent. Au fond de la cour, une volée de marches de bois qu’il redescend le dernier, à la nuit tombée.
Te voici donc enfin, et en même temps au début, mais de quoi, tu ne sais pas. Et ce n 'est certes pas moi qui t’éclairerai. D’ailleurs, je te parle en aveugle mais je t’entends, j’entends ta voix, je la perçois atone comme toujours, dissociée du noyau actif de tes choix. Collé à elle qui résonne en moi je m’élève, et ce faisant je m’affaisse, tout pareil à un poulpe assoupi dans un brouillard de sang.
Cravaté, costumé, il découpe dans le silence de la rue Blanche de glaciales enjambées, glaciales et égales qui le propulsent, d’un pas bien mal à propos automatique, vers la rue de Douai. Frôlant sur son trajet sans les voir ou à peine, le temps d’un coup d’œil jeté à l’intérieur de leur antre obscur, les entraîneuses du quartier, juchées toutes à cette heure, un peu en retrait de la rue et largement décuissées, sur le même tabouret. Dans le halo rose et violet d’une lampe qui s’éteint, se rallume, trois pas plus loin, sur la même fille au regard semblablement charbonneux et froid. Comme si la rue tout entière était livrée à la surveillance comme au bon vouloir des filles de Nadja, qu’elle aurait faites comme dans un rêve, possédée dans un miroir par un oiseau de proie.
€ 13.00
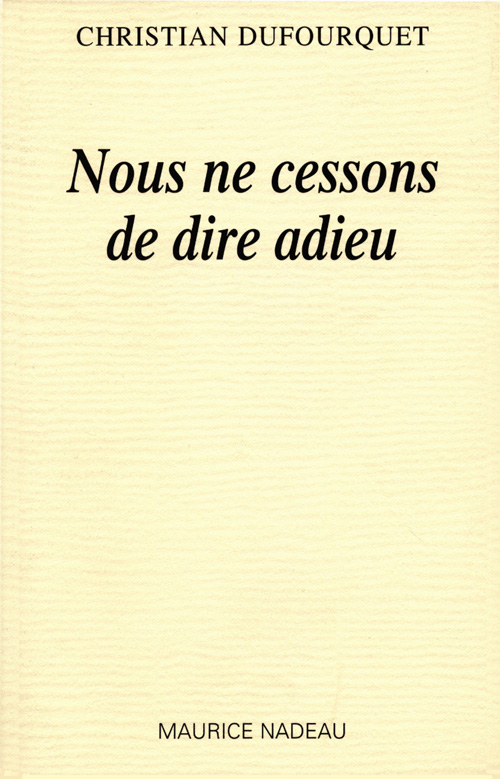
Ceci n'est pas un récit, un essai, une biographie. Au croisement de ces voies il s'agit pour l'auteur, à travers un corps qu'il perçoit comme un vase brisé, de donner forme au temps, à l'improbable réalité de son écoulement. Il le fera avec ce qui lui tombe sous la main : des ombres, des visages, des bouts de rêves, des fragments de paysages. Il le fera surtout avec cela seul qui donne une apparence de fixité à ce qui ne peut qu'à l'instant de la mort se recoller: des mots pris dans le mouvement de phrases qui sont comme la quête d'une taupe immobile sous la terre. Comme les voix étouffées de tous ces mots : Proust, Kafka, Rodanski, Rimbaud et tant d'autres que le texte aura traversées pour se constituer.
Christian Dufourquet est né en 1947 à Oloron Sainte?Marie. Après de nombreuses années passées en Afrique noire il vit actuellement à Montpellier. Il a publié plusieurs recueils de poèmes aux Editions Saint?Germain?des?Prés et dans les Collections du Pont de l'Epée et du Pont sous l'Eau (Guy Chambelland).


