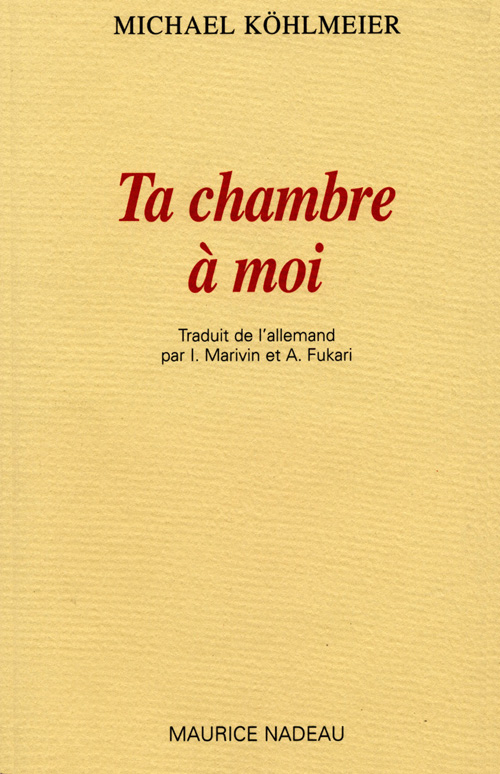Ta chambre à moi
Une histoire à la fois fantastique et toute simple qui commence dans un train et continue dans une chambre. Mais tout est vu autrement à la place de quelqu'un par quelqu'un d'autre. C'est à la fois drôle et inquiétant. Traduit de l'allemand par I. Marivin et A. Fukari. 105 p. (2000)
Michael Köhlmeier est un auteur autrichien d'une trentaine de romans, d'une vingtaine de pièces de théâtre, lauréat de quatre prix littéraires pour l'ensemble de son oeuvre.
Extrait
« Je ne voyais qu’une oreille, dit le jeune homme. Si j’avais tiré la langue en me penchant juste un peu, j’aurais pu la toucher tellement l’homme était près de moi. Il avait oublié d’enlever son manteau avant de monter dans le train. Maintenant, ce n’était plus possible. C’est de cela qu’il me parlait. Je ne le comprenais pas très bien. Un peu seulement. Je ne connaissais pas encore suffisamment la langue dans laquelle il s’exprimait et qui plus est, il parlait indistinctement et la tête tournée. Nous pouvions à peine bouger.
Le train avait trois quarts d’heure de retard pour la bonne raison que nous avions mis un temps fou à monter. Monter, d’ailleurs, n’est pas le terme exact. C’était peut-être vrai pour les premiers. Et même eux, en fait, avaient été poussés. Dans une cohue pareille, il ne peut guère être question de monter. Leurs valises avaient été hissées par les fenêtres. Des gens de petite taille comme les enfants et les vieilles femmes toutes rabougries avaient subi le même sort. Dans un premier temps, j’ai regretté de ne pas avoir eu de place assise. Par la suite, je n’ai eu qu’à m’en réjouir. Près de quinze personnes étaient venues s’entasser dans un compartiment prévu pour six. Heureusement, j’avais vidé ma vessie avant de monter. Pour certains, c’était un problème. D’autres se lamentaient.
Puis, un homme dit qu’on l’avait prié de demander si quelqu’un avait de quoi boire. Cette voix était très claire, ni accablée ni exténuée comme l’aurait sans doute été la mienne. Pourquoi s’exprime-t-il ainsi, me demandai-je. J’en déduisis qu’il maîtrisait aussi peu que moi la langue du pays. C’est à la fois drôle et intéressant de voir que ce sont souvent les étrangers qu’on comprend le mieux — un Polonais en Amérique, un Suisse en Angleterre... Mais qu’est-ce que je raconte !
— Je comprends ce que vous voulez dire, dis-je.
— Oui, sûrement, dit-il, mais ce n’est pas d’un Polonais en Amérique ou d’un Suisse en Angleterre que je veux vous parler.
— Je sais bien », dis-je.
Nous étions au café Eiles à Vienne. Assis en face de moi, il buvait un chocolat. Je l’avais attendu à une table en retrait. J’avais eu le temps de voir sécher les traces de mes chaussures sur le parquet, de lire tout un article sur la Lituanie dans le Neue Zürcher Zeitunget de m’avancer deux fois vers le comptoir dans l’espoir de le trouver installé dans l’autre aile du café. Enfin je le vis apparaître dans le grand miroir qui couvrait le mur du fond. Il tenait un mouchoir et l’agitait devant lui tel un parlementaire. Un mouchoir blanc, c’est le signe de reconnaissance qu’il avait proposé. Sous son costume noir, lourd et peu soigné il portait une chemise bariolée. Il avait les cheveux longs, bruns, les favoris finement rasés. Il commanda un chocolat et cala ses pieds autour du socle de la petite table en marbre. Il avait l’habitude de rentrer la tête dans les épaules et, lorsqu’il buvait, de regarder par-dessus le bord de sa tasse comme s’il réfléchissait. Il ne riait pas. Je voulus m’en assurer en lui racontant une première blague. Puis une autre. Non, il ne riait pas. Son sérieux était drôle, son accent à couper au couteau. Mais il s’exprimait clairement, parfois même avec une certaine recherche. Je lui donnais autour de vingt-huit ans.
Il serait trop long d’expliquer comment nous avions fait connaissance et de toute façon, c’est sans importance. Il voulait me raconter une histoire. Il s’était présenté au téléphone, je n’avais pas compris son nom et lui avais demandé de le répéter. Ce qu’il avait fait mais je ne l’avais pas noté. C’était un nom à rallonge que j’aurais été incapable d’écrire. Au café, je le lui demandai de nouveau. Il me regarda longuement par-dessus le bord de sa tasse puis secoua la tête.
« Si ce nom vous chiffonne à ce point, je préfère ne pas vous le répéter. De toute façon, vous n’en avez pas besoin.
— Alors, comment dois-je vous appeler ?, demandai-je.
— Comme vous voulez, dit-il. Appelez-moi comme vous voulez. »
Le plus souvent, il parlait allemand, parfois anglais. Parfois il retombait dans sa langue maternelle. Il me donnait l’impression d’être un farceur en train de jouer un numéro, celui d’un mauvais prestidigitateur qui laisserait voir les fils des objets qu’il fait sortir de son costume, et la farce, c’est ça précisément. Ses accessoires à lui, c’étaient les mots qu’il hachait à coup de dents et qu’il roulait avec sa langue pour leur donner la forme voulue. Voilà pourquoi il me donnait l’impression d’être un farceur. Je le lui dis.
« Je comprends le mot, mais il doit sûrement avoir un autre sens, un sens que j’ignore », répondit-il. Et, sans transition, il poursuivit son récit. « Une voix d’homme a demandé si quelqu’un avait une bouteille d’eau, il y avait là un enfant qui pleurait tellement il avait soif. La question fit le tour du wagon. Mais il n’y eut pas de réponse. Il faisait si chaud dans ce train qu’on avait déjà bu toute l’eau. Je vous ai dit que c’était l’hiver ?
— Non, dis-je.
— Eh bien, c’était l’hiver. Un hiver très froid. Et par un temps pareil, on chauffe dans les trains. Déjà, quand le train est vide, il fait trop chaud, alors quand il est bondé, n’en parlons pas. J’entendais l’enfant crier. Moi aussi j’aurais voulu crier. Je me serais retrouvé à crier dans l’oreille de cet homme qui devait avoir de bonnes manières puisqu’il avait eu la courtoisie de garder la tête tournée pour me parler. Personne n’avait d’eau.
Dans la gare, j’avais ôté mon manteau parce que la station debout dans les trains bondés, je connaissais. J’avais placé la valise entre mes jambes et posé mon manteau dessus. C’était un bon manteau, solide, taillé dans un tissu épais et garni d’une doublure boutonnée. Même en plein hiver, je pouvais me contenter d’une doublure boutonnée. Même en plein hiver, je pouvais me contenter d’une simple chemise et d’un maillot de corps. C’était un avantage. Dans le train, certains portaient encore un pull-over sous leur manteau. Bien sûr, eux aussi avaient enlevé leur manteau avant le départ mais ils avaient gardé leur pull-over. Maintenant, ils transpiraient et ne pouvaient plus l’enlever.
Dehors il neigeait. Une neige si serrée que l’on ne voyait pas le paysage à vingt mètres. Occupé à scruter l’oreille de cet homme, je ne savais pas depuis combien de temps nous roulions et j’ignorais donc aussi où nous nous trouvions. Je connaissais le trajet, mais seulement pour avoir de temps à autre jeté un coup d’œil par la fenêtre. Le plus souvent, j’avais passé mon temps à lire ou à dormir jusqu’à la frontière. Finalement, ce trajet, je ne le connaissais pas vraiment. “Farceur”, c’est bien ça le nom que vous voulez me donner ?
— À condition que vous soyez d’accord, disje.
— Ce n’est pas moi que vous devriez appeler ainsi, dit-il. Mais je pense qu’il existe quelqu’un en moi qui mérite bien ce nom.
— Ah oui ? dis-je.
— Oui, dit-il. J’aime faire des farces. Parfois je me fais des farces à moi-même. On dit ça — se faire des farces ? C’est-à-dire, je dis des choses sans le vouloir. Ou plus précisément : j’ouvre la bouche sans savoir ce que je vais dire. Nos décisions les plus importantes, nous les pensons sans les mots. C’est comme ça. C’est comme si en moi il y avait quelqu’un qui passait le plus clair de son temps assis dans sa chambre. Enfermé peut-être. Je ne sais pas exactement. Tantôt, lui voudrait sortir et je le lui interdis. Tantôt c’est moi qui voudrais qu’il sorte et lui refuse. Mais le plus souvent, je me dis qu’il serait temps qu’il sorte un peu, j’ouvre la porte et il est déjà posté derrière à attendre. Vous voyez ce que je veux dire?
— Je vois, dis-je.
— À partir de maintenant, c’est lui que j’appellerai “le farceur”, dit-il. Puisque vous m’avez soufflé le mot. Vous m’offrez un autre chocolat ? — Bien sûr, dis-je. Je passai commande et il poursuivit son récit.
— C’était l’après-midi, nous roulions à travers la neige. Les flocons tourbillonnaient contre les vitres, nous ne voyions que du blanc et c’est comme s’il n’existait aucun monde au-dehors, comme si le train s’enfonçait à travers le néant, d’un monde dans un autre monde. Et il n’était question que d’une chose. D’une seule chose : l’eau. Car entretemps, tout le monde s’était mis à discuter. Cela nous faisait du bien d’avoir un sujet commun et surtout de penser que cet enfant, là-bas, à l’arrière, aurait peut-être moins soif à force d’entendre parler d’eau. Elle me plaît votre histoire de farceur. Si, si. Vous allez voir tout de suite.
Car soudain le train se met à ralentir et d’un coup, il s’arrête. Nous regardons par la fenêtre. Pas de gare. Le train est immobilisé en rase campagne. Sans doute un signal qui ne donne pas la voie libre. À présent, on distingue davantage le monde du dehors car la neige ne tourbillonne plus autant contre la vitre. On aperçoit une route. Mais ce n’est pas tout. Une station-service aussi. Au bord de la route, il y a une station-service qui se trouve juste à la hauteur de notre train. Juste à la hauteur de la fenêtre par laquelle je regarde, pour être précis. Et à cet instant, je me dis, tiens, ce serait peut-être le moment de laisser sortir le farceur de la chambre de ton âme.
— Farceur, c’est vous qui m’avez soufflé le mot. J’ai enfin un nom pour lui.
— Vous vous moquez de moi, dis-je.
— Cela vous gêne ? demanda-t-il.
— Non, non, dis-je.
— J’ouvre la porte de la chambre où vit mon farceur. Et le voilà déjà qui dit : “Allez, portez-moi, comme ça je descends par la fenêtre et je cours à la station-service chercher de l’eau pour l’enfant !”
Voilà ce que dit mon farceur. Ou moi si vous préférez. Du moins c’est ce qui sort de ma bouche. Celui que vous appelez “farceur”, c’est lui qui me souffle toutes ces inepties.
Et, chose incroyable : Voilà qu’on m’applaudit ! l’homme dont j’avais étudié l’oreille comme en rêve se tourne alors vers moi et, me serrant la main, me congratule. Nous sommes à ce point tassés que nos mains se retrouvent plus haut que nos épaules. Mû par un enthousiasme muet, il me regarde en secouant la tête.
“Faites attention à mes affaires”, dis-je.
“C’est un honneur”, souligne-t-il. “Et je ne dis pas ça pour vous faire plaisir.”
“À mon manteau et à ma valise.”
“À votre manteau et à votre valise, mais bien sûr.”
Ils se mettent à me porter. Des mains se tendent vers moi. Tout le monde veut me toucher. Beaucoup n’y parviennent pas. Leurs mains cherchent à m’agripper comme s’ils voulaient une relique de moi. Ils baissent la vitre. Dans un premier temps, ils cherchent à me faire passer par la fenêtre la tête la première.
“Non, dis je en me débattant, pas comme ça ! Je vais tomber sur la figure !”
J’entends quelqu’un crier “Dépêche-toi”, et cela me vexe qu’on me tutoie comme ça, sans scrupules. Ils n’ont pas à tutoyer celui qui se sacrifie ! On me fait tourner afin que mes jambes passent en premier.
“Dépêche-toi, se mettent alors à crier d’autres voix, sinon, le train va partir et l’enfant n’aura pas son eau !”
Ma gloire s’est-elle donc déjà envolée, me dis-je. Pour qu’ils ne se préoccupent plus que de l’enfant et pas de moi ? Pour que personne ne s’inquiète de mon sort ? Je pourrais faire une mauvaise chute et me casser une jambe.
Ils me poussent. Je me fais mal en tombant, roule sur le côté, dans la neige. Je n’avais sur moi que ma chemise de flanelle à carreaux. S’il faisait très chaud dans le train, dehors il faisait froid. La neige me rentrait dans les manches et le cou.
€ 14.00